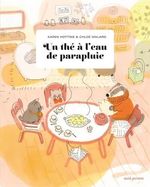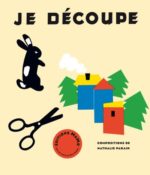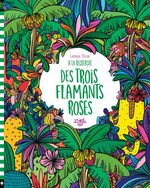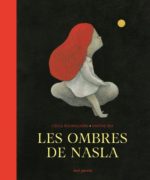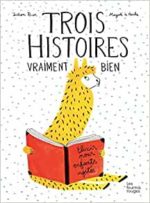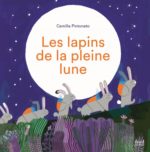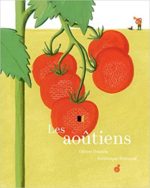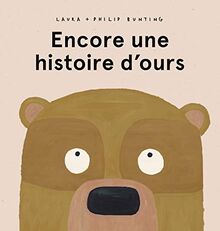Voyage au pays des monstres
Claude Ponti
L’école des loisirs / Musée d’Orsay, 2020
Monstre, mon ami
Par Anne-Marie Mercier
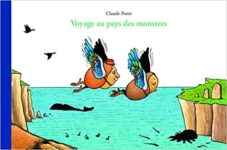 Embarqués à bord du bus parisien de la ligne 84, que ne voit-on pas ? La Seine au pont Royal, le Musée d’Orsay, les Tuileries, la place de la Concorde et le musée de la Marine, qui offrent à voir bien des objets et des êtres étranges, aussi étranges que certains passagers du bus, d’ailleurs. Puis, au moment où le narrateur souhaite être ailleurs que dans ce bus, l’ailleurs s’invite.
Embarqués à bord du bus parisien de la ligne 84, que ne voit-on pas ? La Seine au pont Royal, le Musée d’Orsay, les Tuileries, la place de la Concorde et le musée de la Marine, qui offrent à voir bien des objets et des êtres étranges, aussi étranges que certains passagers du bus, d’ailleurs. Puis, au moment où le narrateur souhaite être ailleurs que dans ce bus, l’ailleurs s’invite.
C’est d’abord une forêt qui ressemble beaucoup à celle qui pousse dans la chambre de Max dans Max et les Maximonstres. Puis un entonogondolo, qui aspire le narrateur et le place dans une coquille qui lui va bien et lui donne des ailes. Autre rencontre, celle de « Toikili, qui lit ce livre » : nous voilà embarqués dans l’omnibus de la lecture et de l’imaginaire pontien, et dans l’imaginaire vaste de la littérature de jeunesse (le lapin d’Alice, Little Nemo, Peter Rabbit, la fourmi de Desnos…) et de l’art en général, qui a engendré bien des monstres (Jérôme Bosch, Jacques Callot, des grotesques de cathédrales; il y a une liste en fin de volume pour tout repérer.
C’est un drôle de monstre qui souhaite la bienvenue au narrateur, monstre qui sort du cadre (ou de la case), et surtout de l’esthétique pontienne : il s’agit de l’un des monstres de Léopold Chauveau, que l’on retrouvera tout au long de l’aventure. Comme la première image du bus le suggère, l’album accompagne l’exposition « Au pays des monstres. Léopold Chauveau (1870-1940) », consacrée à cet artiste, sculpteur, dessinateur et auteur un peu trop oublié d’ouvrages pour la jeunesse (notamment avec les Cures merveilleuses du Docteur Popotame (réédité chez MeMo) et ses « histoires du petit père Renaud »). Cette exposition a été présentée au Musée d’Orsay, entre mars et septembre 2020 ; pas de chance vu le peu de fréquentation des musées pendant cette période de confinement et de déconfinement, mais l’œuvre de Ponti permet de lui donner une deuxième vie.
Pas de véritable intrigue, mais un voyage dans l’imaginaire et une rêverie sur ce qu’est le monstre qui touchera aussi bien les adultes que les enfants : « Les monstres se fabriquent à l’intérieur d’une personne tout doucement sans faire de bruit. Ce sont des amis secrets. Ils réfléchissent, rêvent, plaisantent, consolent ceux qu’ils habitent ». À sept monstres de Chauveau, Ponti donne un nom, une histoire, une qualité, secrète et utile : l’Effassensonge adoucit les pensées, Cœur-penché crée le rire, Bec de Calme dose comme il faut la méchanceté (car il en faut, « pour se protéger »), Léhaut-Polnu rend double, Louramour «rend les amours digestes», l’Ouazo serein chasse les mauvais rêves, l’Ensemblières aide les monstres qui cohabitent dans une même personne à s’entendre…
Ces monstres, dit le narrateur à Toikili, « donnent de la joie et une sorte de consolation. C’est peut-être parce que nous savons maintenant que certains monstres n’en sont pas, qu’ils soient de chair ou de papier, de chair ou de brume ». Le livre donne des ailes pour survoler la mer des histoires (S. Rushdie ?) avant de rentrer à Paris et de retrouver le bus pour l’un, le livre fermé pour l’autre.
Un article de Marie-Pierre Litaudon, « Léopold Chauveau et ses « histoires du petit père Renaud » : Cronos au cœur de l’invention », paru sur Strenae en 2013 résume sa carrière et son style.