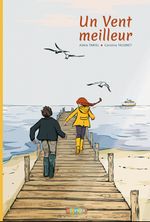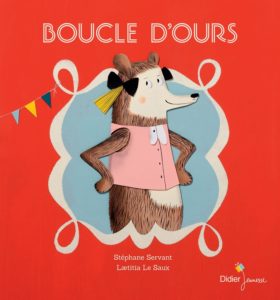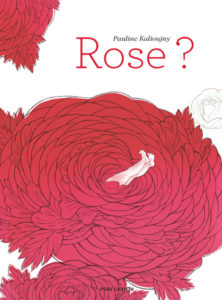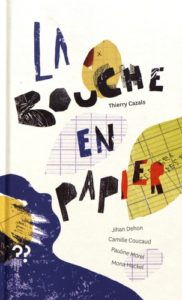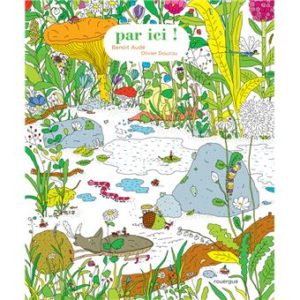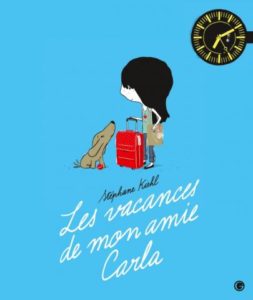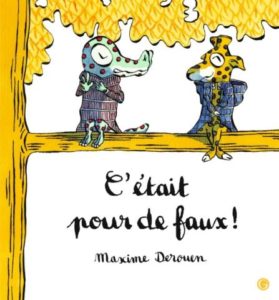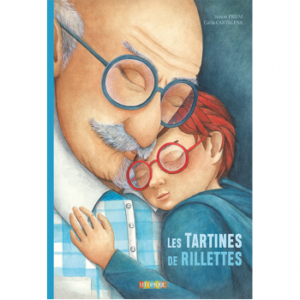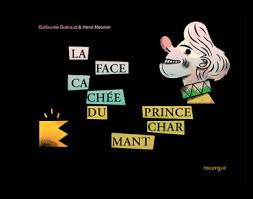La Fille qui cherchait ses yeux
Alex Cousseau – Csil
A pas de loups 2019
Pour prendre le temps de regarder passer les nuages…
Par Michel Driol
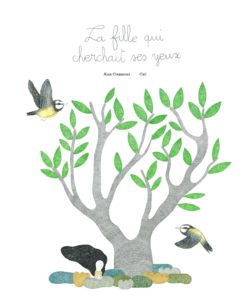 Fine cherche partout ses yeux. Un couple de mésanges noires a fait son nid dans ses cheveux, et les oiseaux la fatiguent de leurs piaillements. Mais Fine invente et s’efforce de traduire en images ce qui se passe autour d’elle. Et si ses yeux s’étaient perdus dans la grande ville ? Alors Fine va explorer le monde, rencontre des gens pressés qui ne font pas attention à elle. Les deux mésanges la consolent : qui utilise encore bien ses yeux de nos jours ? Dans une gare, elle entend les voix qui se mêlent, et, perdue, caresse pour la première fois ses deux oiseaux. Quand vient la nuit, Fine devient sensible au silence, et les oiseaux la reconduisent chez elle, où elle retrouve ses parents.
Fine cherche partout ses yeux. Un couple de mésanges noires a fait son nid dans ses cheveux, et les oiseaux la fatiguent de leurs piaillements. Mais Fine invente et s’efforce de traduire en images ce qui se passe autour d’elle. Et si ses yeux s’étaient perdus dans la grande ville ? Alors Fine va explorer le monde, rencontre des gens pressés qui ne font pas attention à elle. Les deux mésanges la consolent : qui utilise encore bien ses yeux de nos jours ? Dans une gare, elle entend les voix qui se mêlent, et, perdue, caresse pour la première fois ses deux oiseaux. Quand vient la nuit, Fine devient sensible au silence, et les oiseaux la reconduisent chez elle, où elle retrouve ses parents.
On s’aperçoit, en proposant le résumé de cet album, que l’on passe à côté de ce qui fait sa beauté, son originalité et sa poésie, et qu’on ne peut le réduire à une histoire. Il est question bien sûr de handicap, mais traité ici avec pudeur : pas une seule fois les mots aveugle ou malvoyant ne sont écrits. Il est donc surtout question d’une quête de quelque chose, d’un sens, qui parait faire défaut à Fine, alors que tous les autres sens sont bien présents, jusqu’au toucher lorsqu’elle caresse les oiseaux. A l’inverse du conte traditionnel, où l’héroïne va se perdre dans la forêt, Fine est dès le départ reliée aux arbres – en particulier dans les images de forêts, de racines, qui démentent le texte « Je ne suis pas un arbre » dit-elle, et elle va se perdre en ville pour tenter d’y trouver l’objet de sa quête. Mais la ville est décevante, les hommes ne la voient pas. Ce sont les oiseaux qui proposent, au cœur du livre, la sagesse qui manquait à Fine et qui, sous forme de questions, interrogent sur les liens désormais brisés entre les hommes et la nature : les hommes ne savent plus regarder ni la nature, ni leurs voisins… Comme en écho à ces préoccupations, Fine prendra conscience de la présence et de la valeur du silence, caché, invisible, égaré, mais omniprésent, comme un compagnon. La quête des yeux débouche donc sur la découverte du silence, à la fois extérieur et intérieur, un silence qui permet d’une certaine façon une communion avec la nature et les animaux – ce que suggère l’image finale, qui reprend la chambre de Fine avec ses arbres plantés dans le ciel que l’on avait déjà vue, mais cette fois remplis d’écureuils, tandis que Fine, dont on n’a jamais vu les yeux cachés par une franche noire, semble les avoir retrouvés.
Cet album métaphorique revisite les contes traditionnels pour aborder le thème des différences et de leurs richesses, des singularités individuelles à trouver. Il renvoie aussi au lien entre l’individu et les autres, entre l’individu et la nature : quel regard prenons-nous le temps de porter sur le monde ? Quel prix, dans un monde plein de sons, de bruits, d’images agressives, accordons-nous au silence, et au silence intérieur ? Telle est la portée morale et philosophique de ce conte initiatique, écrit dans une belle langue poétique et illustré avec délicatesse par Csil dans une palette de couleurs pastels, tendres et douces, en parfait accord avec l’atmosphère générale du texte.