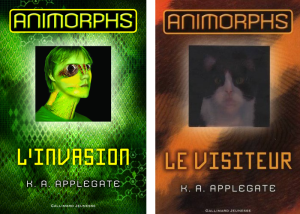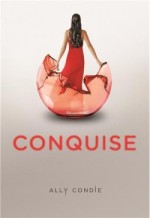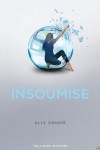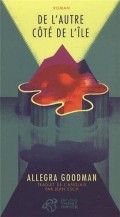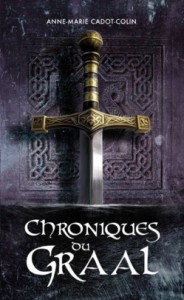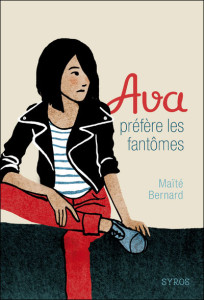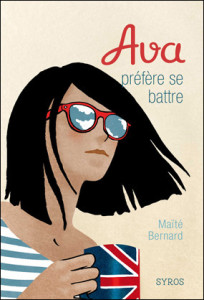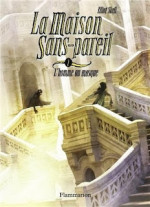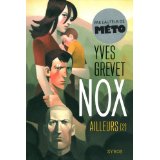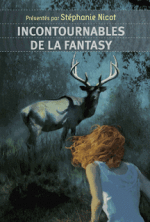Les fragmentés
Neal Shusterman
traduit (américain) par Emilie Passerieux
Editions du Masque, 2013 (réédition de 2008)
Si tu n’es pas sage, je te fragmente!
Par Christine Moulin
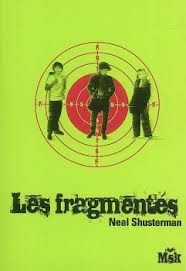 Connor est un adolescent difficile : ses parents ont donc décidé de le faire fragmenter, c’est-à-dire découper en morceaux, dans le « camp de collecte », pour servir au don d’organes ou, plus pudiquement, de le « résilier […] sans pour autant mettre fin à sa vie ». Il décide de s’enfuir. Dans sa fuite, il provoque un accident monumental. Il rencontre alors Risa, orpheline, pianiste prodige et virtuose, certes, mais pas assez virtuose, malgré tout, pour échapper à la fragmentation. Il rencontre aussi Lev, une sorte de fragmenté volontaire, un « décimé » plus exactement, issu d’une famille richissime pour qui c’est un honneur et un devoir de « fournir » un de ses enfants. Les voilà donc tous les trois en cavale, sans qu’on sache vraiment de quel côté va pencher Lev, qui a subi un « lavage de cerveau » pendant toute son enfance mais qui découvre peu à peu la saveur de la liberté et de l’amitié.
Connor est un adolescent difficile : ses parents ont donc décidé de le faire fragmenter, c’est-à-dire découper en morceaux, dans le « camp de collecte », pour servir au don d’organes ou, plus pudiquement, de le « résilier […] sans pour autant mettre fin à sa vie ». Il décide de s’enfuir. Dans sa fuite, il provoque un accident monumental. Il rencontre alors Risa, orpheline, pianiste prodige et virtuose, certes, mais pas assez virtuose, malgré tout, pour échapper à la fragmentation. Il rencontre aussi Lev, une sorte de fragmenté volontaire, un « décimé » plus exactement, issu d’une famille richissime pour qui c’est un honneur et un devoir de « fournir » un de ses enfants. Les voilà donc tous les trois en cavale, sans qu’on sache vraiment de quel côté va pencher Lev, qui a subi un « lavage de cerveau » pendant toute son enfance mais qui découvre peu à peu la saveur de la liberté et de l’amitié.
S’ensuit une longue errance pendant laquelle le trio se charge d’un bébé abandonné (puisque dans cette société à peine futuriste, une mère a le droit d’abandonner, de « refuser », pardon, son enfant à condition de ne pas se faire prendre sur le fait). Errance qui les amènera à croiser d’autres fugitifs : autant de destins dramatiques qui font froid dans le dos… Errance qui aboutira à une île, le Cimetière, qui n’est pas sans rappeler celle de Sa Majesté des Mouches, par la manière brutale dont elle amène à s’interroger sur la violence des rapports sociaux et la nature du pouvoir.
A cela s’ajoute une histoire, qui se raconte sous le manteau et qui est une allusion macabre à une chanson pour enfants anglaise, celle de Humphrey Dunfee, dont les parents, après l’avoir fragmenté, ont voulu revenir sur leur décision…
Bien sûr, ces victimes, que certains décident d’aider, au péril de leur vie, que l’on cache dans des caves, que l’on trimballe d’une cachette à l’autre, dont la fragmentation se fait dans un camp, sur fond de musique classique jouée par leurs compagnons de souffrance, en rappellent d’autres. Mais ils interpellent aussi au sujet des relations parents-enfants, de l’identité (les greffes exposent à de terribles combats au sein d’une même personne…) à propos de l’avenir de l’humain, de la liberté, de la nécessaire résistance à l’horreur, le tout sur un fond d’aventure haletant et bien mené. C’est peut-être ce foisonnement de thèmes qui fait parfois la faiblesse du roman, qui s’éparpille un peu, même si l’intérêt ne s’émousse jamais.