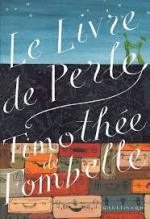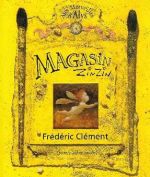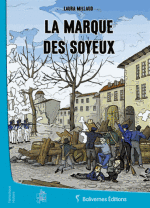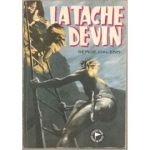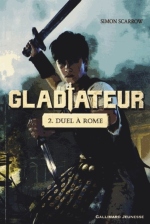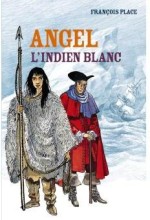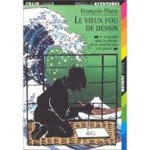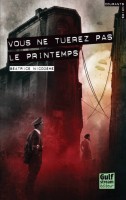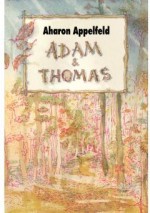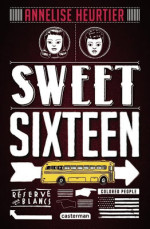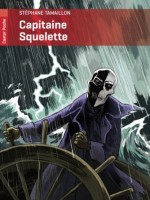Angel, l’indien blanc
François Place
Casterman, 2014
Atlas imaginaire et songes de nuits australes
Par Anne-Marie Mercier
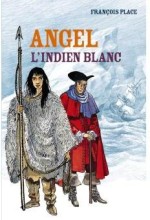 Jusqu’ici, François Place romancier n’arrivait pas à la hauteur (magistrale) de François Place auteur-illustrateur, malgré de belles échappées (j’en avais parlé dans ma chronique du Secret d’Orbae). Cette fois, avec Angel, il propose une œuvre impressionnante et fascinante, qui reprend les caractéristiques qui ont fait sa marque tout en ouvrant d’autres voies.
Jusqu’ici, François Place romancier n’arrivait pas à la hauteur (magistrale) de François Place auteur-illustrateur, malgré de belles échappées (j’en avais parlé dans ma chronique du Secret d’Orbae). Cette fois, avec Angel, il propose une œuvre impressionnante et fascinante, qui reprend les caractéristiques qui ont fait sa marque tout en ouvrant d’autres voies.
La tribu des Woanoas dans laquelle Angel, esclave en fuite, et Corvadoro, noble vénitien, séjournent est décrite avec le souci d’un ethnologue qui rappelle les autres romans de François Place et son Atlas des Iles d’Orbae : coutumes, division en classes d’âge, mode de pêche, structure sociale, religion… tout cela et bien d’autres sont évoqués, sans tomber dans un catalogue artificiel : tout est vu par les yeux d’Angel, ou à travers le témoignage de son compagnon de captivité, avec des incertitudes, des interrogations, des terreurs et des charmes puissants.
C’est aussi un récit d’aventures plein de rebondissements qui entrelace plusieurs thèmes : Angel est un bâtard, un métis (comme le titre l’indique) né au XVIIIe siècle d’une gouvernante française expatriée en Argentine puis enlevée par des indiens de ces terres, peuple systématiquement massacré par les conquérants européens. L’histoire de sa mère et la période de son enfance où il est un paria parmi eux est brièvement retracée dans le premier chapitre. Le personnage de sa mère vite disparue, marque l’esprit du lecteur par son originalité comme il marque la destinée de l’enfant. Vendu comme esclave après une razzia des blancs sur le village, Angel vit les durs travaux de sa condition et est un souffre-douleurs dans les distractions de son maître et des amis fortunés de celui-ci. Modèle de résilience, il puise dans ces épreuves ce qui lui fera réussir par la suite toutes ses entreprises dangereuses et mortelles. Tout cela fait l’objet d’un texte bref, le deuxième chapitre : autant dire que François Place excelle dans les narrations brèves, apparemment simples, mais denses.
Angel vit une deuxième existence à bord d’un bateau faisant voile vers les antipodes, toujours maltraité et affamé (comme il se sera tout au long du roman jusqu’à un heureux dénouement). A bord de ce navire, un académicien mathématicien naturaliste, et arriviste , un dessinateur chargé de mettre en images les merveille, plantes, animaux, indigènes et monstres que rencontrera l’expédition, un vénitien aussi savant que sceptique, richissime et mystérieux, un capitaine compétent et autoritaire, un bosco rude, et tout le peuple qui fait vivre le Neptune. On apprend beaucoup de la marine à voile à travers les activités d’Angel, les parties du vaisseau, son approvisionnement, ses hiérarchies, ses avaries et réparations…
La troisième existence est retracée dans les deux derniers tiers du roman, parmi les mystérieux Woanoas, peuple à deux bouches, qui parle avec deux voix et sait vivre avec le froid et le feu, l’air et l’eau, les « gens de l’eau » et ceux de l’air. Et c’est véritablement un livre d’air et d’eau, fluide, miroitant, plein de courants subtils que ce livre. Les descriptions de ce monde pris dans les glaces sont envoutantes, tant lors de la course du Neptune que dans les moments passés chez les Woanoas. Angel est aussi un merveilleux roman initiatique où l’homme et l’animal s’affrontent et se complètent et où la magie et le rêve s’entrelacent.
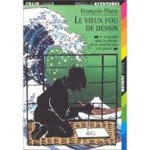 Le roman porte aussi une interrogation sur la représentation par l’image et on retrouve ici des échos du Vieux fou de dessin. L’opposition entre le soin méticuleux du dessinateur naturaliste qui s’interroge sur les limites de son art et la méthode de Corvadoro qui procède par « visions » (« un souffle étrange traversait ses images qui ressemblaient plutôt à des intuitions, des impressions fugaces ou des chimères » p.79) semble refléter les interrogations de l’illustrateur. Enfin, l’épilogue qui pose le problème du mensonge, fiction dans la fiction, plus croyable qu’une vérité qui n’entre pas dans les cadres de pensée, est très subtil, tandis que le destin des cartes qui ont retracé ce voyage, cartes dont on sait l’auteur friand, est un beau clin d’œil.
Le roman porte aussi une interrogation sur la représentation par l’image et on retrouve ici des échos du Vieux fou de dessin. L’opposition entre le soin méticuleux du dessinateur naturaliste qui s’interroge sur les limites de son art et la méthode de Corvadoro qui procède par « visions » (« un souffle étrange traversait ses images qui ressemblaient plutôt à des intuitions, des impressions fugaces ou des chimères » p.79) semble refléter les interrogations de l’illustrateur. Enfin, l’épilogue qui pose le problème du mensonge, fiction dans la fiction, plus croyable qu’une vérité qui n’entre pas dans les cadres de pensée, est très subtil, tandis que le destin des cartes qui ont retracé ce voyage, cartes dont on sait l’auteur friand, est un beau clin d’œil.
Bravo, l’artiste !
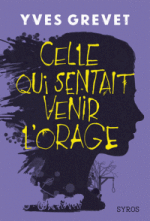 Le cadre de ce roman historique est l’émergence de l’idée de « l’homme criminel », élaborée, après les travaux de Lavater sur la physignomonie au 18e siècle, par Cesare Lombroso (1835-1909) qui a tenté de définir le faciès du criminel.
Le cadre de ce roman historique est l’émergence de l’idée de « l’homme criminel », élaborée, après les travaux de Lavater sur la physignomonie au 18e siècle, par Cesare Lombroso (1835-1909) qui a tenté de définir le faciès du criminel.