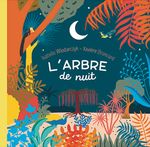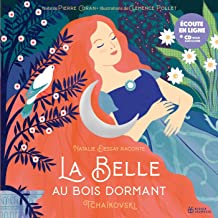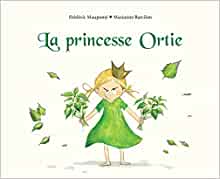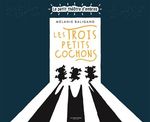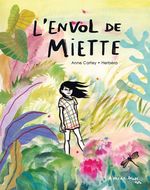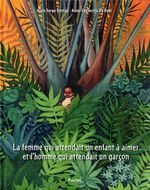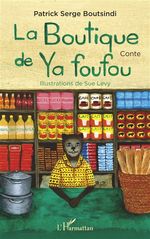Le Citronnier
Ilia Castro – Barroux
D’eux 2023
Comme une ballade sud américaine
Par Michel Driol
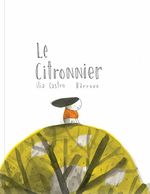 Elle est née dans un pays où la guerre et la dictature font rage. Partout, dans la ville, on peut lire sur des banderoles : el silencio es salud, le silence, c’est la santé. Lorsque ses parents reçoivent des camarades et que, pour la protéger, sa mère l’éloigne de la maison, elle se réfugie en haut du citronnier du jardin. C’est de là-haut qu’elle entend le bruit terribles des bottes, puis celui de la fusillade, encore plus terrible. Alors elle se met à pleurer, et ses larmes deviennent une rivière, accompagnée d’une nuée d’oiseaux blancs, qui coule vers la mer, où un citronnier pourra pousser.
Elle est née dans un pays où la guerre et la dictature font rage. Partout, dans la ville, on peut lire sur des banderoles : el silencio es salud, le silence, c’est la santé. Lorsque ses parents reçoivent des camarades et que, pour la protéger, sa mère l’éloigne de la maison, elle se réfugie en haut du citronnier du jardin. C’est de là-haut qu’elle entend le bruit terribles des bottes, puis celui de la fusillade, encore plus terrible. Alors elle se met à pleurer, et ses larmes deviennent une rivière, accompagnée d’une nuée d’oiseaux blancs, qui coule vers la mer, où un citronnier pourra pousser.
Disons le tout de suite, ce n’est pas un album facile, un album qui édulcore ce que furent les dictatures qui, du Chili à l’Argentine, pays d’origine de l’autrice, ont semé la terreur durant des décennies. Barroux n’hésite pas à montrer des condamnés, yeux bandés, attachés à des poteaux d’exécution, ou à illustrer ce que dit le texte des corps qu’on lançait vivants du haut des hélicoptères. Sans doute faut-il cet ancrage dans le réel pour permettre au jeune lecteur d’entrer dans le côté plus poétique et fantastique de l’album qui passe aussi par l’illustration, comme ces deux ogres soldats prêts à dévorer la petite maison. Dans leur violence expressive, les illustrations de Barroux sont en parfaite harmonie avec la dure âpreté du texte. Deux parties bien distinctes se succèdent dans le récit. Une première très réaliste, qui dépeint la vie d’une famille d’opposants à la dictature, la clandestinité, le secret, les livres qu’on enterre dans le jardin. Vue par les yeux de cette petite fille, c’est toute une vie cachée d’opposants qui est ici décrite, avec la distance de ce regard enfantin qui laisse le jeune lecteur de 2023 imaginer ce qu’a dû être cette vie quasi clandestine avec une fillette. Puis une seconde partie qui bascule clairement du côté du merveilleux, avec ce torrent de larmes qui devient rivière emportant tout sur son passage. Ce qui réunit les deux parties, c’est la poésie du texte, une poésie de l’oralité (l’autrice est conteuse, et cela se sent dans l’écriture), une poésie sensible dès les premières lignes, avec ses anaphores, (silence pour la parole, mais pas vraiment pour les fusillades), ses répétitions, ses comparaisons, son travail sur le rythme. Ce qui les réunit aussi, c’est la figure de l’enfant, anonyme, désignée simplement par Elle, dont le texte donne explicitement quelques caractéristiques (boule de feu, lucide et lumineuse) qui préparent le passage au fantastique. Le passage par le fantastique, la poésie, le conte donne un caractère universel à cette fable. S’y tissent avec subtilité plusieurs fils. D’un côté il y a l’opposition entre la parole et le silence ; parole interdite, dangereuse, possiblement subversive, pourtant magnifiquement incarnée ici dans cet album qui dit haut et fort ce que sont les dictatures et la possibilité d’un autre monde de paix. D’un autre côté, il y l’opposition entre ce régime dictatorial et le torrent de larmes qui peut le submerger. Larmes d’une petite fille, larmes du peuple, c’est ici la belle symbolique de l’eau qui purifie, qui revivifie, qui permettra de se reconstruire ailleurs. Ce passage par l’imaginaire, le symbolique suggère plus qu’il ne démontre que, comme dans les contes, les méchants seront vaincus, balayés par une force plus grande qu’eux, mais laisse le lecteur interpréter la nature de cette force, associée à l’eau et aux oiseaux blancs, une eau capable de nettoyer la guerre sale et obscure évoquée dans la première page.
A la fois très réaliste et très métaphorique, cet album sans concession ne laissera pas indifférents les lecteurs d’aujourd’hui qu’il touchera par sa poésie, ses symboles, et à qui il insufflera, sans aucun didactisme, la force de croire en une vie démocratique fondée sur la liberté de la parole, de l’expression, sur la liberté de lire ce que l’on veut et de vivre en paix.