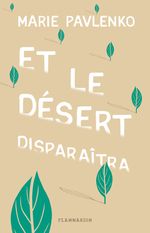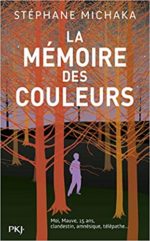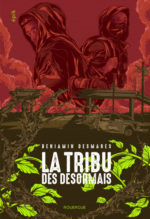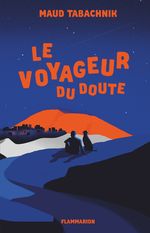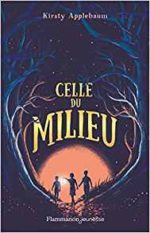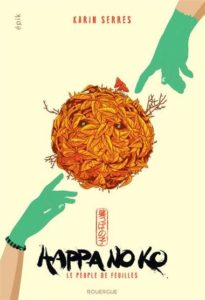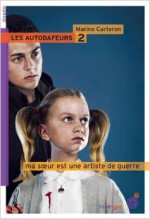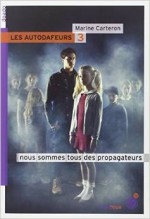Menteurs
François David
Calicot 2021
Peut-on effacer l’histoire ?
Par Michel Driol
 Dans la S.E., la Société Exemplaire, toute trace du passé, en particulier de la Shoah et de l’esclavage a été effacée, réécrite. Les photos sont retouchées, réinterprétées. Pour avoir osé demander en classe pourquoi les cours ne sont plus mixtes, Noémie, l’héroïne est renvoyée de l’école. Chez elle, elle trouve des vieux livres interdits qui lui montrent un autre passé que celui qui est enseigné. Pour avoir refusé de donner ces livres aux autorités, ses parents sont licenciés, puis réduits à l’état de parias. Ils refusent la proposition qui leur est faite d’être réintégrés s’ils reconnaissent leurs « erreurs » concernant le passé. Le livre se clôt pourtant sur une lueur d’espoir car des camarades de classe de Noémie s’étonnent devant la directrice de sa disparition, commencent à douter des mensonges officiels et se préparent à désobéir à leur tour.
Dans la S.E., la Société Exemplaire, toute trace du passé, en particulier de la Shoah et de l’esclavage a été effacée, réécrite. Les photos sont retouchées, réinterprétées. Pour avoir osé demander en classe pourquoi les cours ne sont plus mixtes, Noémie, l’héroïne est renvoyée de l’école. Chez elle, elle trouve des vieux livres interdits qui lui montrent un autre passé que celui qui est enseigné. Pour avoir refusé de donner ces livres aux autorités, ses parents sont licenciés, puis réduits à l’état de parias. Ils refusent la proposition qui leur est faite d’être réintégrés s’ils reconnaissent leurs « erreurs » concernant le passé. Le livre se clôt pourtant sur une lueur d’espoir car des camarades de classe de Noémie s’étonnent devant la directrice de sa disparition, commencent à douter des mensonges officiels et se préparent à désobéir à leur tour.
Bonne idée de rééditer ce livre – paru en 2001 – à l’heure des révisionnismes en tout genre et des fake-news. Il s’agit bien pour l’auteur dans cette dystopie de dénoncer la manipulation et le travestissement des vérités historiques. La société dépeinte est une société tyrannique et totalitaire qui, sous couvert de bienveillance, interdit toute réflexion et pensées personnelles. Comme dans 1984, chacun est surveillé par un état tout puissant et manipulateur, non nommé, sauf par ils… Le récit, incisif, rythmé, dépayse le lecteur avec les codes de la dystopie, en particulier dans le vocabulaire désignant les fonctions, les lieux ou les objets. Pour autant, ce dépaysement conduit le lecteur à s’interroger sur les liens entre le monde décrit et notre monde actuel, et laisse percevoir la permanence de certaines valeurs humaines : le sens de la famille, le souvenir des défunts, et le sens de la révolte et de la désobéissance qui s’avèrent nécessaires pour défendre sa dignité et ses libertés.
Une dystopie dont on ne peut que conseiller la lecture aujourd’hui.