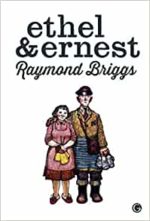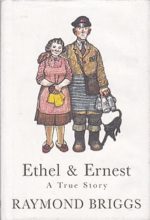LX 18
Kamel Benaouda
Gallimard jeunesse, 2022
Un soldat à l’école des émotions
Par Anne-Marie Mercier
 Voilà une dystopie d’une grande actualité, et d’une extrême simplicité apparente. Elle traite d’un sujet hélas éternel, la guerre, et d’un autre, heureusement tout aussi éternel, celui des émotions et de l’empathie qui fondent l’humanité. Et tout en traitant de ces sujets, elle aborde le pouvoir de la littérature et de l’amour, la solidarité de groupes d’adolescents, les mécanismes de la résistance, de l’exclusion, et bien d’autres.
Voilà une dystopie d’une grande actualité, et d’une extrême simplicité apparente. Elle traite d’un sujet hélas éternel, la guerre, et d’un autre, heureusement tout aussi éternel, celui des émotions et de l’empathie qui fondent l’humanité. Et tout en traitant de ces sujets, elle aborde le pouvoir de la littérature et de l’amour, la solidarité de groupes d’adolescents, les mécanismes de la résistance, de l’exclusion, et bien d’autres.
La simplicité du scenario tient à la nature du groupe d’adolescents auquel appartient le héros, LX18. Ils ont dès la naissance été donnés par leurs familles à la nation pour devenir des machines à combattre, formatés et élevés pour cela dès l’enfance. La guerre finie (toutes les guerres ont une fin, dit-on, sauf celle de 1984, et peut-être celle de ce roman), que faire d’eux ? Contre ceux qui, les considérant comme des monstres, voudraient les éliminer, d’autres proposent un programme de rééducation et de réinsertion : les jeunes gens, garçons et filles, sont envoyés au lycée et doivent se mêler aux autres. Leur « mission » est de s’intégrer le plus vite possible.
Si l’on suit en particulier le héros, d’autres itinéraires apparaissent ; certains sont éliminés rapidement, jugés incapables de s’adapter. La plupart des jeunes gens jouent le jeu avec plus ou moins de succès, certains rusent, d’autres tentent de se donner une mission plus active et arpentent les rues la nuit, en justiciers autoproclamés et vite redoutés, d’autres prennent le « maquis », d’autres enfin, comme LX18 qui passe par toutes ces étapes, découvrent peu à peu les émotions, l’humour, la douceur, en partie grâce à la littérature (il apprend le rôle de Titus, dans la pièce de Racine, Bérénice, pour le club théâtre), en partie grâce à ce qui n’a pas encore pour lui le nom d’amour.
L’évolution progressive du personnage se lit aussi à travers ses mots : c’est lui le narrateur de l’histoire. Comme dans Des Fleurs pour Algernon, le personnage s’ouvre en même temps que s’ouvre et s’enrichit le monde et la langue en lui. Ses certitudes, sa naïveté, sa confiance, puis son désarroi touchent le lecteur qui se prend d’amitié pour ce presque humain, tellement humain…
Kamel Benaouda qui a remporté la troisième édition du prix du premier roman jeunesse en 2018 signe ici un nouvel ouvrage passionnant, original et sensible.