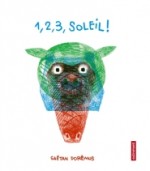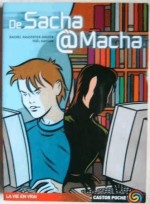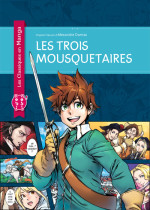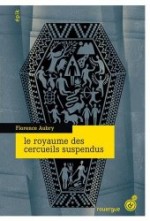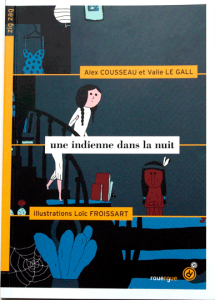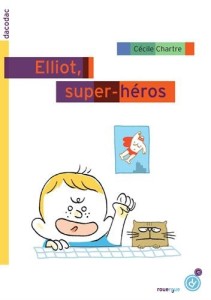Le Pirate et le gardien de phare
Simon Gauthier et Olivier Desvaux
Didier Jeunesse (Le monde animé), 2013
Apprends-moi le bonheur
Par Matthieu Freyheit
Les Vikings d’Ud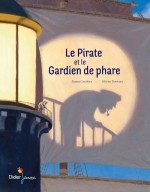 erzo et Goscinny sont bien sortis de leur froid nordique pour contraindre Goudurix à leur enseigner la seule des choses qu’ils ignorent : la peur. Pourquoi un pirate ne viendrait-il pas réclamer de ce gardien de phare un enseignement semblable : le bonheur ? C’est que le gardien, satisfait de pêcher son poisson et de bourrer sa pipe, se proclame lui-même, devant les flots, l’homme le plus heureux de la mer. Jusqu’à… jusqu’à ce qu’il soit contraint d’envoyer un appel au secours, dans l’espoir de trouver un remplaçant pour alléger son fardeau. Mais la libération ne vient pas seule : si un jeune homme vient bel et bien prêter main forte au gardien, entretenant sa lumière, l’ombre elle-même ne tarde pas à se montrer sous les traits du pirate, qui dans son ignorance du bonheur devient à son tour une figure du capitaine maudit d’un certain Hollandais Volant. Le gardien et son jeune compagnon trouveront-ils les réponses aux questions posées par ce témoin de la nuit ? C’est qu’ici se répondent, dans la même poésie, scènes de jour et scènes de nuit, à la lumière du soleil et celle de la lune, toutes deux reproduites par celle du phare.
erzo et Goscinny sont bien sortis de leur froid nordique pour contraindre Goudurix à leur enseigner la seule des choses qu’ils ignorent : la peur. Pourquoi un pirate ne viendrait-il pas réclamer de ce gardien de phare un enseignement semblable : le bonheur ? C’est que le gardien, satisfait de pêcher son poisson et de bourrer sa pipe, se proclame lui-même, devant les flots, l’homme le plus heureux de la mer. Jusqu’à… jusqu’à ce qu’il soit contraint d’envoyer un appel au secours, dans l’espoir de trouver un remplaçant pour alléger son fardeau. Mais la libération ne vient pas seule : si un jeune homme vient bel et bien prêter main forte au gardien, entretenant sa lumière, l’ombre elle-même ne tarde pas à se montrer sous les traits du pirate, qui dans son ignorance du bonheur devient à son tour une figure du capitaine maudit d’un certain Hollandais Volant. Le gardien et son jeune compagnon trouveront-ils les réponses aux questions posées par ce témoin de la nuit ? C’est qu’ici se répondent, dans la même poésie, scènes de jour et scènes de nuit, à la lumière du soleil et celle de la lune, toutes deux reproduites par celle du phare.
L’album fonctionne certes à partir de motifs qui sont autant de clichés de contes, mais qu’importe : l’image est superbement travaillée, peuplée d’idées elles-mêmes lumineuses qui font de cet album un objet précieux, nourri de sentiments qui valent d’être mis en récit. Simon Gauthier, lui-même conteur célèbre et par ailleurs fondateur d’un festival de contes à Tadoussac (Québec), alimente son récit d’une poésie maritime et céleste, que le talent (immense) d’Olivier Desvaux restitue avec un goût rare.