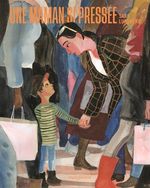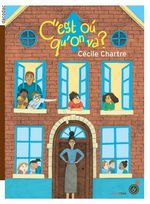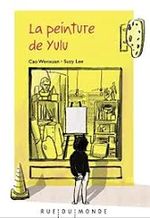Monstres
Texte de Stéphane Servant – Images de Nicolas Zouliamis
Thierry Magnier 2023
Freaks…
Par Michel Driol
 Le narrateur habite dans un village perdu avec ses parents. Un peu différent, parce qu’un oiseau aurait échangé son cœur avec le sien dans le ventre de sa mère, il est victime de harcèlement. Un jour arrive un cirque, qui prétend présenter un monstre, survivant d’un peuple primitif… Sans corne ni queue, dit le texte, tandis que l’image montre un enfant et fait découvrir alors le public, une belle collection de visages cornus, difformes, tous différents… Surmontant sa peur, le narrateur donne à manger au monstre qui se met à chanter une chanson qu’il ne comprend pas, mais l’illustration montre un enfant dans une famille ordinaire… Lorsque le monstre parvient à s’échapper, c’est dans le poulailler du narrateur qu’il trouve refuge, et tous deux font face aux autres enfants.
Le narrateur habite dans un village perdu avec ses parents. Un peu différent, parce qu’un oiseau aurait échangé son cœur avec le sien dans le ventre de sa mère, il est victime de harcèlement. Un jour arrive un cirque, qui prétend présenter un monstre, survivant d’un peuple primitif… Sans corne ni queue, dit le texte, tandis que l’image montre un enfant et fait découvrir alors le public, une belle collection de visages cornus, difformes, tous différents… Surmontant sa peur, le narrateur donne à manger au monstre qui se met à chanter une chanson qu’il ne comprend pas, mais l’illustration montre un enfant dans une famille ordinaire… Lorsque le monstre parvient à s’échapper, c’est dans le poulailler du narrateur qu’il trouve refuge, et tous deux font face aux autres enfants.
Evoquons d’abord la forme de ce roman graphique, dont la couverture, à la fois noire et dorée, évoque les romans populaires de la fin du XXème siècle. Un enfant, dont on ne voit pas le visage, qui porte un sac à dos en forme de monstre, et s’avance dans une forêt inquiétante, et, autour, dans l’encadrement doré, les éléments du cirque, roulottes, chapiteaux, lumières… Ensuite, c’est une formidable conjonction du texte et de l’image qui fait avancer l’action. Jusqu’à la découverte du monstre, au cours de la représentation, rien, ni dans le texte, ni dans l’image, n’est montré quant à la réalité des habitants du village. Puis c’est la façon dont la chanson du « monstre », reprise par trois fois, est traitée seulement par les images, pour illustrer l’histoire somme toute banale d’une dispute des parents et d’une fugue. Belle réussite narrative donc, entre le crayonné noir du dessin donnant à voir un monde bien sombre et un texte donnant à entendre la voix d’un garçon sensible et différent !
C’est donc un roman qui parle de différence et pose la question du regard posé sur l’autre et de la monstruosité, dans un univers qui touche à l’univers du cirque. On est toujours le monstre de quelqu’un, de celui qui ne nous ressemble pas. Le narrateur est différent pas tant par son visage (celui d’un chat) que par son pacifisme, sa façon de contempler la nature dans un univers de brutes épaisses et sans cœur. Le monstre (qui partage avec le narrateur son nom, Otto) n’est qu’un enfant recueilli durant sa fugue par un Monsieur Loyal trop pressé d’en faire une bête de cirque, entre des sœurs siamoises et un homme à quatre jambes. On est très proche de l’univers de Tod Browning et bien loin de l’univers brillant et fascinant du cirque. C’est un roman qui parle d’amitié entre deux êtres différents et pourtant si semblables, qui parle d’entraide et de compréhension mutuelle, le narrateur aidant le monstre à regagner sa maison. C’est un roman qui parle de liberté et de fraternité, car les cages ne sont faites que pour être brisées.
Qu’est-ce qui est monstrueux dans ce roman ? Sans doute moins les personnages tels qu’ils sont représentés que les actes que certains commettent. Enlèvement d’un enfant qu’on exhibe, harcèlement d’un autre, chasse à l’enfant, peur de l’autre, voyeurisme au cirque, violences diverses… Amour et amitié sont magnifiquement illustrés par la première et dernière image : le nounours du narrateur de la première image est rejoint par l’homme de fer du monstre sur le rebord de la fenêtre. Beau symbole du dépassement des différences.
Un roman graphique situé dans un univers sombre et proche du fantastique, qui emploie les voies de l’imaginaire pour évoquer la question de la différence et de l’amitié. Monstrueusement humain.