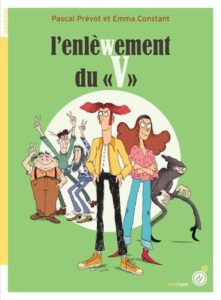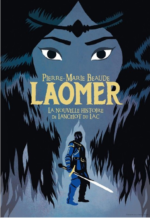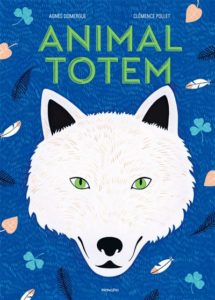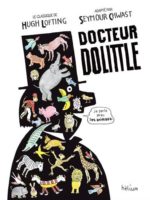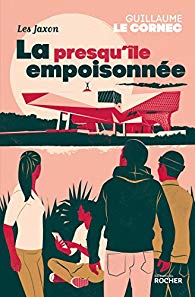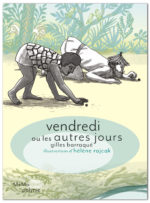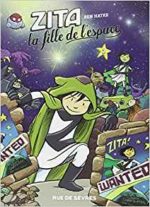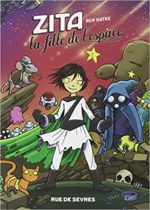Le Célèbre Catalogue Walker et Down : comment nous sommes devenus riches avec trois dollars
Davide Morosinotto
Traduit (italien) par Marc Lesage
L’école des loisirs, 2018
Du Bayou à la ville, aventures de sympathiques garnements
Par Anne-Marie Mercier
 Roman de formation, road trip, roman policier, aventures de bande, découverte des USA du sud au nord… Ce roman fleuve – qui mérite doublement ce titre vu que les héros partent du Bayou puis remontent le Mississippi jusqu’à Chicago –, est un mélange de tout cela, à quoi on pourrait ajouter le roman populaire, avec ses mystères, ses ombres et lumières, ses orphelins et ses maisons de correction, le roman picaresque avec ses rebondissements, ses personnages louches et ses innocents, ses coïncidences, etc.
Roman de formation, road trip, roman policier, aventures de bande, découverte des USA du sud au nord… Ce roman fleuve – qui mérite doublement ce titre vu que les héros partent du Bayou puis remontent le Mississippi jusqu’à Chicago –, est un mélange de tout cela, à quoi on pourrait ajouter le roman populaire, avec ses mystères, ses ombres et lumières, ses orphelins et ses maisons de correction, le roman picaresque avec ses rebondissements, ses personnages louches et ses innocents, ses coïncidences, etc.
Le principe est original : dans la première moitié du roman, les jeunes héros du bayou font diverses découvertes jalonnées par des pages du fameux catalogue mythique (des planches en noir et blanc sont reproduites : hameçon, poêle, portefeuille, revolver, montre…) Trouvant par hasard quelques sous, les quatre copains passent commande d’un revolver. Le hasard d’une erreur d’expédition leur fait recevoir une montre cassée dont ils découvriront que les dirigeants du catalogue veulent à tout prix la récupérer. Elle les place en travers du chemin d’un individu dangereux auquel ils échappent de justesse. Ils prennent la route, « montent » à la grande ville avec tous les moyens de transports possibles à l’époque (on est au temps des bateaux à aube, celui de Tom Sawyer et Huck Finn) pour réclamer ce qu’ils croient être une récompense. Ils font au long du chemin toutes sortes de rencontres (surtout des « mauvaises rencontres ») et finissent par se faire détectives dans une sombre histoire de meurtre et de spoliation.
Héros improbables, un peu handicapé pour l’un, bien cabossée de la vie pour l’autre, un troisième qui ne doute de rien, un quatrième qui se croit un don de chaman du bayou, ils ont une solidarité amicale à toute épreuve, un sens de la débrouillardise exceptionnel, des talents de bricoleurs, beaucoup d’humour, un sale caractère, et ils s’amusent beaucoup tout au long de cette aventure. Et nous aussi !