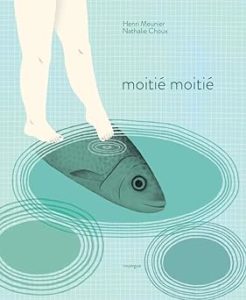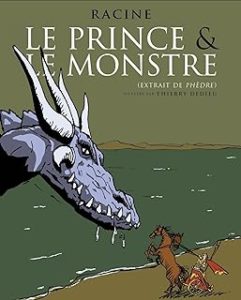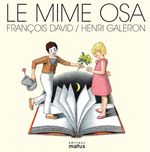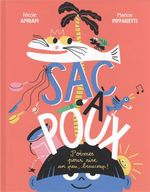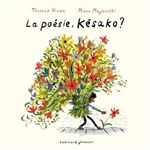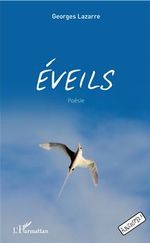Fraîcheur !
Thierry Cazals – illustrations Csil
Editions du Pourquoi pas ?? 2024
Autour des haïkus d’Issa
Par Michel Driol
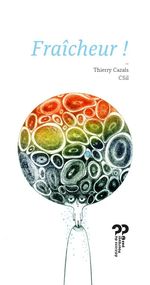 Ce recueil de poèmes s’ouvre et se ferme par deux textes qui évoquent la canicule. 40° le soir, et 40° le matin. Dans cette situation, quelles oasis de fraicheur chercher ? Celles de la poésie, et, tout particulièrement, celle des haïkus d’Issa. Un avant-propos précise qu’Issa Kobayashi était un poète japonais des XVIII-XIX ème siècle. Les textes de Thierry Cazals commentent, illustrent, contextualisent de façon poétique les haïkus d’Issa, ébauchant de ce fait comme un art poétique.
Ce recueil de poèmes s’ouvre et se ferme par deux textes qui évoquent la canicule. 40° le soir, et 40° le matin. Dans cette situation, quelles oasis de fraicheur chercher ? Celles de la poésie, et, tout particulièrement, celle des haïkus d’Issa. Un avant-propos précise qu’Issa Kobayashi était un poète japonais des XVIII-XIX ème siècle. Les textes de Thierry Cazals commentent, illustrent, contextualisent de façon poétique les haïkus d’Issa, ébauchant de ce fait comme un art poétique.
Ce sont donc deux discours qui se font écho dans ce recueil. D’un côté, huit haïkus d’Issa, qui ont presque tous en commun les mots frais ou fraicheur : l’évocation d’instants de repos, dans la nature, dans la solitude, au calme. De l’autre, beaucoup plus développé, le discours de Thierry Cazals sur le haïku, sur la poésie, comme une leçon de vie, adressé à un « tu » non identifié, lecteur potentiel, disciple… Discours sur l’importance du silence qui s’oppose aux publicités tapageuses, discours sur la fraicheur de la poésie opposée au réchauffement climatique, discours sur l’opposition entre le temps d’Issa, sans congélateur ni ventilateur et notre époque… Ce qui se dessine alors, comme en filigrane, c’est un art poétique, une invitation au regard sur les choses, sur la nature, sur l’importance de laisser les mots résonner sans chercher à être trop explicite, à en dire trop. Se dessine aussi la figure du poète, incarné ici par Issa, un paysan pauvre, amateur de siestes, farceur, mais vivant au contact avec la nature. Cet art poétique, qui donne quelques clefs pour rendre sensible la nature du haïku et sa relation avec la nature, pose les questions fondamentales de la beauté véritable, et surtout de l’importance de sentir et d’être plus que d’avoir. Comme en écho à Oscar Wilde, cité dans l’avant-propos, ou à la chanson d’Allain Leprest Combien ça coute ? arrive naturellement la question de la valeur inchiffrable des instants éphémères qui donnent naissance au haïku opposés au prix marchand des objets. Sans rien théoriser, sans vocabulaire complexe, la force de ce texte est de conduire chacun à s’interroger, à l’époque du réchauffement climatique, à une époque où l’on voudrait nous faire croire que le bonheur réside dans la possession, à une époque foncièrement matérialiste, sur la conscience de quelque chose d’autre, plus fondamental, plus essentiel, dont la poésie est le nom…
Les illustrations de Csil jouent du contraste des couleurs – chaudes et froides, pour représenter un univers varié, tantôt japonisant avec le bonzaï, tantôt de fantaisie avec l’escargot escaladant le volcan, un univers qui ouvre aussi l’imaginaire vers un ailleurs.
Initiation au haïku, art poétique, cet ouvrage invite à chercher un peu de bonheur et fraicheur dans un monde en surchauffe, et à les trouver dans le lien avec la nature, comme source d’émerveillement infini.