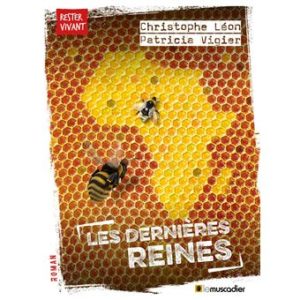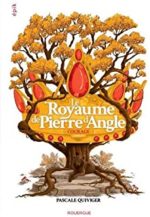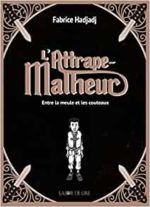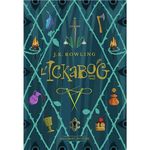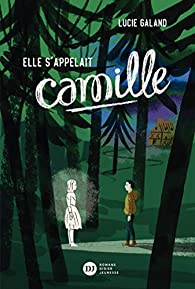L’Ickabog
J.K. Rowling
Gallimard Jeunesse 2020
La petite fille dans les eaux boueuses du marécage…
Par Michel Driol
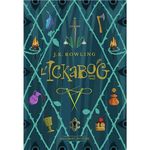 Cornucopia est un véritable royaume de Cocagne, dirigé par son roi Fred sans Effroi, si l’on omet les marécages du Nord où sévit l’Ickabog, un monstre légendaire auquel personne ne croit. Jusqu’au jour où un berger annonce au roi qu’il l’a vu. Afin d’accroitre sa popularité, le roi lance une désastreuse campagne militaire contre le monstre : désastreuse car elle révèle la lâcheté du roi et de ses deux amis, dont l’un tue, par manque de sang-froid, le chef de la garde. Comment cacher au roi et à la population cet épisode peu glorieux ?
Cornucopia est un véritable royaume de Cocagne, dirigé par son roi Fred sans Effroi, si l’on omet les marécages du Nord où sévit l’Ickabog, un monstre légendaire auquel personne ne croit. Jusqu’au jour où un berger annonce au roi qu’il l’a vu. Afin d’accroitre sa popularité, le roi lance une désastreuse campagne militaire contre le monstre : désastreuse car elle révèle la lâcheté du roi et de ses deux amis, dont l’un tue, par manque de sang-froid, le chef de la garde. Comment cacher au roi et à la population cet épisode peu glorieux ?
Ecrit en parallèle de la saga Harry Potter, repris à l’occasion du confinement, L’Ickabog laissera peut-être un peu sur leur faim ceux dont l’horizon d’attente a été façonné par Harry Potter, sa complexité narrative, ses différents niveaux de lecture. On a affaire ici à un conte, assumé comme tel dans son énonciation : une conteuse s’adressant de façon directe à son public, dans une langue particulièrement simple. Comme toujours avec l’autrice qui maitrise le rythme, l’imaginaire, la progression narrative, les rebondissements, le livre est un véritable page-turner que l’on lit d’une traite. Mais qu’on ne s’y trompe pas : ce conte parle de notre époque, des mensonges d’état, des fake-news, de la façon de tromper le peuple par la peur afin d’instaurer un pouvoir autoritaire et personnel. C’est bien de la naissance du fascisme qu’il est question ici, de la façon d’instaurer une dictature, du rôle de l’information et de son contrôle dans ces phénomènes. Comme tout conte, il a sa part de manichéisme : un roi sans envergure, préoccupé plus par son apparence que par le réel souci de l’Etat, deux amis caricaturaux, l’un par sa maigreur, l’autre par sa grosseur, qui vont prendre le pouvoir afin de s’enrichir, véritables esprit du mal, et les gens du peuple, plutôt caractérisés par la bonté, en particulier une fillette, Daisy, qui sera celle qui sauve le pays. Plus finement, cette « fracture » entre le bien et le mal n’est pas sociale : tous les nobles présents ne sont pas mauvais, et dans les gens du peuple, il y a aussi des arrivistes, des mouchards…
Autant que politique, la portée du récit est humaniste : il s’agit de mieux connaitre ceux que l’on prend pour des adversaires, de trouver le moyen de s’allier avec eux pour être plus fort dans un monde plus juste. Il y a là à la fois affaire de sensibilité et de lucidité, en particulier portée par Daisy, véritable héroïne du récit. Il y a là aussi toute une réflexion quasi métaphysique sur ce qu’est donner la vie, sur la façon dont une génération doit mourir pour que l’autre vive, sur les conditions dans lesquelles les premiers instants de la vie sont décisifs sur la façon de se comporter et de voir le monde.
Un récit dans lequel on trouvera l’univers parallèle et de l’autrice dans les noms des villes, des pâtisseries, afin de mieux faire réfléchir le lecteur, même jeune, sur le monde dans lequel nous vivons.
 Les auteurs de Science-fiction ont-ils du flair pour mettre en scène avec un peu d’avance nos pires cauchemars ou tout simplement le nombre des fléaux est-il si limité que forcément ils tombent parfois juste ? En remettant au goût du jour de vielles angoisses, Marine Carteron traite du thème de manipulations louches, d’épidémies et de catastrophes annoncées.
Les auteurs de Science-fiction ont-ils du flair pour mettre en scène avec un peu d’avance nos pires cauchemars ou tout simplement le nombre des fléaux est-il si limité que forcément ils tombent parfois juste ? En remettant au goût du jour de vielles angoisses, Marine Carteron traite du thème de manipulations louches, d’épidémies et de catastrophes annoncées. 2015. Son ancrage dans la SF noire se confirme ici avec un roman haletant, faisant alterner les points de vue de différents personnages qui ne se retrouvent qu’en fin de roman (technique que l’on retrouve dans Game of Thrones, etc., aussi bien à l’écrit qu’à l’écran). L’arrière-plan du roman, fait d’annonce d’épidémies et de réveils de volcans, le rattache à une pensée de l’apocalypse que l’on retrouve dans beaucoup de romans récents (voir la série U4). On l’aura compris, ce roman efficace est dans l’air du temps, et plus encore. »
2015. Son ancrage dans la SF noire se confirme ici avec un roman haletant, faisant alterner les points de vue de différents personnages qui ne se retrouvent qu’en fin de roman (technique que l’on retrouve dans Game of Thrones, etc., aussi bien à l’écrit qu’à l’écran). L’arrière-plan du roman, fait d’annonce d’épidémies et de réveils de volcans, le rattache à une pensée de l’apocalypse que l’on retrouve dans beaucoup de romans récents (voir la série U4). On l’aura compris, ce roman efficace est dans l’air du temps, et plus encore. »