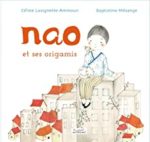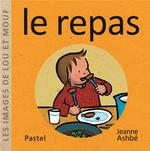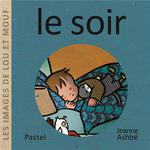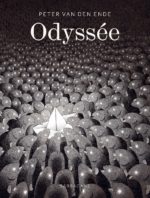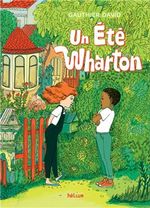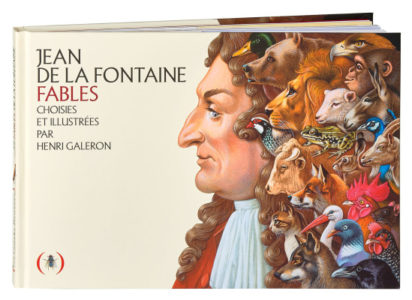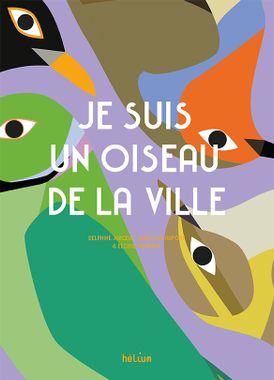La Longue route de Little Charlie
Christopher Paul Curtis
Ecole des loisirs – Medium – 2021
Le chemin se construit en marchant
Par Michel Driol
 Caroline du Sud, 1858, Fils d’un métayer pauvre, à 12 ans, Little Charlie voit son père mourir sous ses yeux en abattant un arbre. Le contremaitre de la plantation, Captain Buck, vient réclamer de l’argent que lui devait le père, et l’oblige à l’accompagner dans le nord, à Detroit, rechercher un couple d’esclaves fugitifs.
Caroline du Sud, 1858, Fils d’un métayer pauvre, à 12 ans, Little Charlie voit son père mourir sous ses yeux en abattant un arbre. Le contremaitre de la plantation, Captain Buck, vient réclamer de l’argent que lui devait le père, et l’oblige à l’accompagner dans le nord, à Detroit, rechercher un couple d’esclaves fugitifs.
C’est d’abord un roman historique, qui retrace avec réalisme la situation des Etats Unis au milieu du XIXème siècle. D’un côté les Etats du Sud, esclavagistes, de l’autre les Etats du Nord, qui ont aboli l’esclavage, et où nombre de Noirs vont se réfugier sans y être forcément bien accueillis. Au-delà, le Canada, terre d’exil et d’accueil. C’est un roman qui parle aussi des pauvres blancs, obligés de travailler sans posséder leurs terres, qui ne bénéficient d’aucune instruction. Le roman est très documenté et très précis sur les conditions de vie, les supplices infligés aux esclaves, le racisme ambiant et sa façon d’imprégner les mentalités, les jugements, la vision du monde. C’est ensuite un roman d’initiation, au cours duquel Little Charlie découvre le monde qui l’entoure loin de sa ferme natale : la grande ville, Detroit, mais aussi le chemin de fer, la réalité de la vie des Noirs de cette époque, la cruauté des possédants et de certains représentants de la loi, qui l’amèneront peu à peu à changer sa conception du monde pour une vision plus humaniste et fraternelle. C’est enfin un roman psychologique, qui fait le portrait sans concession d’un des personnages les plus sombres de la littérature de jeunesse, la contremaitre, Captain Buck. Raciste, sadique, sans parole, menteur, on cherche quelle qualité il peut avoir… Il incarne à l’outrance la violence avec laquelle les Blancs ont traité les Noirs tant dans son comportement que dans ses pensées. Cette violence, omniprésente dans le roman, rend encore plus sensible le côté odieux du racisme. Un mot sur l’auteur, Christopher Paul Curtis, premier homme Afro-américain à avoir remporté la Médaille Newbery, prestigieux prix littéraire américain de littérature jeunesse, pour son second roman, Bud, Not Buddy.
Un roman historique qui se lit d’une traite, et sait rendre sensible la condition des Noirs et des pauvres Blancs du Sud des Etats Unis au milieu du XIXème siècle.