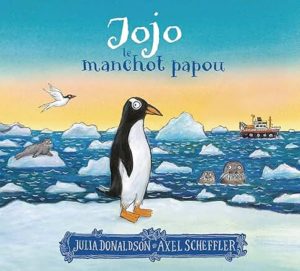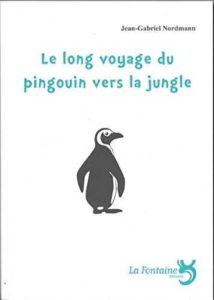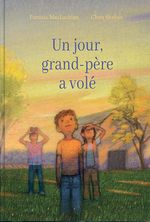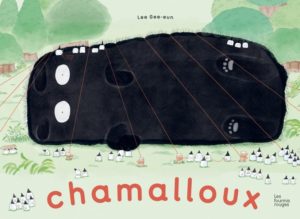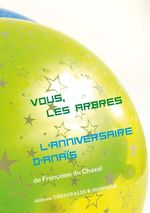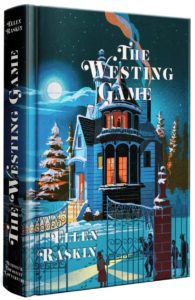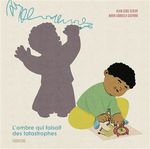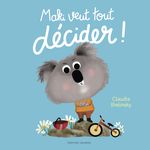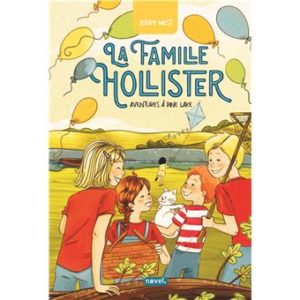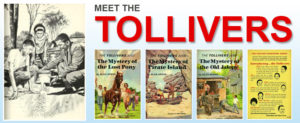Le Trésor au bout de la branche
Didier Lévy – Marie Mignot
Sarbacane 2025
Un jeu de rôles…
Par Michel Driol
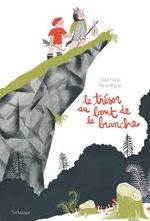 Frère et sœur, Gus et Lola décident de jouer au Loup et au Petit Chaperon Rouge. Mais qui pour faire le Loup ? Garçon ou fille ? Il faut aller demander à la Grande Louve. En attendant, le sort désigne le garçon, bien mécontent. C’est décidé, plutôt que d’être Chaperon Rouge, il sera chasseur avec une branche qui ressemble à un fusil. Bien inefficace face aux oiseaux ! Mais Lola montre que la branche peut devenir baguette de sourcier qui les entraine sur une colline d’où ils peuvent enfin voir la Grande Louve et ses louveteaux. Après le gouter, les deux enfants échangent des parties de leurs costumes.
Frère et sœur, Gus et Lola décident de jouer au Loup et au Petit Chaperon Rouge. Mais qui pour faire le Loup ? Garçon ou fille ? Il faut aller demander à la Grande Louve. En attendant, le sort désigne le garçon, bien mécontent. C’est décidé, plutôt que d’être Chaperon Rouge, il sera chasseur avec une branche qui ressemble à un fusil. Bien inefficace face aux oiseaux ! Mais Lola montre que la branche peut devenir baguette de sourcier qui les entraine sur une colline d’où ils peuvent enfin voir la Grande Louve et ses louveteaux. Après le gouter, les deux enfants échangent des parties de leurs costumes.
Nombreux sont les albums contemporains qui abordent la question du genre,. Celui-ci l’aborde justement à partir d’un jeu de rôles en revisitant, de surcroit, à différents niveaux le Petit Chaperon Rouge. Les deux personnages du conte sont-ils genrés ? Sans nul doute, pour le garçon. Mais pas pour la fille. Le loup est-il le méchant ou, comme ici, le Loup protecteur de la forêt et de la nature, dans la bouche de la fillette, la Grande Louve majestueuse et protectrice de ses louveteaux. On le voit, c’est la figure du loup qui est ici métamorphosée en un être positif, du côté de la nature, et non contre les humains. Par ailleurs, l’album montre un jeu qui n’a rien de figé, et dans lequel tout se transforme progressivement, au gré de l’imagination des enfants. Le Chaperon Rouge devient chasseur rouge, le bâton devient fusil puis baguette, et les deux enfants glissent progressivement vers des rôles moins marqués, allant jusqu’à devenir des êtres hybrides, mi loup, mi chaperon à la fin, façon de transcender ou d’abolir leurs différences. L’album pose et oppose aussi deux enfants. Le garçon, force de proposition du jeu au début, devient ronchon, bougon, c’est le texte qui le souligne, lorsqu’il perd au début, mécontent de son fusil-bâton, mais aussi souvent impressionné par sa sœur, par la nature : un personnage en nuances, mais moins valorisé par le texte que sa sœur. C’est elle qui mène le jeu, semble grandie aux yeux de son frère, s’avère plus fine et pleine de ressources que lui… Façon sans doute moins de montrer des stéréotypes masculin et féminin que de dire et d’affirmer les différences de perception, de caractère entre les deux pour aller vers l’alliance finale, la (ré)conciliation autour du gouter, la fascination pour la grande louve, ce que le texte souligne avec ces phrases en ils, où ils agissent de concert. Quant à la branche, titre de l’album, objet transitionnel dans l’album, elle finit parmi les collections de Gus, comme une manière de garder trace de cette expédition initiatique dans la forêt. Ajoutons non pas l’absence des parents, nécessaire pour que des enfants soient libres dans la forêt, mais la présence discrète d’un papa… aux fourneaux, d’une maman coupant du bois, autre façon de parler de la question des stéréotypes.
Les illustrations sont à la fois expressives et allant à l’essentiel. Qu’on soit dans le joyeux désordre de la chambre, dans la cuisine bien rangée (ou pourtant, mystère, trône un hibou…), ou dans la forêt, le visage des enfants en dit long sur leurs émotions… Tout se joue en deux couleurs, le vert et le rouge, sur des fonds tantôt très blancs, tantôt très noir : noir du mystère, de l’inconnu, de la forêt au milieu duquel se détache dramatiquement le blanc des enfants, du ciel. Beau contraste et belles oppositions entre des couleurs qui , elles aussi, disent la complémentarité des genres.
Un album tout en nuances, pour évoquer avec douceur et à hauteur d’enfants qui jouent, se promènent, la question du genre, et pour montrer comment il est possible de se respecter et de partager ensemble des moments de plaisir et de joie, dans l’harmonie.