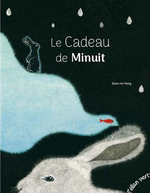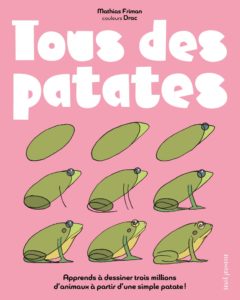Polaire le petit renard de feu
Mathilde Joly
Saltimbanque 2025
Un périple vers l’Arctique
Par Michel Driol
 Polaire, un petit renard blanc, s’enfuit du zoo où il est enfermé, pour retrouver son milieu naturel. En chemin, il rencontre un renard roux, qui lui indique qu’il doit continuer sa route vers le nord, comme les oies sauvages qui passent. Après avoir échappé à un chasseur, il retrouve dans un pays tout enneigé une meute d’autres renards blancs, et admire les aurores boréales.
Polaire, un petit renard blanc, s’enfuit du zoo où il est enfermé, pour retrouver son milieu naturel. En chemin, il rencontre un renard roux, qui lui indique qu’il doit continuer sa route vers le nord, comme les oies sauvages qui passent. Après avoir échappé à un chasseur, il retrouve dans un pays tout enneigé une meute d’autres renards blancs, et admire les aurores boréales.
En format paysage, avec de grandes illustrations en double page, voilà un album qui donne à suivre un parcours vers les grands espaces, vers la liberté, vers les racines. Le récit fait silence sur les conditions de libération de Polaire, mais l’illustration montre des cages ouvertes d’où les animaux s’enfuient. Ce qui suit est d’abord le récit d’une découverte du monde, un monde inconnu pour Polaire, qui n’a connu que le zoo. Découverte de la ville, découverte de la forêt, découverte de la neige, découverte des dangers que représente l’homme qui chasse, découverte des autres, presque semblables comme le renard roux, ou bien différents comme les animaux du grand Nord. C’est aussi la découverte de soi, portée par le texte avec ses formes interrogatives, comme autant de signes indiquant l’attitude de curiosité inquiète de Polaire face à ce monde nouveau pour lui. Ce qui guide Polaire, et qui est signalé au début et à la fin du récit, c’est son instinct qui lui permet de retrouver les racines qu’il n’a pas connues. C’est enfin un récit d’émancipation, permettant au petit renard de sortir des cages, de sortir du monde des hommes, pour retrouver une nature sauvage et splendide, symbolisée par les aurores boréales finales. A noter que Polaire n’est pas seul dans cette aventure : est présent, sur toutes les pages, un petit animal que le texte a la malice de ne signaler que vers la fin, invitant ainsi le lecteur qui aurait été inattentif à revenir en arrière, et à reparcourir l’album à sa recherche… A la fin du texte, un petit texte documentaire indique la liaison effectuée par les légendes nordiques entre le renard blanc et les aurores boréales. Les illustrations, peinture et papiers découpés, créent un univers coloré, plein de douceur. A noter en particulier deux illustrations, très frappantes, l’envol des oies vers les nord, une composition presque abstraite dans sa façon de montrer cette migration sur un fond de ciel blanc, et le personnage du chasseur, double page qui oblige à retourner le livre en position verticale, montrant par les couleurs toute la noirceur de ce personnage inquiétant, tandis que, dans l’obscurité, brillent les yeux des animaux traqués, invisibilisés.
Un album poétique, hymne à la nature, à la vie sauvage, au respect des différences, dont le héros poursuit sa quête vers ses origines avec opiniâtreté et détermination, tout en restant bien fragile et inquiet quant à la façon dont les autres vont le recevoir.
 Noël approche : la publication de jolis coffrets est une opportunité, même si l’on tente de résister contre ce qu’on appelle les « produits dérivés », pour faire découvrir aux jeunes enfants des classiques de la littérature de jeunesse.
Noël approche : la publication de jolis coffrets est une opportunité, même si l’on tente de résister contre ce qu’on appelle les « produits dérivés », pour faire découvrir aux jeunes enfants des classiques de la littérature de jeunesse.