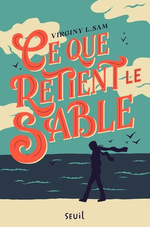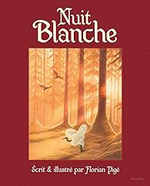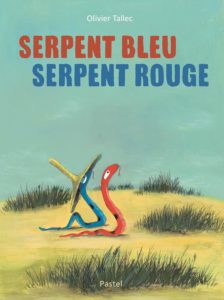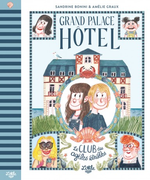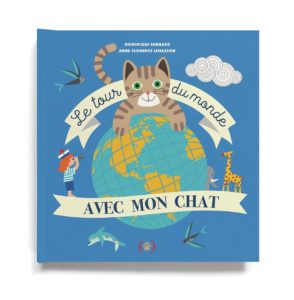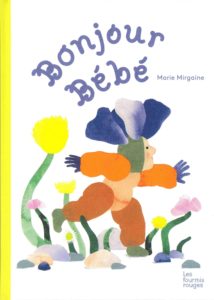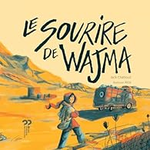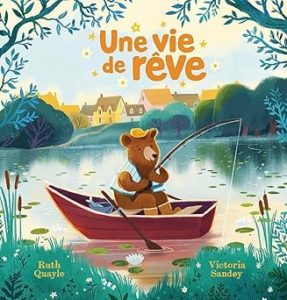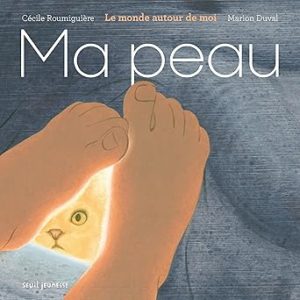La Nuit des oies
Juliette Adam – Violaine Costa
Flammarion Jeunesse 2025
Pour en finir avec les traditions…
Par Michel Driol
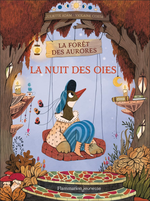 Dans les forêt des Aurores, avant la grande migration, les oies sauvages préparent la fête. Mais si les oies peuvent aider aux préparatifs, seuls les jars ont le droit de monter sur scène. Ce qui n’est pas du gout d’Olivia, qui, aidée de ses amis, Paulette la grenouille, Cerise l’écureuil et Topinambour le sanglier, va imaginer un spectacle dont elle sera la vedette, afin de montrer la stupidité des préjugés et stéréotypes.
Dans les forêt des Aurores, avant la grande migration, les oies sauvages préparent la fête. Mais si les oies peuvent aider aux préparatifs, seuls les jars ont le droit de monter sur scène. Ce qui n’est pas du gout d’Olivia, qui, aidée de ses amis, Paulette la grenouille, Cerise l’écureuil et Topinambour le sanglier, va imaginer un spectacle dont elle sera la vedette, afin de montrer la stupidité des préjugés et stéréotypes.
Voilà un roman illustré assez irrésistible, par son humour, sa fantaisie, son sens du rythme et des personnages. C’est Olivia la narratrice, et elle regarde le monde avec le sentiment d’une injustice faite aux oies, mais avec aussi un grand sens des relations et de l’amitié. Elle ne s’en laisse pas conter quand un jars tente de la draguer ! Le récit et les illustrations se complètent pour créer un univers dans lequel les animaux vivent en bonne intelligence, autour d’un lac, habitent dans des maisons très humanisées, pleines de couleurs et de détails croustillants.
La question des traditions, du féminisme, de l’émancipation et de la lutte contre les discriminations de genre est abordée avec finesse et sur un arrière-plan historique que les adultes médiateurs de ce livre comprendront. Il est question de théâtre, d’une histoire fortement inspirée par Shakespeare, la Nuit des rois, réinventée par Olivia. Le monde des oies, qui interdit aux femelles de monter sur scène, est un lointain écho de l’époque shakespearienne, où les rôles de femmes étaient tenus par les hommes. Mais c’est à hauteur d’enfant que se développe la réflexion d’Olivia, qui remet en cause les superstitions et croyances relatives à la prétendue sensibilité des oies, à la supériorité des jars. Ces derniers, de fait, produisent sur scène des récits eux-mêmes très stéréotypés, qui se répètent d’année en année sans aucune inventivité, au contraire de la proposition d’Olivia. Pour autant, le récit n’a rien de manichéen, de par le personnage du sanglier, mais aussi de l’amoureux d’Olivia qui se révélera beaucoup moins borné qu’on pouvait le penser.
Le texte et les illustrations nous plongent dans un automne plein de magie, dans un monde du spectacle et de la fête qui se veut inclusive et tolérante. Preuve bien réjouissante qu’il est possible de changer les mentalités, grâce à l’amitié et à la solidarité ! On attend la suite de cette série, intitulée la Forêt des Aurores, afin de retrouver ces personnages pleins de vie, le regard acéré d’Olivia, sa fougue, son énergie, et son inventivité !