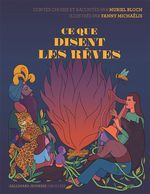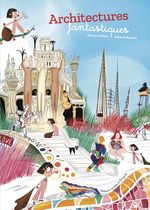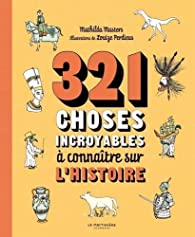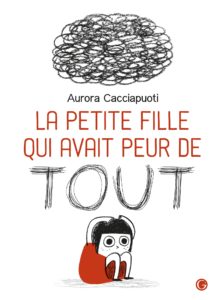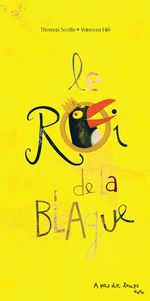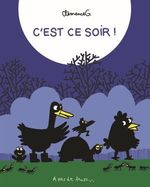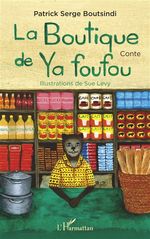Un Si petit jouet
Irène Cohen-Janca, Brice Postma Uzel
Éditions des éléphants, 2022
Comment parler de l’enfance dans la guerre ?
Par Anne-Marie Mercier
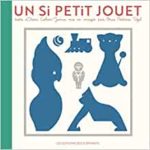 À partir d’un petit objet, d’autant plus petit qu’il semble sans importance (un jouet), ce petit album carré soulève une grande question, celle de l’enfant et de ses propriétés, de ce qu’il peut emmener ou pas avec lui quand il est obligé de changer de domicile, et de tout ce que la présence ou l’absence de ces choses représente d’inquiétude et de souffrance.
À partir d’un petit objet, d’autant plus petit qu’il semble sans importance (un jouet), ce petit album carré soulève une grande question, celle de l’enfant et de ses propriétés, de ce qu’il peut emmener ou pas avec lui quand il est obligé de changer de domicile, et de tout ce que la présence ou l’absence de ces choses représente d’inquiétude et de souffrance.
La première voix est celle d’une fillette qui possède une poupée minuscule, pas plus grande qu’un pouce, qu’elle a appelée Léo. C’est une poupée qu’on peut emmener partout avec soi (même à l’école) en la cachant, et dont on peut s’occuper partout, en la transportant dans une boite d’allumettes, en la lavant, la nourrissant avec des riens.
Avant, raconte la fillette, elle habitait dans un autre pays, bien différent et avait un ours en peluche aussi grand qu’elle. Un jour, les avions (qu’elle appelle les croix de fer) sont arrivés et ont plongé le ciel et la terre dans le chaos.
La petite fille a fait l’expérience de la fuite, pour elle, et de l’abandon, pour son ours. Si la guerre revient, elle sera prête. Dans son nouveau pays, elle rencontre une autre fillette qui possède une toute petite poupée, mais dans son cas c’est à cause du divorce de ses parents : elle a deux maisons et se déplace constamment de l’une à l’autre.
Le jouet dit bien des choses, sans pathos, de la vie des enfants déracinés qui tentent de trouver des moyens de s’adapter à une nouvelle vie.
Les images sont elles aussi pudiques et ne montrent que les silhouettes des enfants, montrés de profil. Seules les poupées nous regardent, petites et fragiles. Les pages offrent de beaux contrastes entre couleurs complémentaires, fonds blancs, hachures grises, saupoudrages argentés, formes au pochoir ou dessins délicats. L’ensemble est beau, simple et bouleversant.