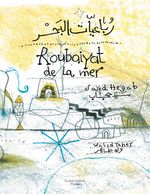Ce que diraient nos pères
Pascal Ruter
Romans Didier Jeunesse 2019
Entre les illusions perdues et le jour se lève
Par Michel Driol
 Une petite ville normande, où l’on croise des migrants qui tentent de passer en Angleterre. Antoine a abandonné ses études, lui qui aimait la littérature et le théâtre, pour un CAP de mécanique auto. Son père, autrefois chirurgien réputé, accusé à tort d’une erreur médicale par le chef de la clinique qui ambitionne de devenir député, est réduit à distribuer des prospectus. Sa mère est partie vivre dans le sud. L’adolescent rencontre Lucia, dont il répare le vélo. Il se laisse aussi entrainer par 3 copains : petits larcins, jets de cailloux sur l’autoroute, jusqu’à un braquage qui tourne mal.
Une petite ville normande, où l’on croise des migrants qui tentent de passer en Angleterre. Antoine a abandonné ses études, lui qui aimait la littérature et le théâtre, pour un CAP de mécanique auto. Son père, autrefois chirurgien réputé, accusé à tort d’une erreur médicale par le chef de la clinique qui ambitionne de devenir député, est réduit à distribuer des prospectus. Sa mère est partie vivre dans le sud. L’adolescent rencontre Lucia, dont il répare le vélo. Il se laisse aussi entrainer par 3 copains : petits larcins, jets de cailloux sur l’autoroute, jusqu’à un braquage qui tourne mal.
Il faut attendre la dernière page du livre pour avoir l’explication du titre : la phrase d’un migrant, Pensez toujours à ce que diraient nos pères. Phrase quelque peu paradoxale dans ce roman de l’absence/présence des pères, qui montre la fragilité des structures familiales. Les pères y sont soit dépassés (celui d’Antoine, qui n’a plus la force de se battre pour prouver son bon droit et qui se réfugie dans sa passion, le kayak de mer), soit nuisibles (le beau-père violent de l’un des protagonistes), soit castrateurs (le père notaire qui refuse de voir la vocation de fildefériste de son fils), soit morts (celui du jeune migrant, noyé, à qui l’on doit la phrase du titre). Comment se situer de fils de ces pères-là ?Pourtant, dans ce roman de la désillusion sociale, l’on rencontre des figures d’adultes positives : le garagiste patron d’Antoine, homme discret, intelligent, ancien sportif de haut niveau qui comprend tout et aide avec tact, la bibliothécaire aussi, figure maternelle par procuration. Et au milieu de tout cela, Antoine, un garçon timide qui a du mal à se livrer, un ancien bon élève qui se débrouille comme il peut, est pris comme en tenaille entre sa volonté de soutenir son père qu’il a refusé de quitter, et les tentations des copains de son âge, dont on se doute bien qu’elles risquent de le conduire au pire par la violence dont ils font preuve. La force du roman est de permettre au lecteur de s’attacher à ce personnage principal, à son humanité, à ses contradictions, à sa double postulation entre la lâcheté et le courage, mais aussi de le placer dans des situations où il doit, par lui-même, faire face à son futur.
Pour autant, ce roman, noir par la vision de la société qu’il donne, est un roman optimiste. La vie y est souvent injuste, les adultes ont tous, plus ou moins, perdu leurs rêves et leurs espoirs de jeunesse : tant le père d’Antoine que Gondrand, le garagiste, sont des hommes que la vie n’a pas épargné. Comme dans les contes, les méchants – comme le patron de clinique – semblent triompher un moment. Mais la fin laisse entrevoir un rétablissement de la justice, une remise en ordre où chacun pourra trouver ou retrouver sa place. Ce roman nerveux par le style de l’auteur : phrases, courtes, souvent nominales, comme des constats, joue de l’opposition entre la réalité décrite ainsi et l’espoir familial d’apercevoir enfin la sterne de Dougall, figure de l’inaccessible étoile. Le narrateur s’efface pour laisser, presque à la fin, écrire son personnage principal : une façon de dire qu’il a à la fois trouvé sa voie et sa voix.
Un roman fort sur le courage et la responsabilité individuelle, sur le moment où tout peut basculer, sur le désarroi de certains jeunes dans la société d’aujourd’hui.
 Neuf tableaux pour évoquer le destin de Zou et de ses deux frères. Dernier d’une fratrie de trois, Zou part aussi tenter sa chance en Europe. Neuf tableaux dans lequel ses frères lui racontent leur mort, l’un sur un bateau, l’autre dans le tunnel sous la Manche, neuf tableaux où on voit sa mère lui tricoter son costume de clown, car à quoi bon être invisible pour passer les frontières ? Neuf tableaux qui culminent à la mort de la mère, tandis que Zou remet son nez rouge…
Neuf tableaux pour évoquer le destin de Zou et de ses deux frères. Dernier d’une fratrie de trois, Zou part aussi tenter sa chance en Europe. Neuf tableaux dans lequel ses frères lui racontent leur mort, l’un sur un bateau, l’autre dans le tunnel sous la Manche, neuf tableaux où on voit sa mère lui tricoter son costume de clown, car à quoi bon être invisible pour passer les frontières ? Neuf tableaux qui culminent à la mort de la mère, tandis que Zou remet son nez rouge…