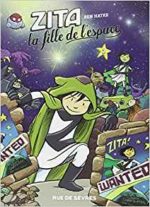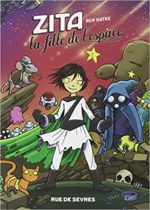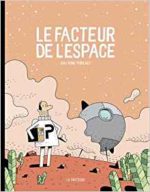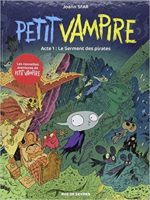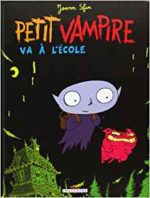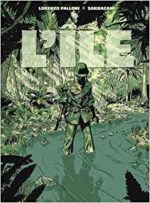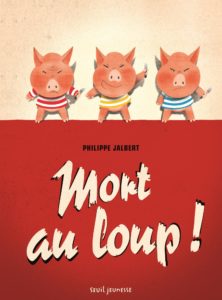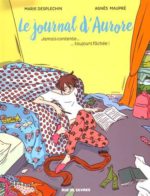Big Nate : Amis ou ennemis ?
Lincoln Peirce
Traduit (USA) par Karine Chaunac
Gallimard-jeunesse (Folio junior) , 2018
Les désarrois de l’élève Nate
Par Anne-Marie Mercier
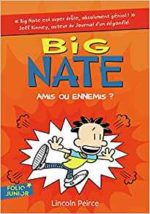 Huitième volume de la série, mais pas une longueur, pas une redite, en dehors des clins d’œil nécessaires à la cohésion de l’ensemble : on retrouve avec jubilation les aventures de Big Nate, jeune élève harcelé par ses professeurs qui essaient de le discipliner un peu, par Gina, la bonne élève de la classe, qui ne perd pas une occasion de le reprendre, par la brute du collège, par les brutes du collège voisin… Mais on voit aussi un garçon amoureux et timide, un fils attristé par la situation professionnelle de son père un dessinateur génial, un fanatique de tous les sports. Tous les lieux de l’école sont visités : CDI, cantine, terrain de sport, bureau du chef d’établissement, du psychologue, etc.
Huitième volume de la série, mais pas une longueur, pas une redite, en dehors des clins d’œil nécessaires à la cohésion de l’ensemble : on retrouve avec jubilation les aventures de Big Nate, jeune élève harcelé par ses professeurs qui essaient de le discipliner un peu, par Gina, la bonne élève de la classe, qui ne perd pas une occasion de le reprendre, par la brute du collège, par les brutes du collège voisin… Mais on voit aussi un garçon amoureux et timide, un fils attristé par la situation professionnelle de son père un dessinateur génial, un fanatique de tous les sports. Tous les lieux de l’école sont visités : CDI, cantine, terrain de sport, bureau du chef d’établissement, du psychologue, etc.
La variété des situations est augmentée par les inserts de bandes dessinées faites par le personnage lui-même, maladroites, mais si pleines de talent qu’on pourrait prédire à celui-ci que quand il sera grand il sera… l’égal de Lincoln Peirce ?
Cette drôlerie n’empêche pas une certaine gravité : Nate apprend à se réconcilier avec ses ennemis, à comprendre que la méchanceté peut cacher une âme blessée, et que se moquer des autres (et notamment des professeurs) peut être un divertissement cruel et honteux.
Encore plus subtil et drôle que Le Journal d’un dégonflé de Jeff Kinney !