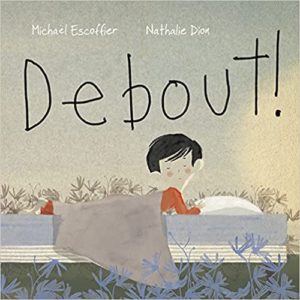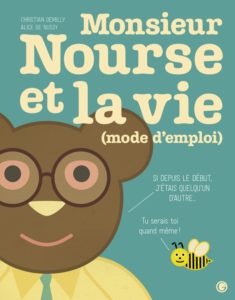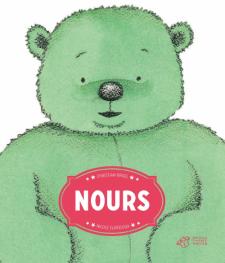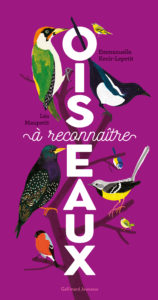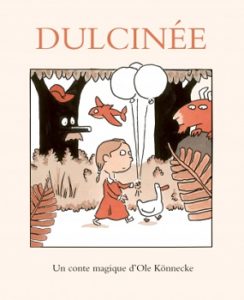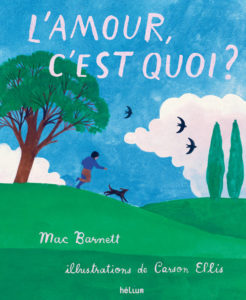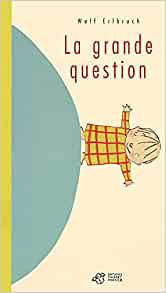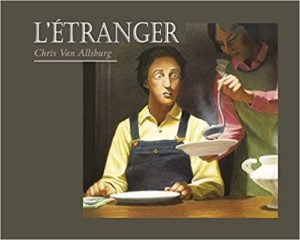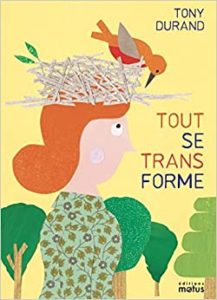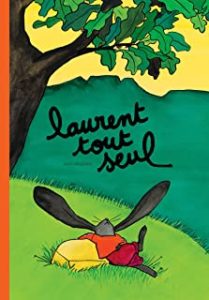Les Nuits magiques de Nisnoura
Jean-François Chabas – Alexandra Huard
Ecole des Loisirs – kaléidoscope – 2022
Ensorcelée…
Par Michel Driol
 Nisnoura est une petite fille ordinaire, fille d’un directeur de théâtre et d’une mère costumière dans un pays oriental. Le jour de ses trois ans, elle découvre son mobile en pièces dans son lit. A sept ans, elle retrouve les magnifiques costumes du prochain spectacle en lambeaux. Et, à neuf ans, invitée chez une amie, elle constate des inscriptions sur les murs de la chambre, malveillantes pour cette amie et sa famille. Pleine de honte, elle fuit le village, et trouve refuge dans un palais désert, où elle découvre le pouvoir de ses cheveux, véritables serpents. Alors un mendiant lui révèle l’origine de la malédiction qui pèse sur les fillettes aux yeux verts nées le mois de la lune rousse, et le moyen de s’en débarrasser.
Nisnoura est une petite fille ordinaire, fille d’un directeur de théâtre et d’une mère costumière dans un pays oriental. Le jour de ses trois ans, elle découvre son mobile en pièces dans son lit. A sept ans, elle retrouve les magnifiques costumes du prochain spectacle en lambeaux. Et, à neuf ans, invitée chez une amie, elle constate des inscriptions sur les murs de la chambre, malveillantes pour cette amie et sa famille. Pleine de honte, elle fuit le village, et trouve refuge dans un palais désert, où elle découvre le pouvoir de ses cheveux, véritables serpents. Alors un mendiant lui révèle l’origine de la malédiction qui pèse sur les fillettes aux yeux verts nées le mois de la lune rousse, et le moyen de s’en débarrasser.
Les premières pages donnent le ton : un monde partagé en quatre royaumes, des personnages inquiétants, des dons extraordinaires, tout ceci pour créer un effet d’attente lié à ce mystérieux royaume de l’Est et à cette petite fille. Dans une ambiance proche des Mille et une nuit, dans un pays oriental lointain, mais contemporain, cet album propose un conte dont la simplicité apparente, celle de son récit, celle de son écriture, aborde des problématiques féministes avec ce pas de côté propre à la fiction. C’est une histoire de malédiction et de libération qui nous est proposée ici. Malédiction millénaire pesant une petite fille, bien innocente, liée au refus d’une autre femme d’épouser un puissant sorcier. Malédiction liée aux cheveux, aux belles et longues tresses qui s’animent le nuit et prennent leur autonomie pour agir, essentiellement mues par jalousie. Malédiction qui conduit la jeune fille à l’exil… Tout cela ne parle-t-il pas de la condition de la femme, aujourd’hui, pas seulement dans certains pays orientaux ? De ces femmes victimes et accusées, alors qu’elles ne sont coupables de rien, et ne peuvent que s’étonner de ce qu’on leur fait subir ? C’est aussi quelque part le thème de la sorcière qui est abordé, c’est-à-dire celui d’une femme jugée par les autres pour des pouvoirs prétendument diaboliques, mais également celui du double, du bien et du mal qui coexistent en nous, comme dans Docteur Jekyll et Mister Hyde. Mais le fort de cet album est de montrer que cette malédiction peut être vaincue par la volonté de celle sur qui elle pèse, voire se retourner à son profit, ce que montre, non sans malice, la fin de l’histoire qu’on laissera au lecteur le soin de découvrir. Bien sûr, le conte parle de cela, mais il en parle à travers l’imaginaire d’une fiction, au travers d’un récit plein de vie, épousant autant que possible le point de vue de son héroïne, dans une langue qui décrit avec précision et pittoresque les richesses de ce monde oriental. Particulièrement soignés, les dialogues campent les personnages et leurs interactions, leurs doutes, leurs colères, leurs peurs, leur sagesse aussi. Les riches illustrations d’Alexandra Huard sont pleines de détails pittoresques elles aussi, et contribuent à plonger le lecteur dans cet univers coloré d’un Orient imaginaire, entre désert et palais hindou. A noter l’adroite utilisation des mosaïques pour évoquer les légendes et le surnaturel au début de l’histoire, façon de planter un décor hors du temps, mosaïques que l’on retrouvera lors de l’illustration des propos du vieux mendiant.
Sous forme de conte oriental, une belle histoire féministe bien actuelle, pour prouver que « les filles ne sont pas si faciles à tourner en bourriques », un récit d’initiation intrigant pour apprendre à dominer les malédictions, ou le destin auquel nous serions condamnés.
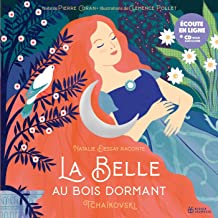 Selon le principe de cette collection de livres musicaux consacrés aux ballets classiques, le CD fait entendre à la fois la musique et le texte, dit par Nathalie Dessay avec une sobriété de bon aloi. La musique de Tchaïkovski est découpée en petites séquences, sans doute pour éviter de lasser le jeune auditeur ; c’est un peu dommage qu’on n’ait pas le temps de s’installer dans chaque mélodie. Seule la fameuse valse (que l’on retrouve dans le film de Disney) du premier acte est donnée en entier, après la fin de l’histoire.
Selon le principe de cette collection de livres musicaux consacrés aux ballets classiques, le CD fait entendre à la fois la musique et le texte, dit par Nathalie Dessay avec une sobriété de bon aloi. La musique de Tchaïkovski est découpée en petites séquences, sans doute pour éviter de lasser le jeune auditeur ; c’est un peu dommage qu’on n’ait pas le temps de s’installer dans chaque mélodie. Seule la fameuse valse (que l’on retrouve dans le film de Disney) du premier acte est donnée en entier, après la fin de l’histoire.