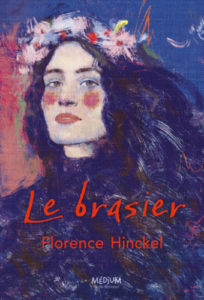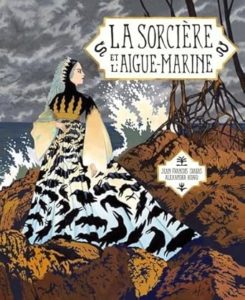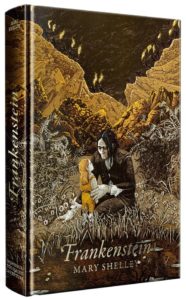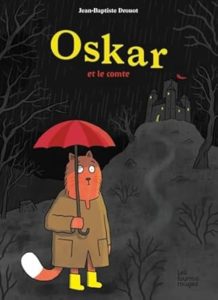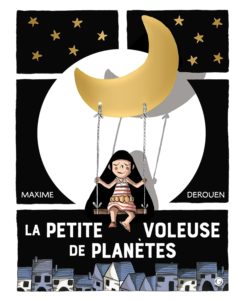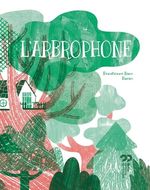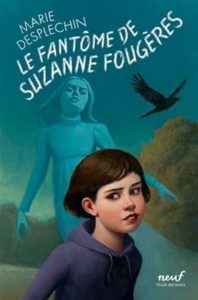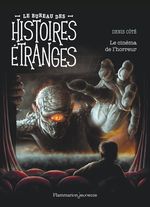Les Effacées
Marine Carteron
Rouergue 2025
Une nuit au musée
Par Michel Driol
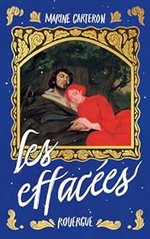 En sortie scolaire au musée d’Orsay, Jo est enfermée dans un placard à balais par un garçon de sa classe. Lorsqu’elle parvient à en sortir, c’est la nuit. Errant dans les couloirs du musée, elle est apostrophée par une voix féminine qui provient d’un tableau de Courbet, l’homme blessé. Celle qui lui parle, Virginie, a été effacée du tableau et, durant toute la nuit, elles vont parler de Courbet, de la place des femmes dans la peinture et dans la vie…
En sortie scolaire au musée d’Orsay, Jo est enfermée dans un placard à balais par un garçon de sa classe. Lorsqu’elle parvient à en sortir, c’est la nuit. Errant dans les couloirs du musée, elle est apostrophée par une voix féminine qui provient d’un tableau de Courbet, l’homme blessé. Celle qui lui parle, Virginie, a été effacée du tableau et, durant toute la nuit, elles vont parler de Courbet, de la place des femmes dans la peinture et dans la vie…
En faisant alterner les voix de Jo et de Virginie, en tissant des liens entre elles au-delà des générations, des conditions sociales, le roman explore un grand pan de la condition féminine. Les effacées, c’est Joséphine, discrète, héritant des vêtements de son frère ainé, punie par un garçon à qui elle a osé dire non, jeune fille normande à la peau noire qui ne se sent pas à sa place dans un musée à Paris. Mais ce sont aussi, au sens propre, toutes les femmes effacées par Courbet de ses tableaux. Virginie donne un véritable cours d’histoire de l’art de la seconde moitié du XIXème siècle, montrant des côtés peu connus de Courbet, de Proudhon ou de Baudelaire quant à leurs rapports avec les femmes. Et cela fait écho avec ce que vit Joséphine, plus d’un siècle plus tard. Le fantastique de l’œuvre permet l’éclosion d’une sororité, permet à Joséphine de prendre conscience de ce qu’elle est, et d’oser, à la fin, décider par elle-même de ce qu’elle a envie de faire comme études. Joséphine est un de ces personnages de roman attachants, que rien ni personne n’a autorisé à se révéler, qui ne cherche pas à prendre une place plus importante, à se faire remarquer. Combien de jeunes filles se reconnaitront dans ce portrait juste et touchant !
Le roman fait alterner un récit traditionnel avec des fragments écrits dans une langue poétique, jouant sur les décrochements, les lignes courtes, le rythme, qui sont d’abord la marque de Virginie ou de l’évocation du XIXème siècle, mais qui finissent par être aussi celle de Jo, dans le retour à Dieppe, dans l’épilogue, comme une façon de signaler dans l’écriture aussi cette évolution de ce personnage vers une autre dimension, une autre conception du monde.
Quelle est la place des femmes dans l’art ? Quelle est la place des femmes que l’on dit racisées dans un musée ? Ce sont ces dimensions que le roman féministe explore, au travers de quelques tableaux de Courbet, l’Homme blessé, l’Origine du monde, l’Atelier…, tableaux dont certains sont reproduits en esquisses grisées par Mathilde Foignet. Il montre qu’en dépit de quelques améliorations, la condition des femmes du peuple, dans le couple, dans les rapports avec les hommes n’a pas beaucoup changé. Il conduit à réfléchir sur la valeur du non, sur le harcèlement, à travers ces figures féminines de Virginie Binet, ou Constance Quéniaux, bien attestées dans la vie de Courbet, au travers aussi du personnage de Joséphine.
De copieuses annexes révèlent la genèse de l’œuvre par son autrice, mais aussi donnent des informations historiques sur tous les personnages du XIXème siècle que l’on croise dans le roman.
Un roman bouleversant qui propose un regard neuf sur la peinture et des artistes que l’on croyait bien connaitre, et qui aide à faire prendre conscience de la domination masculine dans de nombreux domaines;