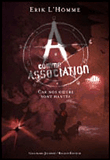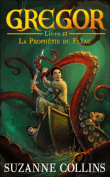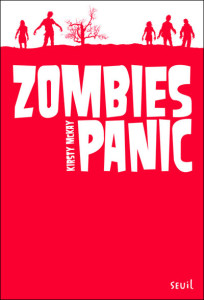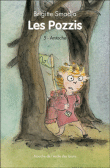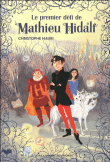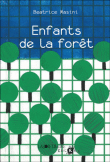Zombies panic
Kirsty McCay
traduction (anglais) Daniel Lemoine
Seuil, 2012
Ça, c’est du zombie !
par Christine Moulin
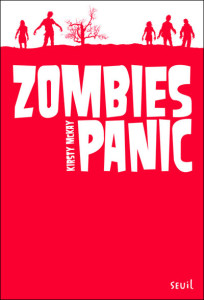 Si on aime le genre « zombies », il faut lire ce roman car tout y est. L’héroïne, une adolescente du nom de Bobby, est courageuse, altruiste mais peu sûre d’elle, si bien qu’elle ne sait même pas qu’elle est l’héroïne de l’histoire. Elle trouve le temps, en pleine apocalypse, de tomber amoureuse d’un marginal, Rob Smitty, « rebelle impénitent, original de service et candidat à l’exclusion. Mais le meilleur en snowboard, aucun doute là-dessus ». Son faire-valoir est une petite pimbêche uniquement occupée de son « look » qui se révèlera, au fil de l’histoire, plus intrépide qu’il n’y paraît. Au trio vient se greffer Pete, un « geek », qui semble d’abord maladroit et ridicule, mais qui, bien sûr, possède des talents technologiques exceptionnels très utiles.
Si on aime le genre « zombies », il faut lire ce roman car tout y est. L’héroïne, une adolescente du nom de Bobby, est courageuse, altruiste mais peu sûre d’elle, si bien qu’elle ne sait même pas qu’elle est l’héroïne de l’histoire. Elle trouve le temps, en pleine apocalypse, de tomber amoureuse d’un marginal, Rob Smitty, « rebelle impénitent, original de service et candidat à l’exclusion. Mais le meilleur en snowboard, aucun doute là-dessus ». Son faire-valoir est une petite pimbêche uniquement occupée de son « look » qui se révèlera, au fil de l’histoire, plus intrépide qu’il n’y paraît. Au trio vient se greffer Pete, un « geek », qui semble d’abord maladroit et ridicule, mais qui, bien sûr, possède des talents technologiques exceptionnels très utiles.
Tout ce petit monde doit lutter avec des zombies d’abord dans un restaurant et une station-service puis dans un château gothique qui cache des secrets défense auxquels Bobby est mêlée indirectement, à son insu.
L’horreur la plus « gore » ne manque pas : « […] je me rends compte qu’il a un morceau d’étagère fiché dans le crâne. Du sang coule sur ses cheveux blancs », « Il tient toujours l’ordinateur portable mais je ne comprends pas immédiatement qu’il n’a qu’un bras en état de marche. Un moignon dépasse de son autre manche de chemise, prolongé d’un long morceau d’os blanc, comme si on avait rongé la chair à la manière d’un épi de maïs ».
Ne manque pas non plus la touche d’humour auto-parodique. Par exemple, Bobby entend, alors qu’elle est aux toilettes, un gémissement venu d’outre-tombe qui la glace d’effroi, ce qui ne l’empêche pas de remarquer : « Partir sans avoir tiré la chasse est un peu dégoûtant mais à la guerre comme à la guerre. ». L’auto-parodie va jusqu’à la réflexion sur le genre (« Dans les films, c’est toujours à ce moment que les monstres refont surface. Qu’ils cassent la vitre et se jettent sur les héros. Ça se passe toujours comme ça. Si on regarde par le trou de la serrure, on se fait crever l’œil ; si on se regarde dans un miroir, le tueur est juste derrière. C’est une sorte de loi, on dirait. ») et la mise en abyme : vers le milieu du roman, les héros regardent les enregistrements des caméras de surveillance. « Que le spectacle commence ! » dit l’un d’eux. Les protagonistes, en fait, assistent, fascinés à la projection… d’un film de zombies !
C’est qu’au fond, l’auteur semble avoir saisi la quintessence du genre : rappelant l’appartenance de celui-ci à la culture « geek », c’est à Pete qu’elle donne la parole pour exprimer le principe fondamental (et souvent tenu secret ?) du plaisir que procurent les histoires de zombies, le fantasme de toute-puissance qui peut se déployer dans un monde promis à la destruction : « C’était formidable ! Ils étaient tous là sans défense. Imagine un peu… Je pouvais faire ce que je voulais. Personne ne pouvait m’en empêcher ».
Quant à la fin, disons qu’elle est fidèle à la tradition. Non, n’insistez pas, je n’en dirai pas plus pour ne pas gâcher la lecture de ce livre sans prétentions excessives, mais qui se lit d’une traite.
Cela dit, une petite réserve : la traduction laisse parfois échapper quelques impropriétés syntaxiques mais ne chipotons pas…
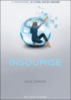 Après Promise, Insoumise ; les deux couvertures des premier et deuxième tomes se répondent aussi joliment que les titres. Et ce deuxième volume remplit en partie les promesses du précédent : l’histoire d’amour (l’héroïne hésite entre deux garçons), l’aventure (ici, survie dans un monde inconnu et hostile), la lutte contre l’oppression, tout cela se poursuit également, avec un retournement final qui nous rappelle l’interrogation du premier volume (qui manipule qui ?) et qui maintient le suspens.
Après Promise, Insoumise ; les deux couvertures des premier et deuxième tomes se répondent aussi joliment que les titres. Et ce deuxième volume remplit en partie les promesses du précédent : l’histoire d’amour (l’héroïne hésite entre deux garçons), l’aventure (ici, survie dans un monde inconnu et hostile), la lutte contre l’oppression, tout cela se poursuit également, avec un retournement final qui nous rappelle l’interrogation du premier volume (qui manipule qui ?) et qui maintient le suspens.