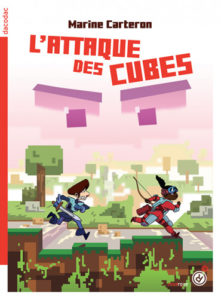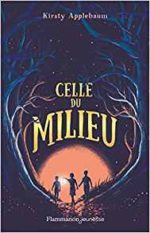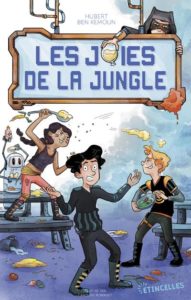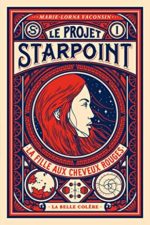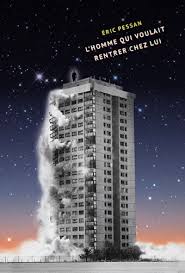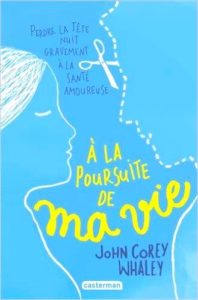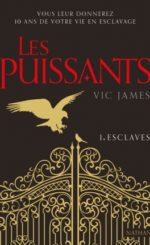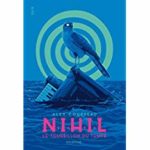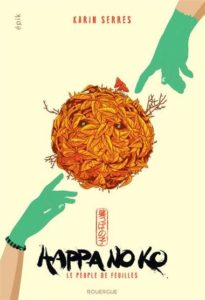La Tribu des Désormais
Benjamin Desmares
Rouergue (« epik »), 2019
Noir corbeau
Par Anne-Marie Mercier
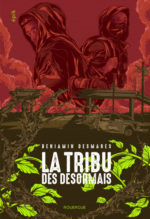 Voilà un roman bien sombre. Il est à la fois pessimiste sur l’avenir (on sait au bout d’un certain temps ce qu’on avait pu deviner très vite : le monde des personnages a été ravagé par une catastrophe nucléaire) et sur la nature humaine, qui semble ne s’être guère améliorée avec le temps. Elias, le héros adolescent, vit dans un monde détruit, une île dévastée où tout est en ruine. L’espace est fractionnée en Clans hostiles, et coupé en deux par une frontière infranchissable de ronces. De l’autre côté de la frontière vivent les Monstres : ceux qui ont été irradiés et qui ont développé de multiples malformations, non seulement des humains mais aussi des animaux et des végétaux. Elias les craint et les a en horreur, comme on le lui a appris.
Voilà un roman bien sombre. Il est à la fois pessimiste sur l’avenir (on sait au bout d’un certain temps ce qu’on avait pu deviner très vite : le monde des personnages a été ravagé par une catastrophe nucléaire) et sur la nature humaine, qui semble ne s’être guère améliorée avec le temps. Elias, le héros adolescent, vit dans un monde détruit, une île dévastée où tout est en ruine. L’espace est fractionnée en Clans hostiles, et coupé en deux par une frontière infranchissable de ronces. De l’autre côté de la frontière vivent les Monstres : ceux qui ont été irradiés et qui ont développé de multiples malformations, non seulement des humains mais aussi des animaux et des végétaux. Elias les craint et les a en horreur, comme on le lui a appris.
Presque tout le roman est construit à travers son point de vue : le lecteur est pris dans ses courses, ses efforts, ses sensations et émotions, le plus souvent faites de souffrances physiques et morales, et ses rares moments de contemplation et de réflexion. Pourchassé, il franchit la frontière et devient un monstre chez les monstres, rejeté de tous sauf par un être qui lui répugne encore plus que les autres. Elias apprend à surmonter ses dégoûts et ses terreurs et vit des aventures étranges, où il apprend la solidarité et le courage et commence à comprendre (et le lecteur avec lui) de quoi est fait ce monde et comment il est devenu ce qu’il est.
Il décrypte aussi peu à peu ses émotions pour lesquelles il n’a pas de nom et dont il ne prend conscience qu’à travers des sensations physiques (le désir sexuel étant curieusement absent pour l’instant dans son attirance forte pour la jeune femme qu’il accompagne dans sa quête et sa mission salvatrice: il s’agit de rien moins que de mettre fin à la contamination).
Des personnages secondaires forts et originaux, une grande attention à la nature ou à ce qu’il en reste (pas très rassurant : les plantes même semblent vouloir se venger), de l’étrange (d‘autant plus efficace qu’il est délivré à petites doses), du suspens, des combats, des hallucinations, tout cela forme un ensemble étonnant et prenant. L’idée du jeu de la tribu constituée sur le modèle des histoires d’indiens de l’enfance par le seul adulte survivant de la zone contaminée n’allège que brièvement ce récit aux tonalités âpres où les corbeaux disent l’avenir – par bribes et obscurément comme il se doit.
Pour lire un extrait