Jours d’école. Collectif de Haïkus
Collectif
AFH (Association francophone de Haïkus) et Renée Clairon (Canada), 2014
Poésie pour l’école ou école de poésie ?
Par Anne-Marie Mercier
C’est une r encontre inattendue, et pourtant évidente, que celle de la poésie scolaire d’autrefois (automne, école, sensations et souvenirs) avec les ateliers d’écriture et le haïku. Et pourtant ces petits poèmes en dix-sept syllabes (ou pas), évoquant une saison (ou pas) et structurés autour d’une césure (ou pas) sont proches dans l’esprit de beaucoup de nos classiques d’autrefois. Ce recueil franco-canadien propose des textes écrits par des adultes et des enfants, en français ou en espagnol (ceux-ci sont donnés avec leur traduction), lors d’ateliers d’écriture. Quelques témoignages sur ces ateliers en fin de volume éclairent les démarches et les buts de leurs animateurs, illustrant la variété des pratiques (à signaler, un beau témoignage de Thierry Cazals sur la pratique du choix d’un « nom de poète » par les scripteurs).
encontre inattendue, et pourtant évidente, que celle de la poésie scolaire d’autrefois (automne, école, sensations et souvenirs) avec les ateliers d’écriture et le haïku. Et pourtant ces petits poèmes en dix-sept syllabes (ou pas), évoquant une saison (ou pas) et structurés autour d’une césure (ou pas) sont proches dans l’esprit de beaucoup de nos classiques d’autrefois. Ce recueil franco-canadien propose des textes écrits par des adultes et des enfants, en français ou en espagnol (ceux-ci sont donnés avec leur traduction), lors d’ateliers d’écriture. Quelques témoignages sur ces ateliers en fin de volume éclairent les démarches et les buts de leurs animateurs, illustrant la variété des pratiques (à signaler, un beau témoignage de Thierry Cazals sur la pratique du choix d’un « nom de poète » par les scripteurs).
Des écrivains confirmés, membre de l’AFH, ont également contribué et le jeu qui consisterait à deviner qui a écrit tel ou tel poème (« haïkumane » ou débutant ? enfant ou adulte ? féminin ou masculin ?) est parfois difficile : on lit sans savoir, mais la solution est en fin de volume, c’est une très bonne idée. Un CD propose une lecture à voix haute pour accompagner ces évocations ; des illustrations en noir et blanc, sombres ou comiques, parfois nostalgiques, accompagnent ces évocations. De styles variés, elles sont dues à des étudiants canadiens en arts plastiques.
Les quatre saisons ordonnent la première partie, de la rentrée avec ses angoisses, la solitude, mais aussi les découvertes et les plaisirs de l’automne, au printemps, en passant par l’hiver, et finissant par la fin des classes et l’école abandonnée.
Cour de récréation –
seule au monde au centre
de son cerceau
Classe de neige –
les enfants apprennent à compter
avec les flocons
Deux élèves dans l’escalier
une ombre à quatre bras –
début du printemps
Marelle abandonnée
dans la cour de l’école –
un chat dort au ciel
Pour contacter l’Association francophone de haïku 
Et pour lire un joli roman sur les ateliers d’écriture de haïkus à destination des adolescents : Ma Vie en dix-sept pieds de Dominique Mainard (école des loisirs, 2008)

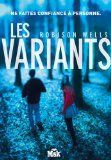
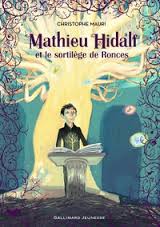
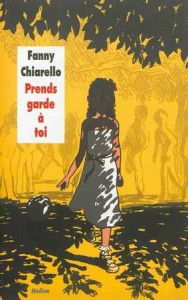
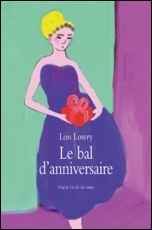

 La mystérieuse dédicace de Marie-Aude Murail (« Chacun son tour d’apprendre la vie dans la cour de récréation ») semble s’adresser directement au personnage du caïd dénommé Olivier dans le roman, davantage un enfant maltraité par la vie qu’un vrai méchant.
La mystérieuse dédicace de Marie-Aude Murail (« Chacun son tour d’apprendre la vie dans la cour de récréation ») semble s’adresser directement au personnage du caïd dénommé Olivier dans le roman, davantage un enfant maltraité par la vie qu’un vrai méchant. « Ma mère est morte ». L’excuse inventée par Antoine Doisnel dans Les Quatre cent coups est utilisée par un jeune garçon qui cherche à échapper à tout ce qui le contraint. Mais Pascal ne s’arrête pas à ce premier mensonge et s’empêtre dans de nombreux autres, finissant par ne plus savoir comment échapper à l’embrouillamini qu’il a créé, sinon par la fuite, l’envie de disparaître.
« Ma mère est morte ». L’excuse inventée par Antoine Doisnel dans Les Quatre cent coups est utilisée par un jeune garçon qui cherche à échapper à tout ce qui le contraint. Mais Pascal ne s’arrête pas à ce premier mensonge et s’empêtre dans de nombreux autres, finissant par ne plus savoir comment échapper à l’embrouillamini qu’il a créé, sinon par la fuite, l’envie de disparaître. « Cette histoire a d’abord existé sous forme d’un roman (…). Je l’ai entièrement réécrite pour le théâtre à l’invitation de Pascale Daniel-Lacombe, du Théâtre du Rivage, qui l’a créée à l’Atrium de Dax le 24 mars 2011 » (Karin Serres). Nous pouvons remercier la metteur en scène car, si je n’ai pas lu Mongol sous forme de roman (édité en 2003), la pièce a tout des qualités de ce qui fait un texte marquant.
« Cette histoire a d’abord existé sous forme d’un roman (…). Je l’ai entièrement réécrite pour le théâtre à l’invitation de Pascale Daniel-Lacombe, du Théâtre du Rivage, qui l’a créée à l’Atrium de Dax le 24 mars 2011 » (Karin Serres). Nous pouvons remercier la metteur en scène car, si je n’ai pas lu Mongol sous forme de roman (édité en 2003), la pièce a tout des qualités de ce qui fait un texte marquant. Dans cette série qui a eu beaucoup de succès et qui paraît maintenant en poche on retrouve plusieurs ingrédients qui ont fait le succès de nombreuses autres. Le jeune héros est martyrisé par sa famille dans lequel il joue un personnage de Cendrillon. Treizième fils, roux, il est totalement différent de ses frères et se sait destiné à un futur glorieux grâce à la prédiction d’un ménestrel de passage. Intégrer une école va lui permettre de changer sa vie.
Dans cette série qui a eu beaucoup de succès et qui paraît maintenant en poche on retrouve plusieurs ingrédients qui ont fait le succès de nombreuses autres. Le jeune héros est martyrisé par sa famille dans lequel il joue un personnage de Cendrillon. Treizième fils, roux, il est totalement différent de ses frères et se sait destiné à un futur glorieux grâce à la prédiction d’un ménestrel de passage. Intégrer une école va lui permettre de changer sa vie.