Au ventre du monde
Gilles Barraqué
L’école des loisirs, 2012
La fille-garçon avec du cœur au ventre: mythes anciens et modernes
Par Anne-Marie Mercier
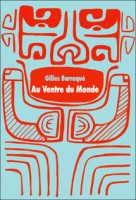 Les romans pour la jeunesse s’ingénient par toutes sortes de torsions à créer des héroïnes, y compris dans des univers où seuls les garçons ont accès à l’action et au pouvoir. Ici, l’auteur arrive à faire un récit où contre toute attente c’est bien une fille qui mène le jeu, une très jeune fille pré-pubère, sans qu’on soit gêné par l’anachronisme ou des facilités romanesques : on se situe dans un temps indéterminé, baigné par le mythe, sur une île située dans ce qu’on appelle aujourd’hui les Marquises.
Les romans pour la jeunesse s’ingénient par toutes sortes de torsions à créer des héroïnes, y compris dans des univers où seuls les garçons ont accès à l’action et au pouvoir. Ici, l’auteur arrive à faire un récit où contre toute attente c’est bien une fille qui mène le jeu, une très jeune fille pré-pubère, sans qu’on soit gêné par l’anachronisme ou des facilités romanesques : on se situe dans un temps indéterminé, baigné par le mythe, sur une île située dans ce qu’on appelle aujourd’hui les Marquises.
Paohétama est orpheline, élevée par son grand-père, maître de la pêche et maître artisan des parures : c’est lui qui rapporte les coquillages précieux qui feront les ornements des personnes importantes, signes de leur prestige. Une grande partie du roman détaille la vie du village avec une vision anthropologique et sociologique : la société de l’île y est décrite avec le rôle de chacun, et avec la façon dont chacune le remplit, plus ou moins bien ou de façon plus ou moins désintéressée (on trouve donc un certain réalisme, de l’humour). Il est aussi imprégné par la poésie de la mer et de ce qu’on y trouve, petites choses, travail minutieux, mais aussi quête dangereuse.
Par un coup de force, le grand père fait accepter au village que sa petite fille lui succède temporairement. Son activité étant interdite aux femmes et aux filles, Paohétama est déclarée « garçon », ou plutôt elle devient fille-garçon. Crâne rasé, elle se mêle aux activités des garçons tout en s’initiant à la pêche, tout cela suscitant difficultés et interrogations chez beaucoup et des interventions d’un sorcier inquiétant, d’abord hostile puis persuadé qu’elle fera de grandes choses. La deuxième partie, plus dramatique fait découvrir les raisons de la mort du père de la fillette : il a rompu un tabou et la malédiction qui a suivi a provoqué la disparition de sa femme. Pour sauver sa famille et son monde, la fillette, désignée par le sorcier comme « pêcheuse d’hommes », part seule sur l’eau vers « le ventre du monde », île des origines, où elle doit trouver l’offrande qui réconciliera son peuple avec le dieu requin comme avec les peuples ennemis. Au risque de déflorer la fin, on peut ajouter qu’après bien des souffrances et des dangers elle sera reine et trouvera l’amour en retrouvant sa féminité. C’est donc aussi une forme de conte où la magie et la divination jouent un rôle discret.
C’est un gros roman (280 pages), passionnant, et un très beau roman d’initiation qui, raconté à la première personne par l’héroïne, est porté par son interrogation sur sa place dans la société et ses rapports aux autres comme par son amour pour son grand-père. C’est aussi une réflexion sur la féminité et la masculinité, la force de la volonté et de la confiance. Gilles Barraqué a placé son histoire fabuleuse dans une atmosphère de conte des origines très poétique. L’océan, ses créatures et ses plantes, son rythme et ses courants, lumineux ou nocturne, est le « personnage » central de l’aventure ; seule sur l’eau (on pense à Seule sur la mer immense de Morpurgo, ancré dans la technologie des voiliers modernes et au Vieil homme et la mer d’Hemingway) Paohétama lutte pour sa vie comme pour celle des autres. Au bout du compte, c’est aussi son monde qu’elle sauve en le réconciliant avec l’élément comme avec l’ennemi et elle créant un nouveau mythe des origines.
Gilles Barraqué, qui a publié plusieurs courts récits pour la jeunesse, signe ici avec sa première contribution à l’école des loisirs un roman remarquable et foisonnant.


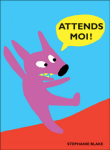
 Dans un lieu reculé d’Afrique, à six heures de piste du premier hôpital, vit Sisanda. Elle a neuf ans, et depuis neuf ans elle vit avec un cœur malade. Son père travaille au loin et envoie de l’argent. Sisanda vit avec sa mère, Swala (« l’antilope »), sa grand-mère un peu sorcière et un oncle un peu idiot qui garde les troupeaux. Autour, il y a le village, l’épicier, la grosse Raïla qui rit tout le temps, Zacaria qui fait le taxi… Et le vent qui épuise les malades. C’est Sisanda qui raconte dans ce roman, tout en parlant à son petit cœur imbécile pour tenter de le calmer, de l’apprivoiser, parfois en vain.
Dans un lieu reculé d’Afrique, à six heures de piste du premier hôpital, vit Sisanda. Elle a neuf ans, et depuis neuf ans elle vit avec un cœur malade. Son père travaille au loin et envoie de l’argent. Sisanda vit avec sa mère, Swala (« l’antilope »), sa grand-mère un peu sorcière et un oncle un peu idiot qui garde les troupeaux. Autour, il y a le village, l’épicier, la grosse Raïla qui rit tout le temps, Zacaria qui fait le taxi… Et le vent qui épuise les malades. C’est Sisanda qui raconte dans ce roman, tout en parlant à son petit cœur imbécile pour tenter de le calmer, de l’apprivoiser, parfois en vain. Il y a un peu du Slumdog millionnaire dans le roman de Claire Ubac (le livre, pas le film, qui n’avait pour lui que son rythme formidable) : dans l’Inde d’aujourd’hui, une fille et un garçon voyagent, à pied, en voiture, en train… Ils sont poursuivis, enfermés, s’évadent, se perdent, mais continuent leur quête, coûte que coûte, et s’entraident, s’aiment. A travers eux, on découvre l’Inde : villages, villes (Madurai, Bangalore, Bombay…), bidonvilles, usines, ateliers et métiers. Les bruits, les odeurs et les saveurs donnent
Il y a un peu du Slumdog millionnaire dans le roman de Claire Ubac (le livre, pas le film, qui n’avait pour lui que son rythme formidable) : dans l’Inde d’aujourd’hui, une fille et un garçon voyagent, à pied, en voiture, en train… Ils sont poursuivis, enfermés, s’évadent, se perdent, mais continuent leur quête, coûte que coûte, et s’entraident, s’aiment. A travers eux, on découvre l’Inde : villages, villes (Madurai, Bangalore, Bombay…), bidonvilles, usines, ateliers et métiers. Les bruits, les odeurs et les saveurs donnent Il pourrait (aurait pu ?) s’agir du chef-d’œuvre de Jean-François Chabas.
Il pourrait (aurait pu ?) s’agir du chef-d’œuvre de Jean-François Chabas.  Entre le journal sentimental, le journal de voyage et le carnet de poésie, ce joli roman offre de belles vues sur le Japon en Automne, ses temples, sa culture, ses trains, son goût du « kawai » (mignon).
Entre le journal sentimental, le journal de voyage et le carnet de poésie, ce joli roman offre de belles vues sur le Japon en Automne, ses temples, sa culture, ses trains, son goût du « kawai » (mignon). 
 Les Pozzis sont la chronique en plusieurs volumes d’un peuple de petites personnes (20 cm, nous dit-on) vivant assez joyeusement sur un tapis d’herbes et d’eau. Ce pourrait être celle d’une tribu ou d’une famille, mais ici point de parenté : les enfants arrivent on ne sait d’où, restent quelques jours dans la tente du chef du moment, puis sont « adultes » et rejoignent les autres. Peu de travail, hors la construction de ponts d’herbes sur les marais, beaucoup de fêtes (qu’on appelle Récréations). Ils semblent avoir un sexe, vu leurs prénoms (Adèle, Léonce) et les genres grammaticaux qui les désignent, mais ce n’est pas sûr. Un genre de schtroumpfs sympathiques en robes changeantes et aux jambes terminées par des sabots, une colo en plein air (mais chacun a sa propre grotte) où l’on se nourrit de soupe et où le chef décide des occupations de chacun et punit de corvées ceux qui font des bêtises et se laissent aller à la colère. Les dessins d’Alan Mets, esquisses charmantes et colorées à l’aquarelle donnent joyeusement corps à ces êtres schématiques.
Les Pozzis sont la chronique en plusieurs volumes d’un peuple de petites personnes (20 cm, nous dit-on) vivant assez joyeusement sur un tapis d’herbes et d’eau. Ce pourrait être celle d’une tribu ou d’une famille, mais ici point de parenté : les enfants arrivent on ne sait d’où, restent quelques jours dans la tente du chef du moment, puis sont « adultes » et rejoignent les autres. Peu de travail, hors la construction de ponts d’herbes sur les marais, beaucoup de fêtes (qu’on appelle Récréations). Ils semblent avoir un sexe, vu leurs prénoms (Adèle, Léonce) et les genres grammaticaux qui les désignent, mais ce n’est pas sûr. Un genre de schtroumpfs sympathiques en robes changeantes et aux jambes terminées par des sabots, une colo en plein air (mais chacun a sa propre grotte) où l’on se nourrit de soupe et où le chef décide des occupations de chacun et punit de corvées ceux qui font des bêtises et se laissent aller à la colère. Les dessins d’Alan Mets, esquisses charmantes et colorées à l’aquarelle donnent joyeusement corps à ces êtres schématiques. Ole Könnecke, l’auteur du savoureux Mauvaise caisse ! et du délicieux Jop est toujours surprenant, pour notre grand plaisir. Ici, méditation sur la chance : il en faut dans certaines circonstances, « car il y a des choses qu’on ne peut tout simplement pas régler en faisant comme si elle n’existaient pas » … « et qui sait si ça va bien se passer. Tant de choses peuvent arriver »… « tout n’est pas toujours facile et personne ne sait ce que le futur nous réserve ».
Ole Könnecke, l’auteur du savoureux Mauvaise caisse ! et du délicieux Jop est toujours surprenant, pour notre grand plaisir. Ici, méditation sur la chance : il en faut dans certaines circonstances, « car il y a des choses qu’on ne peut tout simplement pas régler en faisant comme si elle n’existaient pas » … « et qui sait si ça va bien se passer. Tant de choses peuvent arriver »… « tout n’est pas toujours facile et personne ne sait ce que le futur nous réserve ».