Le faire ou mourir
Claire-Lise Marguier
Rouergue (doAdo), 2011
Variations sur les modes de la Terreur adolescente
par Anne-Marie Mercier
 Ce premier roman, malgré sa thématique très ancrée dans l’actualité sociale, surprend – en bien – à plus d’un titre. Écrit à la première personne de façon sobre, son ton peut parfois se révéler lyrique, parfois exacerbé. En phrases courtes, pressées par l’angoisse ou l’exaltation, il raconte plusieurs histoires.
Ce premier roman, malgré sa thématique très ancrée dans l’actualité sociale, surprend – en bien – à plus d’un titre. Écrit à la première personne de façon sobre, son ton peut parfois se révéler lyrique, parfois exacerbé. En phrases courtes, pressées par l’angoisse ou l’exaltation, il raconte plusieurs histoires.
Dans un premier temps c’est l’histoire d’un garçon fragile et sensible, souffre-douleur des cours de récréation, négligé par sa famille, moqué pour ses larmes et ses terreurs d’enfant. Maltraité par une bande, il est sauvé par une autre et s’y agrège avec l’impression d’avoir enfin trouvé un lieu où exister. Que les uns soient des skateurs et que les autres soient des gothiques est assez anecdotique sur le fond mais les réactions des autres aux apparences sont décrites de façon intéressante. On explore donc ici avec beaucoup de pertinence la question de l’appartenance à un groupe, une « bande ».
Dans un deuxième temps, c’est l’histoire de l’amitié entre Damien et Samy, une amitié dans laquelle la dimension physique devient de plus en plus importante. Comme cela est dit explicitement dans le roman, ce n’est pas la question de l’homosexualité qui est traitée ici, mais c’est le portrait d’un amour. L’auteur nous raconte une belle histoire, avec pudeur et beaucoup de sensibilité. Damien le Solitaire et le muet découvre en Samy un « gothique » solaire, à la fois libre et rattaché, à l’aise avec ses parents, à l’aise avec son corps, à l’aise avec les mots, tout ce qu’il n’est pas.
Dans un troisième temps, le lecteur découvre le profond malaise de Damien qui se scarifie, pour éviter d’exploser, par plaisir, pour se sentir exister, tout cela à la fois et d’autres choses encore. Les violences qu’il s’inflige ou qu’il subit, physiques ou psychologique, au collège ou en famille, l’incompréhension de son père, la distance de sa mère, son incapacité à dire, tout cela fait un mélange explosif qu’il ne désamorce, provisoirement, qu’en faisant couler son propre sang.
L’auteur nous propose deux fins possibles. L’une, saisissante, est terrifiante, catastrophique. La deuxième, qui imagine un futur possible à Damien, est réconfortante. Certains voient cette double proposition comme une facilité. J’ai apprécié ce non-choix: il montre que ce n’est que de la fiction. Il montre aussi ce que cette fiction dit du réel: on ne peut fermer le livre sans un sentiment de terreur devant l’idée qui sous-tend ces deux propositions, qu’il suffit de si peu pour faire basculer tant de vie vers tant de mort.
Il est rare que des questions comme celles de la violence scolaire et familiale, de la mode du « gothique » et de la pratique des scarifications soient abordées dans une fiction qui les éclaire de l’intérieur avec autant de cohérence et de compréhension. Il est rare également qu’un roman soulève autant de questions sociales sans jamais cesser d’être… un roman : ici, le parcours de personnages auxquels ont croit et auxquels on s’attache.
 La bête, c’est la dépression dans laquelle plonge brutalement le père d’Abel. Le roman, c’est l’histoire d’Abel face à la bête et à ce naufrage. On le suit jour après jour, avec son père, puis avec sa grand-mère lorsque celui-ci est l’hôpital, puis seul, errant dans Paris, et enfin avec un couple de psy chez qui il débarque pour demander du secours.
La bête, c’est la dépression dans laquelle plonge brutalement le père d’Abel. Le roman, c’est l’histoire d’Abel face à la bête et à ce naufrage. On le suit jour après jour, avec son père, puis avec sa grand-mère lorsque celui-ci est l’hôpital, puis seul, errant dans Paris, et enfin avec un couple de psy chez qui il débarque pour demander du secours.

 D’excellents auteurs, connus dans le monde de l’édition de la littérature pour adolescents, sont ici rassemblés par Keith Grey. On trouve, dans ce recueil de nouvelles autour du thème de la « première fois », des textes de qualité et des écritures très diverses. Comme on est en littérature « de jeunesse », il y est davantage question de l’avant que du passage à l’acte lui-même (le texte de P. Ness échappe astucieusement à cette règle en multipliant les rectangles noirs sur les mots interdits).
D’excellents auteurs, connus dans le monde de l’édition de la littérature pour adolescents, sont ici rassemblés par Keith Grey. On trouve, dans ce recueil de nouvelles autour du thème de la « première fois », des textes de qualité et des écritures très diverses. Comme on est en littérature « de jeunesse », il y est davantage question de l’avant que du passage à l’acte lui-même (le texte de P. Ness échappe astucieusement à cette règle en multipliant les rectangles noirs sur les mots interdits). Ce premier roman de Gilles Tourman a eu peu d’écho à sa sortie et c’est dommage. Non seulement il a tous les éléments qui peuvent accrocher un lecteur ou une lectrice adolescents, mais aussi il aborde des thèmes intéressants et actuels : le danger des blogs et de l’addiction aux jeux vidéos, les stratégies des entreprises commerciales qui les développent. On a donc ici un mélange fort et original : un roman qui se passe au cœur d’un jeu vidéo sans être pour autant un récit fantastique.
Ce premier roman de Gilles Tourman a eu peu d’écho à sa sortie et c’est dommage. Non seulement il a tous les éléments qui peuvent accrocher un lecteur ou une lectrice adolescents, mais aussi il aborde des thèmes intéressants et actuels : le danger des blogs et de l’addiction aux jeux vidéos, les stratégies des entreprises commerciales qui les développent. On a donc ici un mélange fort et original : un roman qui se passe au cœur d’un jeu vidéo sans être pour autant un récit fantastique. Ce premier roman, malgré sa thématique très ancrée dans l’actualité sociale, surprend – en bien – à plus d’un titre. Écrit à la première personne de façon sobre, son ton peut parfois se révéler lyrique, parfois exacerbé. En phrases courtes, pressées par l’angoisse ou l’exaltation, il raconte plusieurs histoires.
Ce premier roman, malgré sa thématique très ancrée dans l’actualité sociale, surprend – en bien – à plus d’un titre. Écrit à la première personne de façon sobre, son ton peut parfois se révéler lyrique, parfois exacerbé. En phrases courtes, pressées par l’angoisse ou l’exaltation, il raconte plusieurs histoires. L’idée était bonne et avait de quoi séduire les amateurs de brocante : le mérite indiscutable du roman de Marie-Claire Boucault est de faire partager et de bien analyser les émotions et les rêveries qui peuvent survenir à la vue de tel ou tel objet en vente aux Puces. Elle en a fait le point de départ de son récit : la narratrice déniche un album de photos et se laisse arrêter par celle d’une tombe. Elle décide de rendre l’album à la famille à laquelle il appartient.
L’idée était bonne et avait de quoi séduire les amateurs de brocante : le mérite indiscutable du roman de Marie-Claire Boucault est de faire partager et de bien analyser les émotions et les rêveries qui peuvent survenir à la vue de tel ou tel objet en vente aux Puces. Elle en a fait le point de départ de son récit : la narratrice déniche un album de photos et se laisse arrêter par celle d’une tombe. Elle décide de rendre l’album à la famille à laquelle il appartient.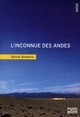
 On ne sait si dans ce premier volume d’une trilogie l’histoire policière est la part la plus importante. C’est aussi un récit autour du handicap. Le narrateur, Rico, est un jeune berlinois qui se décrit comme « maldoué ». Toute l’histoire est vue à travers son regard étonné, souvent naïf, et son caractère à la fois craintif et ombrageux. On voit comme des symptômes ses difficultés face aux chiffres et à l’espace, ses problèmes face à l’implicite, ses rêveries devant les bizarreries de la langue, ses définitions de dictionnaires re-bricolées avec sa propre logique.
On ne sait si dans ce premier volume d’une trilogie l’histoire policière est la part la plus importante. C’est aussi un récit autour du handicap. Le narrateur, Rico, est un jeune berlinois qui se décrit comme « maldoué ». Toute l’histoire est vue à travers son regard étonné, souvent naïf, et son caractère à la fois craintif et ombrageux. On voit comme des symptômes ses difficultés face aux chiffres et à l’espace, ses problèmes face à l’implicite, ses rêveries devant les bizarreries de la langue, ses définitions de dictionnaires re-bricolées avec sa propre logique. La qualité du roman précédent de Yves Grevet, Méto, trilogie de science fiction, créait une attente et c’est sans doute l’une des raisons d’un léger sentiment de déception à la lecture de ce nouveau texte. Il y a une certaine originalité, ce n’est pas mal écrit, mais l’ensemble est moins inventif, moins orienté vers la réflexion critique, et, bizarrement, moins crédible… En effet, Yves Grevet quitte ici le genre de la SF pour le policier, un genre qui demande davantage d’ancrage dans le probable.
La qualité du roman précédent de Yves Grevet, Méto, trilogie de science fiction, créait une attente et c’est sans doute l’une des raisons d’un léger sentiment de déception à la lecture de ce nouveau texte. Il y a une certaine originalité, ce n’est pas mal écrit, mais l’ensemble est moins inventif, moins orienté vers la réflexion critique, et, bizarrement, moins crédible… En effet, Yves Grevet quitte ici le genre de la SF pour le policier, un genre qui demande davantage d’ancrage dans le probable. Un stage peut mener loin, même (ou surtout ?) si on le fait à contrecœur et dans un lieu aussi peu propice à l’aventure qu’une maison de retraite. Pierre vit seul avec sa mère, n’a de goût pour rien et d’énergie pour rien. Dans son stage, il tombe sous la coupe d’un vieil homme asocial et tyrannique qui l’entraine dans une succession de transgressions de plus en plus douteuses et dangereuses.
Un stage peut mener loin, même (ou surtout ?) si on le fait à contrecœur et dans un lieu aussi peu propice à l’aventure qu’une maison de retraite. Pierre vit seul avec sa mère, n’a de goût pour rien et d’énergie pour rien. Dans son stage, il tombe sous la coupe d’un vieil homme asocial et tyrannique qui l’entraine dans une succession de transgressions de plus en plus douteuses et dangereuses.