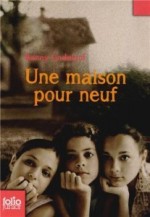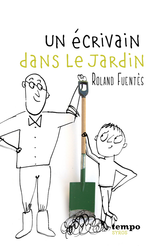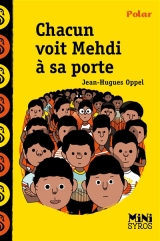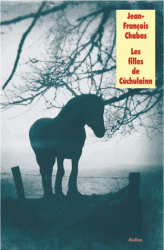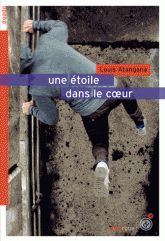L’apprenti
Linda Sue Park
Flammarion (castor poche), 2012 (2003)
Terre de connaissance
Par Jérôme Bezault, master MEFSC Saint-Etienne
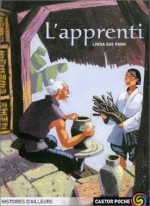 Dans la Corée du XIIème siècle, un jeune orphelin de douze ans aspire à une autre vie que celle qu’il a menée jusqu’à présent. Lichen a une vie compliquée : il vit sous un pont en compagnie du vieil homme qui l’a recueilli alors qu’il n’avait que deux ans, et qui répond au surnom cocasse de « La Grue ». L’animal, symbole de longévité et de fidélité au Japon, en Chine et en Corée, est en effet un reflet fidèle de l’ami du garçon. La première de couverture, par les couleurs, le dessin de la grue et la typographie, invite immédiatement le lecteur à un voyage en Asie.
Dans la Corée du XIIème siècle, un jeune orphelin de douze ans aspire à une autre vie que celle qu’il a menée jusqu’à présent. Lichen a une vie compliquée : il vit sous un pont en compagnie du vieil homme qui l’a recueilli alors qu’il n’avait que deux ans, et qui répond au surnom cocasse de « La Grue ». L’animal, symbole de longévité et de fidélité au Japon, en Chine et en Corée, est en effet un reflet fidèle de l’ami du garçon. La première de couverture, par les couleurs, le dessin de la grue et la typographie, invite immédiatement le lecteur à un voyage en Asie.
Pour se nourrir, les deux protagonistes sont obligés de trier des ordures. Au cours de l’une de ces excursions, Lichen se prend d’admiration pour le travail de maître Min, un potier. La passion et la curiosité l’emportant sur la raison, Lichen s’approche trop près et casse un vase par accident : il propose alors de racheter sa faute en travaillant pour le potier, ce qui va changer sa vie. Linda Sue Park nous parle, sans jamais moraliser, de la responsabilité, de la valeur du travail, de la patienceet de la persévérance, tout en initiant le jeune lecteur à la culture coréenne. Les personnages principaux sont attachants et il est facile de s’identifier à eux, qu’il s’agisse de Lichen et de sa droiture, de La Grue qui philosophe ou du potier Min qui semble toujours cacher quelque chose sous ses airs bourrus.
C’est à travers la poterie que l’on découvre la Corée, le roman permettant une véritable initiation à ce monde, avec des notes en fin d’ouvrage. Ce conte est une belle histoire d’orient, accessible, au vocabulaire simple, porteur de vraies valeurs.