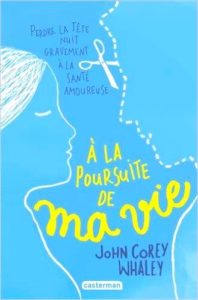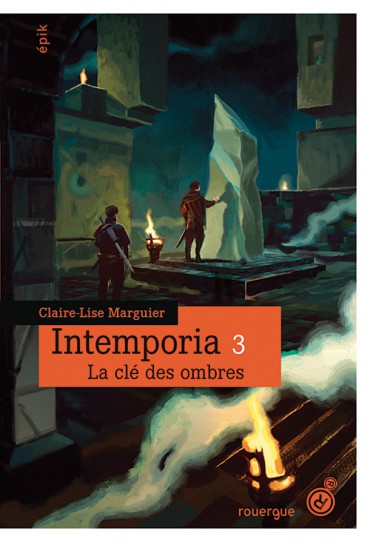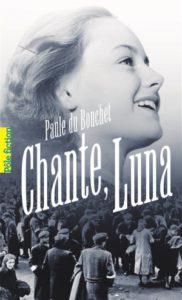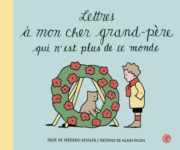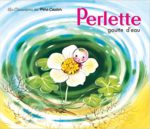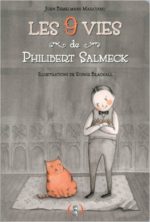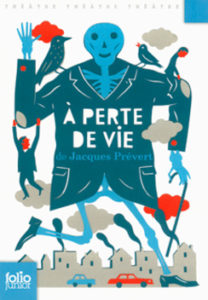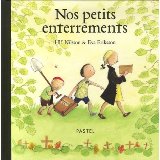Anton et les filles
Anton est-il le plus fort ?
Anton et les rabat-joie
Ole Könnecke
Traduit (allemand) par Florence Seyvos
L’école des loisirs, 2015 [2005], 2014, 2016
Des enfants et des jeux
Par Anne-Marie Mercier
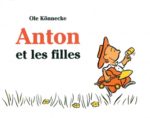 La série des Anton est un régal permanent dont on ne se lasse pas. Son héros, toujours vêtu de blanc et rouge et portant un chapeau rouge, se confronte aux enfants de son âge, garçons et filles, ce qui met en lumière des comportements caractéristiques, souvent genrés, mais pas toujours, dans les jeux et les conflits.
La série des Anton est un régal permanent dont on ne se lasse pas. Son héros, toujours vêtu de blanc et rouge et portant un chapeau rouge, se confronte aux enfants de son âge, garçons et filles, ce qui met en lumière des comportements caractéristiques, souvent genrés, mais pas toujours, dans les jeux et les conflits.
Dans Anton et les filles, la question est de savoir comment s’introduire dans le jeu des autres, être accepté dans un groupe. Faut-il faire étalage de ses qualités, de ses possessions, de ses talents ? Faire « l’intéressant » ? Rien de tout cela, surtout, semble nous dire l’auteur, lorsque l’autre est une fille ou un groupe de filles. La réponse est en apparence simple, mais en fait assez retorse…
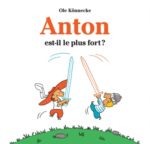 Anton est-il le plus fort ? met en scène deux garçons, Anton et Luckas qui se placent en compétition sur cette question cruciale et font assaut d’exagération et de comparaison, montrant qu’un assaut verbal est possible et efficace. Les propositions imaginaires sont inscrites en traits de crayons de couleur, rouge pour Luckas (qui est vêtu de bleu) et bleu pour Anton (toujours en rouge). La chute est comique et met les deux enfants à égalité, tandis que la fin montre que tout cela n’était que des mots, qu’un jeu…
Anton est-il le plus fort ? met en scène deux garçons, Anton et Luckas qui se placent en compétition sur cette question cruciale et font assaut d’exagération et de comparaison, montrant qu’un assaut verbal est possible et efficace. Les propositions imaginaires sont inscrites en traits de crayons de couleur, rouge pour Luckas (qui est vêtu de bleu) et bleu pour Anton (toujours en rouge). La chute est comique et met les deux enfants à égalité, tandis que la fin montre que tout cela n’était que des mots, qu’un jeu…
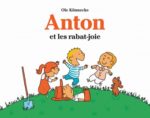 Anton et les rabat-joie est sans doute le plus subtil. On est ici très proche de la psychologie enfantine, où le désastre de ne pas être accepté équivaut à la mort, où la mort est fantasmée (c’est quoi, être mort ? on ne bouge pas, on ne joue pas…) : Anton, refusé dans un jeu par ses amis habituels (Luckas, Greta et Nina), décide qu’il est mort et se couche. Luckas le rejoint bientôt, fâché avec les filles à qui il a emprunté une pelle (pour enterrer Anton, bien sûr) ; puis vient le tour de Nina, fâchée et enfin de Greta qui n’a plus personne avec qui jouer puisqu’ils sont tous morts. Les quatre enfants, couchés ne bougent plus… mais la pluie, mais les fourmis… Au calme succède l’explosion finale et les rires. Le récit se referme sur lui-même et sur le gouter proposé par Anton à ses amis.
Anton et les rabat-joie est sans doute le plus subtil. On est ici très proche de la psychologie enfantine, où le désastre de ne pas être accepté équivaut à la mort, où la mort est fantasmée (c’est quoi, être mort ? on ne bouge pas, on ne joue pas…) : Anton, refusé dans un jeu par ses amis habituels (Luckas, Greta et Nina), décide qu’il est mort et se couche. Luckas le rejoint bientôt, fâché avec les filles à qui il a emprunté une pelle (pour enterrer Anton, bien sûr) ; puis vient le tour de Nina, fâchée et enfin de Greta qui n’a plus personne avec qui jouer puisqu’ils sont tous morts. Les quatre enfants, couchés ne bougent plus… mais la pluie, mais les fourmis… Au calme succède l’explosion finale et les rires. Le récit se referme sur lui-même et sur le gouter proposé par Anton à ses amis.