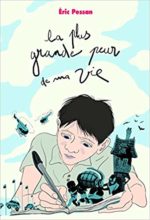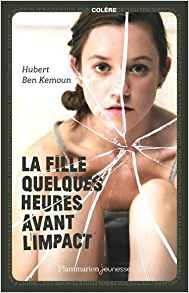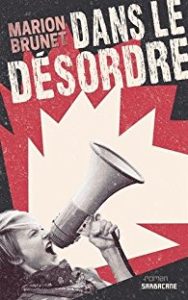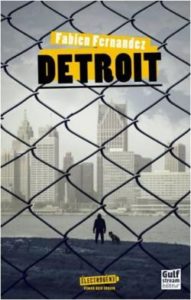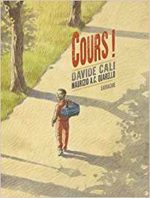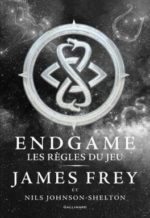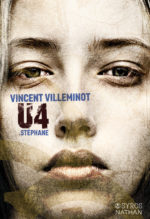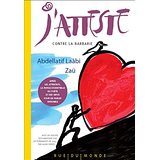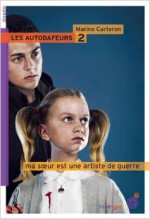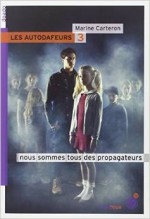Halte à la bagarre !
Caroline Pelissier – Virginie Aladjidi – Illustrations de Kei Lam
Casterman 2020
La communication pacifiste expliquée aux enfants
Par Michel Driol
 A qui appartient l’acacia majestueux de la savane ? Il abrite trois amis : un chacal, Nico, un zèbre, Alfred, et un singe, Johnny. Mais un jour, parce qu’il est gêné par les deux autres dans son sommeil, l’un prétend en être l’unique propriétaire. Et les deux autres de revendiquer l’arbre eux-aussi pour eux seuls. Le ton monte, la bagarre éclate, dévastant quelque peu l’arbre. Arrive alors la girafe au grand cœur, Thérésa, qui réfléchit au lieu de parler, et leur propose d’expliquer les raisons de leur colère. Chacun découvre alors pourquoi l’autre tient à l’acacia, et la paix revient.
A qui appartient l’acacia majestueux de la savane ? Il abrite trois amis : un chacal, Nico, un zèbre, Alfred, et un singe, Johnny. Mais un jour, parce qu’il est gêné par les deux autres dans son sommeil, l’un prétend en être l’unique propriétaire. Et les deux autres de revendiquer l’arbre eux-aussi pour eux seuls. Le ton monte, la bagarre éclate, dévastant quelque peu l’arbre. Arrive alors la girafe au grand cœur, Thérésa, qui réfléchit au lieu de parler, et leur propose d’expliquer les raisons de leur colère. Chacun découvre alors pourquoi l’autre tient à l’acacia, et la paix revient.
Voilà une fable qui montre, en action, la communication non violente appliquée à un cas concret. L’album fait le choix de la distanciation, avec des animaux, l’Afrique, une situation bien loin des conflits de cour de récréation ou dans la famille. Les illustrations sont particulièrement expressives pour montrer la montée de la violence. On voit bien qu’il est question de revendiquer pour soi seul un coin de territoire, de ne pas accepter de partager quelque chose. Prendre le temps de réfléchir, apprendre à verbaliser ses émotions, ses sentiments, à mettre des mots sur ce qu’on ressent, voilà une façon d’apprendre à gérer les conflits. Trois pages explicatives, à destination des enfants pour les unes des parents ou des éducateurs pour l’autre, permettent d’aller plus loin.
Un album didactique pour apprendre à gérer les conflits.