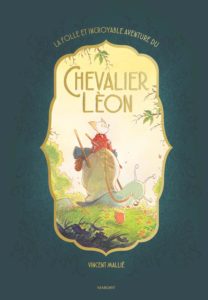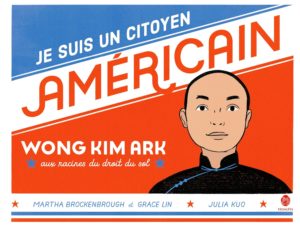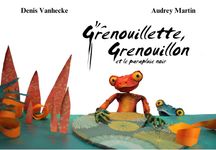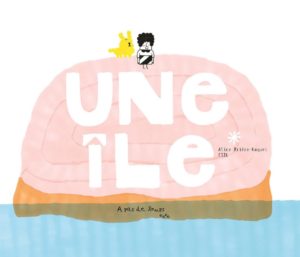Ida et Martha des bois
Ilya Green
Didier Jeunesse 2024
Deux petites filles en quête de liberté
Par Michel Driol
 A l’orée du bois, Ida et Martha s’interrogent. Y a-t-il des enfants comme elles qui y vivent ? C’et alors que surgit un renard qui les conduit au cœur de la forêt, à la rencontre d’autres enfants aux tenues chamarrées qui s’empressent de peindre les belles robes blanches. De retour à la maison, elles voient leur mère désapprouver leur tenue, et, le lendemain, une clôture entoure le jardin Le renard creuse un tunnel pour leur permettre de retourner dans la forêt. Le soir, elles sont punies, et la clôture est devenue infranchissable. Elles écrivent une lettre à leurs parents, et s’évadent pour rejoindre leurs amis de la forêt. La lecture de cette lettre conduit les parents à comprendre et à renouer le lien avec leurs fillettes.
A l’orée du bois, Ida et Martha s’interrogent. Y a-t-il des enfants comme elles qui y vivent ? C’et alors que surgit un renard qui les conduit au cœur de la forêt, à la rencontre d’autres enfants aux tenues chamarrées qui s’empressent de peindre les belles robes blanches. De retour à la maison, elles voient leur mère désapprouver leur tenue, et, le lendemain, une clôture entoure le jardin Le renard creuse un tunnel pour leur permettre de retourner dans la forêt. Le soir, elles sont punies, et la clôture est devenue infranchissable. Elles écrivent une lettre à leurs parents, et s’évadent pour rejoindre leurs amis de la forêt. La lecture de cette lettre conduit les parents à comprendre et à renouer le lien avec leurs fillettes.
Ce bel album évoque avec force et poésie la tension entre le besoin de sécurité et celui de liberté des enfants, entre l’ordre familial et le désordre du monde extérieur. D’un côté, il y a la maison, qu’on devine bourgeoise, un peu caricaturale, avec des parents et une cuisinière, un parquet brillant au point de Hongrie, une maison où tout est à sa place, à l’image du chat sur le fauteuil. Maison rassurante aussi, celle de la bonne odeur du diner et des câlins du soir. Face à cela, la forêt, lieu de l’interdit, lieu des mystères, lieu à découvrir, lieu du désordre des lianes et des branches, lieu des enfants libres, libres de se rouler dans la boue, de danser ou de se baigner. Entre les deux, il y a les deux sœurs partagées entre ces deux lieux, entre ces deux besoins, qui décideront de partir, de trouver la liberté qui leur manque à la maison. C’est ce moment-clef de l’enfance que l’autrice saisit et dépeint, ce moment d’hésitation entre le confort du nid qu’on hésite à quitter et l’appel du large.
Le texte, écrit dans une langue sensible, est particulièrement travaillé pour suivre le point de vue des deux fillettes dans leur découverte d’un autre monde possible. A l’image de l’incipit « Ida regardait Martha. Et Martha regardait la forêt », un double regard qui donne à lire à la fois la bulle dans laquelle vivent les deux fillettes et l’ouverture vers le dehors. Par la suite, le texte évoque les représentations des fillettes sur la forêt, représentations qu’on devine dictées par les propos de parents qui en interdisent l’accès, les sentiments, les émotions, les joies et des peurs des héroïnes, afin qu’on soit au plus près d’elles lorsqu’elles prennent la décision de partir.
Les illustrations, essentiellement à partir de papiers découpés, donnent à voir ces univers. Celui de la forêt, représenté de façon quelque peu naïve, à la façon d’un douanier Rousseau, lieu de la couleur, des formes chatoyantes, celui de la maison plus géométrique. Il faut voir aussi la façon dont sont rendues les attitudes de tous les personnages, celle de la bande d’enfants des bois, pleins de vie, saisis dans des postures qui contrastent avec l’aspect hiératique de parents, et voir défiler sur le visage des deux fillettes toute une gamme variée d’émotions. La force des illustrations vient aussi des cadrages choisis et de la composition, toujours maitrisée, des planches, magnifiées par le grand format de l’album qui permet de percevoir tous les détails, et, en particulier, les nombreux animaux qui peuplent cette forêt, dont le magnifique renard.
Un album qui pose la question de l’éducation, et de la voie que doit choisir chaque individu entre les normes sociales, les bienséances, le respect des convenances et son émancipation, ici son épanouissement au plus près de la nature, de sa nature peut-être. Tout en les opposant, l’album appelle à ne pas rompre les liens familiaux et se termine par la manifestation de l’amour qui va au-delà des façons de vivre et de sentir. Eduquer, c’est, étymologiquement, faire sortir de. Ce n’est donc pas entourer de barrières aussi protectrices qu’aliénantes, mais permettre de les franchir.
 Voilà un album qui propose une série de situations dans lesquelles le Père Noël ne se trouvera jamais. Faire sa tournée en skate, se tromper de cadeaux, déballer les cadeaux et jouer avec ou encore confondre Pâques avec Noël. En contrepoint se dessine la figure d’un père Noël exact, infaillible, parfait !
Voilà un album qui propose une série de situations dans lesquelles le Père Noël ne se trouvera jamais. Faire sa tournée en skate, se tromper de cadeaux, déballer les cadeaux et jouer avec ou encore confondre Pâques avec Noël. En contrepoint se dessine la figure d’un père Noël exact, infaillible, parfait !