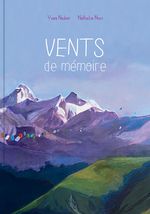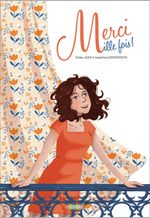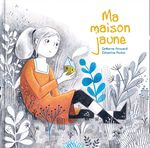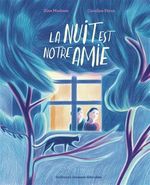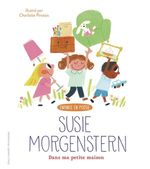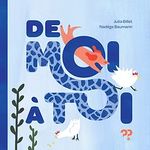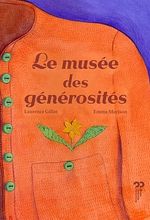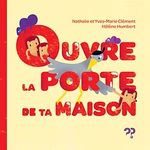Alexander von Humboldt, Explorateur de l’extrême
Rocio Martinez
Saltimbanque 2025
Faire l’expérience de la nature avec ses émotions
Par Michel Driol
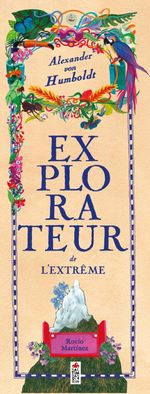 Ce documentaire assez particulier rend vivante la figure d’un explorateur assez méconnu en France, Alexander von Humboldt. Avec une formation d’ingénieur des mines, il a été aussi bien naturaliste que géographe ou géologue. Ses voyages l’ont conduit en Amérique, entre sommets volcaniques et fleuves comme l’Amazone ou l’Orénoque, entre la côte de l’Atlantique et celle du Pacifique, mais aussi aux confins de la Chine et de la Russie. Il a cartographié, herborisé, et passé sa vie à tenter de comprendre les interactions entre les forces naturelles, autour du début du XIXème siècle.
Ce documentaire assez particulier rend vivante la figure d’un explorateur assez méconnu en France, Alexander von Humboldt. Avec une formation d’ingénieur des mines, il a été aussi bien naturaliste que géographe ou géologue. Ses voyages l’ont conduit en Amérique, entre sommets volcaniques et fleuves comme l’Amazone ou l’Orénoque, entre la côte de l’Atlantique et celle du Pacifique, mais aussi aux confins de la Chine et de la Russie. Il a cartographié, herborisé, et passé sa vie à tenter de comprendre les interactions entre les forces naturelles, autour du début du XIXème siècle.
Très classiquement, l’album retrace de façon assez chronologique la vie de Humboldt, trois pages mettant l’accent sur ses grandes intuitions, la connexion du monde par l’eau, l’air et la terre. Chaque page associe, comme de coutume dans ce type d’album, des textes offrant des explications, courts, agréables à lire, et des illustrations.
L’originalité est ici double. D’abord elle vient du format choisi, un format très allongé et très étroit, mais, quand on l’ouvre, les pages permettent de déployer deux rabats, proposant ainsi des pages d’un format assez gigantesque, à l‘image du monde à découvrir, du monde parcouru par cet explorateur aussi hors norme que l’album. La seconde originalité vient de l’esthétique choisie pour les illustrations. On est loin d’un dessin qui se voudrait scientifique ou neutre. Il s’agit plutôt ici de reprendre les couleurs, les codes des peintures aztèques ou mayas. Très fouillées, très complexes, les illustrations sont à explorer sur chacune des pages, mettant ainsi la sagacité et la curiosité du lecteur en éveil, à la façon de l’homme dont il retrace la vie et les découvertes. On notera que par ailleurs les cartes, bien volontairement, ne respectent pas forcément les distances, n’ont pas les codes habituels pour être beaucoup plus dans l’esprit des cartes anciennes laissant une part importante à l’imaginaire dans une représentation plus naïve du monde.
Un album qui replace bien Humboldt dans son époque, ne cherche pas à faire de lui un précurseur, ne cherche pas à monter de façon explicite tout ce que nous lui devons (la notion d’isotherme, ou encore la mise en évidence des différentes interactions entre les éléments naturels, dont l’homme…), un album qui fait le portrait d’un homme de son temps, un savant encyclopédiste, héritier des lumières et très sensible à la dignité des hommes, et révolté par toutes les formes d’esclavage.