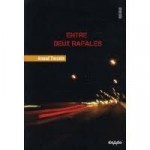Les Rebelles de St Daniel (2) : Ismaël part en live
Michael Gerard Bauer
La joie de lire, 2012
Amour, foot et poésie
Par Anne-Marie Mercier
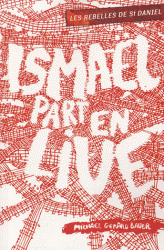 On retrouve avec plaisir l’univers d’Ismaël (voir la recension du premier volume), adolescent maladroit, malchanceux et mal à l’aise, et de ses amis tous un peu bizarres, Razza extraverti et vulgaire, Ignatius le matheux, Bill le timide, Scobie agité de tics et génial. On retrouve également le concours d’éloquence (qu’ils avaient gagné dans le premier volume contre toute attente et auquel ils échouent cette fois lamentablement) et l’éternelle confrontation avec la bande de la brute du collège.
On retrouve avec plaisir l’univers d’Ismaël (voir la recension du premier volume), adolescent maladroit, malchanceux et mal à l’aise, et de ses amis tous un peu bizarres, Razza extraverti et vulgaire, Ignatius le matheux, Bill le timide, Scobie agité de tics et génial. On retrouve également le concours d’éloquence (qu’ils avaient gagné dans le premier volume contre toute attente et auquel ils échouent cette fois lamentablement) et l’éternelle confrontation avec la bande de la brute du collège.
Mais il y a aussi de la variation qui rend ce volume différent, heureusement : la brute se trouve confrontée à elle-même par l’intervention d’un psychologue, Ismaël tente de conquérir la belle Kelly par le seul charme de la parole et subit de lourds échecs avant de faire quelques progrès et suivre le conseil majeur (« être soi même »), il découvre aussi que ses enseignants et même le proviseur sont des êtres humains capables de le surprendre et que son père peut redevenir une star du rock.
Enfin, le clou du récit et ce qui en fait le moteur, est le cours de poésie de la professeure d’anglais (qui serait celle de français chez nous) qui arrive à les convaincre encore une fois de la force du verbe et de la nécessité d’en user avec finesse et tact, même dans la vie quotidienne – et parfois pour séduire, comme Shakespeare. On peut ajouter un autre morceau de bravoure autour du football, avec le débat qui tourne autour des bienfaits ou méfaits de cette passion lors du concours d’éloquence et la démonstration par le récit d’un match épique où l’un des joueurs démontre qu’on peut jouer bien en faisant semblant de jouer mal et tout faire pour éviter de perdre sans pour autant vouloir gagner. De la philosophie en action, donc, pleine de moments cocasses racontés à travers le prisme comique de la perpétuelle inquiétude du héros.

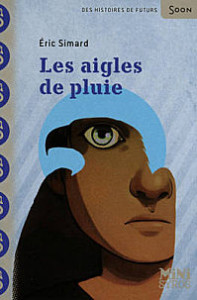

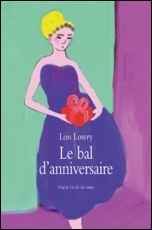


 Ils ont seize ans, ils sont beaux, ils sont bons élèves, ils habitent Versailles, ils écoutent Tom Waits sur leur iPod, mais ils jouent de la musique classique dans un orchestre et on leur pardonne aisément de confondre parfois Schubert et Schumann qui ne sont pas de leur génération – Tom Waits non plus d’ailleurs n’est pas de leur génération. Ils ont vu Good Bye Lenine et savent que le héros de Scream porte le masque du Cri (de Munch).
Ils ont seize ans, ils sont beaux, ils sont bons élèves, ils habitent Versailles, ils écoutent Tom Waits sur leur iPod, mais ils jouent de la musique classique dans un orchestre et on leur pardonne aisément de confondre parfois Schubert et Schumann qui ne sont pas de leur génération – Tom Waits non plus d’ailleurs n’est pas de leur génération. Ils ont vu Good Bye Lenine et savent que le héros de Scream porte le masque du Cri (de Munch).
 « Un jour je suis mort » : un titre accrocheur que cette phrase découverte par Youmi sur la page de garde du journal intime de son copain Jaijoun, mort deux mois auparavant dans un accident de moto. La maman de ce dernier n’a pas eu la force de lire le cahier bleu et le lui a confié. L’intérêt du roman tient surtout dans la découverte, au fil des semaines, des réactions de Youmi, une adolescente écorchée vive, pétrie de culture coréenne mais aux préoccupations finalement très semblables à celles des adolescentes européennes.
« Un jour je suis mort » : un titre accrocheur que cette phrase découverte par Youmi sur la page de garde du journal intime de son copain Jaijoun, mort deux mois auparavant dans un accident de moto. La maman de ce dernier n’a pas eu la force de lire le cahier bleu et le lui a confié. L’intérêt du roman tient surtout dans la découverte, au fil des semaines, des réactions de Youmi, une adolescente écorchée vive, pétrie de culture coréenne mais aux préoccupations finalement très semblables à celles des adolescentes européennes.