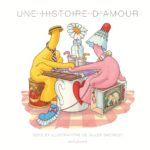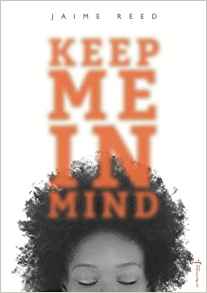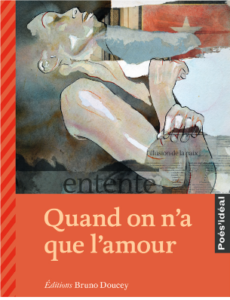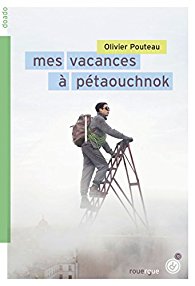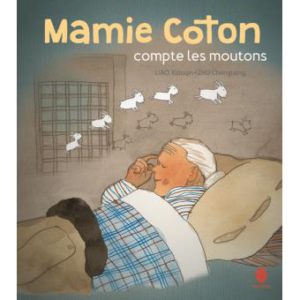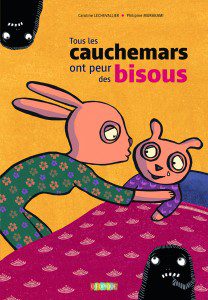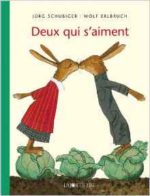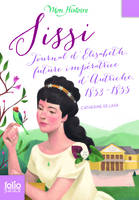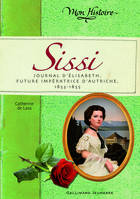La Chanson d’Orphée
David Almond
traduit (anglais) par Diane Ménard
Gallimard jeunesse (grand format), 2017
Grèce éternelle
Par Anne-Marie Mercier
 Le mythe d’Orphée est ici parfaitement revisité : tout y est : Eurydice (qui s’appelle ici Ella) qu’il perd puis retrouve, puis perd à nouveau, les serpents meurtriers, les bacchantes, les animaux et les humains subjugués par ses chants et sa lyre. Orphée tient en partie à l’ange du Théorème de Pasolini : il séduit toutes et tous. Il incarne un rêve de bonheur infini, de beauté absolue, d’harmonie.
Le mythe d’Orphée est ici parfaitement revisité : tout y est : Eurydice (qui s’appelle ici Ella) qu’il perd puis retrouve, puis perd à nouveau, les serpents meurtriers, les bacchantes, les animaux et les humains subjugués par ses chants et sa lyre. Orphée tient en partie à l’ange du Théorème de Pasolini : il séduit toutes et tous. Il incarne un rêve de bonheur infini, de beauté absolue, d’harmonie.
Mais tout cela se passe à l’époque contemporaine, au Royaume-Uni, dans le Northumberland, pays minier sinistré où les adolescents rêvent de Grèce et de soleil. Ella est en terminale et elle est depuis leur enfance l’amie très proche de Claire, la narratrice, le témoin de l’histoire. Claire raconte comment elle a fait se rencontrer les amoureux, comment Ella est morte, et ce que Orphée lui a raconté de sa descente aux enfers, tout près des égouts du lieu. Pour se faire le témoin, elle se fait chœur à l’antique et se confectionne un masque qui lui permet de proférer les décrets du destin : elle parle pour Orphée, pour dire l’indicible, l’impossible, la vérité absolue.
Le roman de David Almond est à la
fois lumineux et sombre. Lumineux comme ces vacances dans le nord, au bord de
la mer, où Claire et ses amis jouent à être en Grèce et s’enivrent de liberté,
de vin et de clarté (d’où son nom). Sombre comme le ressentiment de la foule ordinaire
contre ceux qui leur échappent, avant même le travail des bacchantes, sombre comme
l’enfer, et comme la mort, comme les pages imprimées en caractères blancs sur
fond noir à l’intérieur du roman (comme dans un roman précédent, intitulé
« Je m’appelle Mina et j’aime la nuit »). Mais le désespoir cède au
bonheur de la révélation donnée par Orphée aux humains : même après sa
disparition, le sentiment de l’harmonie universelle est là et on le retrouve
partout dans la nature, sorte d’avatar d’un autre dieu, le dieu Pan, à moins
qu’il ne soit l’incarnation de la musique.