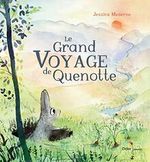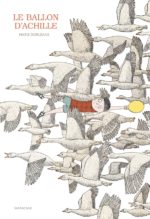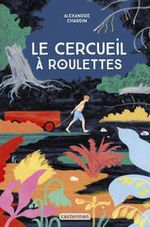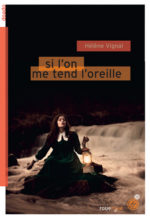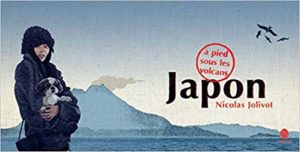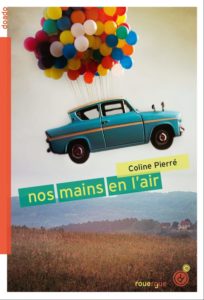Nos mains en l’air
Coline Pierré
Rouergue 2019
Eloge de la fugue
Par Michel Driol
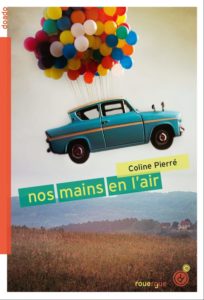 D’un côté, Yazel, orpheline, sourde, adoptée par sa richissime tante … imbue d’elle d’elle-même et très antipathique à son égard. De l’autre, Victor, né et élevé dans une famille de braqueurs, obligé par un père tyrannique de suivre la voie familiale, mais ne désirant que d’y échapper. Lorsque Victor cambriole la maison d’Yazel, elle le surprend, lui indique comment ouvrir le coffre-fort, et lui demande de l’emmener loin de cet univers sans joie, en Bulgarie, pour y disperser les cendres de ses parents. Et Victor accepte… Les voilà tous les deux sur les routes d’Europe, d’Angers à la Bulgarie, en passant par Venise, le jeune homme de 21 ans et la jeune fille de 12 ans, l’un apprenant la langue des signes pour communiquer avec elle, l’autre demandant à ce presque frère, presque père de l’adopter…
D’un côté, Yazel, orpheline, sourde, adoptée par sa richissime tante … imbue d’elle d’elle-même et très antipathique à son égard. De l’autre, Victor, né et élevé dans une famille de braqueurs, obligé par un père tyrannique de suivre la voie familiale, mais ne désirant que d’y échapper. Lorsque Victor cambriole la maison d’Yazel, elle le surprend, lui indique comment ouvrir le coffre-fort, et lui demande de l’emmener loin de cet univers sans joie, en Bulgarie, pour y disperser les cendres de ses parents. Et Victor accepte… Les voilà tous les deux sur les routes d’Europe, d’Angers à la Bulgarie, en passant par Venise, le jeune homme de 21 ans et la jeune fille de 12 ans, l’un apprenant la langue des signes pour communiquer avec elle, l’autre demandant à ce presque frère, presque père de l’adopter…
On passe bien sûr sur toutes les péripéties, la recherche par les familles, les dangers : voilà un roman qui se lit presque comme un thrilleur, commençant par une scène nerveuse de braquage. Mais c’est surtout un roman qui parle de rencontre et qui s’intéresse à la psychologie, aux réactions, au ressenti de ses personnages avec beaucoup d’humanité. Yazel, sourde et lourdement appareillée, que l’histoire familiale a fait passer d’un coup à cause de la mort de ses parents, d’un univers baba-cool et aimant à la sècheresse bourgeoise de la tante, a toute l’espièglerie, le don de répartie, la force et la fragilité d’une adolescente. Victor, personnage paradoxal, braqueur malgré lui et écoutant dans une association d’aide aux victimes, n’arrête pas de dire qu’il est désolé. Tous deux tentent de trouver leur place dans le monde, soit en rupture avec leur famille, soit pour continuer – par les lettres aux parents – le lien ténu avec les morts. La force du roman est démontrer comment ces deux-là vont s’apprivoiser avec pudeur, se découvrir dans leurs différences et leurs singularités. Le roman est fait de conversations tout au long de la route où chacun peut se dire et dire le monde qui l’entoure, en décrire les sons et les formes. Car la langue et le langage sont aussi au cœur du roman : la langue des signes, la langue maternelle, la langue du peuple, la langue de la bourgeoisie… Comment aller au-delà de ces différences pour apprendre la langue de l’autre et communiquer avec lui ?
Rien de mièvre ou de convenu dans ce roman qui reprend les thèmes du Bon Gros Géant ou du film Paper Moon dans l’exploration d’une relation entre un adulte qui devient protecteur d’une enfant, malgré lui, et cette enfant. Se trouver, se reconnaitre, c’est fuir, s’émanciper et échapper à sa famille, dans une complicité amicale et chaleureuse. Toutefois l’auteure porte deux regards différents sur les familles : autant la tante ne trouve pas grâce à ses yeux – caricaturée, excessive, mesquine, insupportable jusqu’au bout, autant le père de Victor devient petit à petit un personnage sympathique, humain dans son comportement pataud. Par ailleurs, le roman se tient sur une ligne étroite qui, par moments, dans la bouche du père, justifie ce travail de voleur. Les banquiers ne font pas un travail plus honnête, dit-il…
Le roman fait voyager dans des milieux et des lieux décrits avec le regard naïf des deux protagonistes : hôtel de luxe à Lyon – et assiettes gastronomiques !, lacs italiens, Venise en période d’acqua alta, frontière glauque entre la Roumanie et la Bulgarie, sans oublier les aires de repos des autoroutes. Ainsi c’est aussi à une découverte du monde qui nous entoure que ce roman invite son lecteur.
Un roman riche qui aborde, sans didactisme, mais avec sensibilité, des thèmes très actuels.
 Sur le principe de Trouvez Charlie, voici 16 énigmes dans le monde du transport.
Sur le principe de Trouvez Charlie, voici 16 énigmes dans le monde du transport.