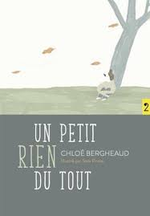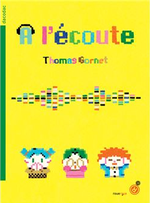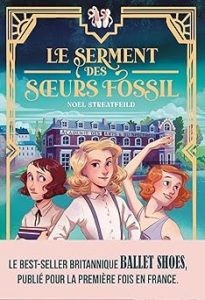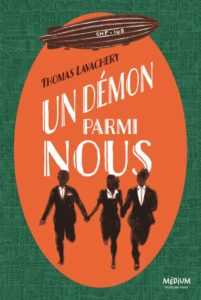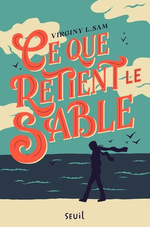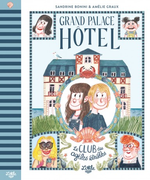Le Voyage de Diego
Véronique Foz et L.R. Katims – Illustrations d’Aurélie Guarino
Tom Pousse 2025 Collection Adodys
Un pas après l’autre jusqu’à l’horizon
Par Michel Driol
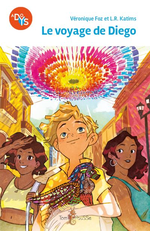 Diego, enfant dyslexique, redoute sa rentrée en sixième. Ses parents se sont séparés, et il part avec sa sœur et sa mère rencontrer la famille de cette dernière, au Mexique. Outre sa famille proche, oncle, grand-mère, tante, cousins, il y découvre tout un pays où l’on sculpte des animaux fantastiques dans un bois spécial, les alebrijes. Et si cet art était pour lui un domaine de réussite et de passion ?
Diego, enfant dyslexique, redoute sa rentrée en sixième. Ses parents se sont séparés, et il part avec sa sœur et sa mère rencontrer la famille de cette dernière, au Mexique. Outre sa famille proche, oncle, grand-mère, tante, cousins, il y découvre tout un pays où l’on sculpte des animaux fantastiques dans un bois spécial, les alebrijes. Et si cet art était pour lui un domaine de réussite et de passion ?
Le roman dresse le portrait touchant d’un jeune garçon souffrant, au sens premier, de sa dyslexie. Il évoque ses difficultés, mais aussi et surtout, avec précision et sensibilité, sa façon de vivre – ou plutôt de mal vivre – ce qui le handicape, le fait passer pour un nul aux yeux de son père. C’est ensuite le portrait d’une famille franco-mexicaine, portrait avec ses non-dits, ses implicites, sur la violence au moins verbale du père, et la façon, contrastée, dont les deux enfants vivent la séparation et le rapport avec leur père. Mais c’est enfin le portrait d’un pays, le Mexique, un portrait loin des caricatures et des sentiers battus. Un pays présenté tout en contraste, entre modernité des autocars, voitures dans le métro réservées aux femmes, menaces d’enlèvements, et tradition qui sait préserver le sens de la magie et du surnaturel, et l’attention portée aux autres. Avec un certain pittoresque, le récit décrit un défilé de mariage, la visite chez une vielle amie de la grand-mère, guérisseuse autant du corps que de l’âme, qui aura les mots pour redonner à Diego la confiance en lui qui lui manque, et l’atelier d’un sculpteur qui enseigne les rudiments de la création des alebrijes à Diego.
A quoi sert de voyager si tu t’emmènes avec toi ? C’est d’âme qu’il faut changer, non de climat. Cette citation de Sénèque s’applique parfaitement à ce récit, qui montre comment un voyage peut faire changer le regard sur soi, faire grandir, ouvrir les yeux. Découverte de l’amour pour la sœur de Diego, découverte d’une passion pour la sculpture et le fantastique pour Diego, découverte d’une histoire familiale inconnue, des raisons du départ pour la France de la mère, le voyage est l’occasion de multiples transformations pour les deux héros.
Un récit enlevé, dépaysant, écrit dans une langue simple, accessible par sa syntaxe et son lexique (expliqué en fin de livre pour les mots spécifiques à la culture mexicaine), qui pourra être lu aussi bien par des enfants souffrants de dyslexie pour y voir des héros semblables à eux que par des non-dyslexiques, qui comprendront mieux la psychologie et le ressenti de ceux qui souffrent de ce handicap. Ajoutons que, comme toujours dans cette collection, on trouve des repères pour faciliter la lecture : la présentation illustrée des personnages et du contexte en début de roman, des illustrations permettant une pause, et une police de caractères adaptée.