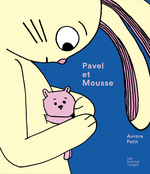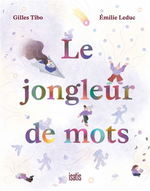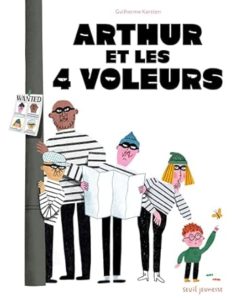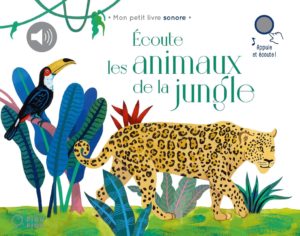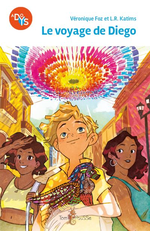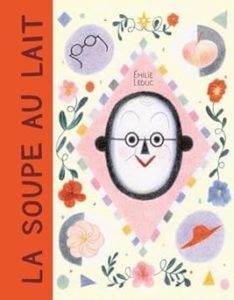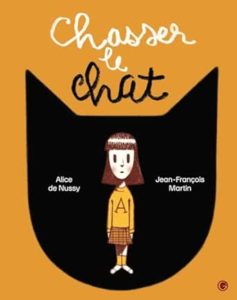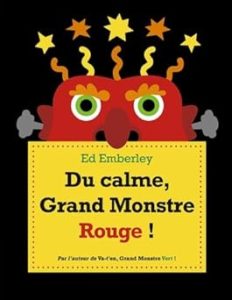Comment fonctionne une maitresse ?
Susanna Mattiangeli – Chiara Carrer
Rue du Monde 2013
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les maitresses
Par Michel Driol
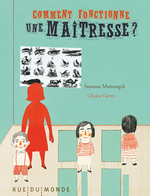 Si vous voulez apprendre quelles sont les différentes sortes de maitresses – les courtes, les larges et les minces –, ce qu’il y a à l’intérieur des maitresses – des tables de multiplication, des fleuves, des montages –, ou à quoi ressemblaient les maitresses préhistoriques, ce livre est pour vous !
Si vous voulez apprendre quelles sont les différentes sortes de maitresses – les courtes, les larges et les minces –, ce qu’il y a à l’intérieur des maitresses – des tables de multiplication, des fleuves, des montages –, ou à quoi ressemblaient les maitresses préhistoriques, ce livre est pour vous !
Avec beaucoup d’humour et d’originalité, tant dans l’approche textuelle que dans les illustrations – cet album évoque ce personnage si important dans la vie de tous les enfants, la maitresse (parfois un maitre, pourtant, selon l’album). A une époque où il est de bon ton de dénigrer les enseignants, mais à une époque aussi où leur recrutement se fait de plus en plus difficile, pour de nombreuses raisons, voici un livre à conseiller à toutes et à tous. Un livre pour que les plus âgés se souviennent de leurs maitresses, de celles – et de ceux – qui les ont marqués, qu’ils rencontrent aussi dans la rue. Un album pour évoquer la nostalgie de ces années d’école, et pour dire ce qu’on éprouve souvent en retournant en classe : la salle est devenue plus petite, la maitresse aussi. Façon de dire comment ils étaient perçus avec des yeux d’enfants…
Pour les enfants qui liront cet album, ce sera l’occasion de reconnaitre leur maitresse parmi celles présentées, sa façon de s’adresser à eux, en chantonnant, en détachant les syllabes, ou en hurlant… Sa taille, ses vêtements. Ce sera l’occasion de retrouver tous les savoirs qu’elle possède, la relation qu’elle entretient avec eux, car l’album, on l’aura compris, donne une vision très positive des maitresses, de l’ambiance de l’école.
Cet hommage aux enseignants est porté par un texte qui joue sur la poésie, mais aussi sur le côté scientifique, avec ses classifications loufoques, ses descriptions à la fois réalistes et pleines d’humour. Faites surtout avec des collages, les illustrations utilisent le matériel scolaire, les cartes, le papier millimétré, pour entrainer dans un univers assez surréaliste où les maitresses peuvent être enracinées au sol. Si le texte et l’illustration se moquent parfois gentiment des travers des maitresses, c’est, au final, un grand sentiment de reconnaissance qui se dégage de l’ensemble.
Un album qui ne s’est pas démodé pour dire l’importance des enseignants dans la vie de tous, mais aussi pour évoquer, avec nostalgie, les années d’école, quand le monde et les adultes paraissaient immenses…