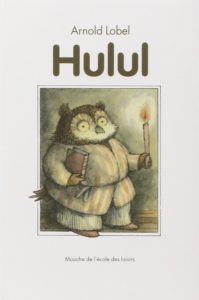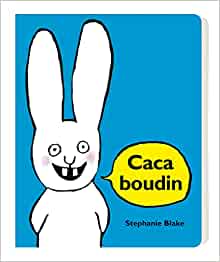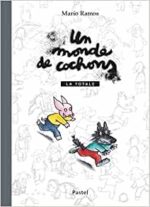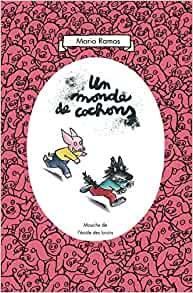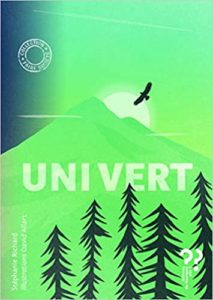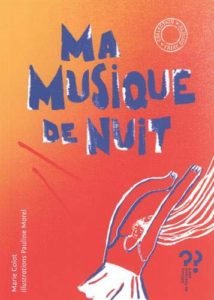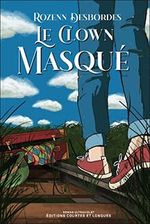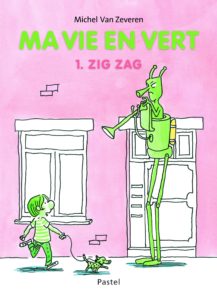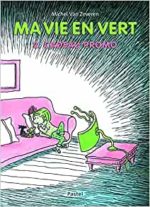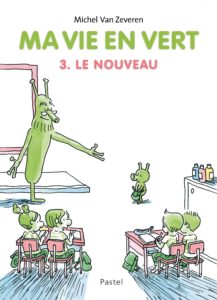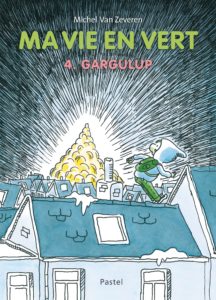Amour bleu
Raphaëlle Frier illustrations de Kam
Editions du Pourquoi pas 2022
Le bleu est-il une couleur chaude ?
Par Michel Driol
 Ce premier roman graphique des Editions du Pourquoi pas est une belle réécriture contemporaine du célèbre conte de Perrault La Barbe bleue, façon de dire l’actualité de ce texte à une époque où les féminicides sont dénombrés et dénoncés (On en comptait 122 en France en 2021, soit 20% de plus qu’en 2020).
Ce premier roman graphique des Editions du Pourquoi pas est une belle réécriture contemporaine du célèbre conte de Perrault La Barbe bleue, façon de dire l’actualité de ce texte à une époque où les féminicides sont dénombrés et dénoncés (On en comptait 122 en France en 2021, soit 20% de plus qu’en 2020).
Du conte de Perrault, on conserve le cadre général : un homme richissime à la barbe bleue, toutefois non point inquiétante mais rassurante comme un ciel bleu sans nuages, la sœur Anne, l’amour qui unit les deux personnages, le départ de l’homme et l’interdiction d’utiliser la petite clef… Mais le récit est actualisé : tout se passe à notre époque.
On le voit, si Amour bleu conserve la trame générale du conte de Perrault, il l’actualise avec intelligence. D’abord dans sa forme, puisqu’on passe d’un conte traditionnel à un roman graphique qui associe avec subtilité différentes techniques pour raconter l’histoire. D’abord le récit à la première personne, dans une langue très contemporaine, façon de mieux pénétrer la sensibilité de l’héroïne, son attirance pour ce riche homme bien loin de son milieu d’origine. Ensuite les illustrations en double page, façon de ponctuer les temps forts de l’histoire, tantôt muettes, tantôt incluant des dialogues dans une langue aussi orale que vivante, caractérisant bien les personnages. Enfin les multiples vignettes, façon bande dessinée, façon de donner vie aux personnages et de jouer sur le rythme de la narration. Mais il est aussi actualisé dans son contenu même. D’abord en diversifiant les milieux sociaux. On a d’un côté le riche pervers, vivant dans un moulin, grand ordonnateur de fêtes, séducteur, esthète raffiné en apparence, mais menaçant quand nécessaire et surtout dangereux. De l’autre trois jeunes plus marginaux, les deux sœurs et leur colocataire, prêts à taper l’incruste chez Barbe bleue. Marie, l’héroïne, en particulier, vit sa nouvelle existence au Moulin comme une espèce de fête perpétuelle, bien loin de son quotidien d’employée ordinaire qu’elle n’hésite pas à abandonner… Cette dimension sociologique n’est pas innocente, on s’en doute ! Ensuite par le changement de perspective énonciative. Si le conte de Perrault est un récit à la troisième personne, celui-ci est un récit porté par la voix de l’héroïne. L’adoption de ce point de vue dit clairement la dimension féministe dans laquelle l’ouvrage s’inscrit, et force le lecteur à s’identifier à la jeune femme dans un mouvement plein d’empathie. Enfin, la chute diffère profondément du conte de Perrault puisqu’il n’y a pas intervention des deux frères de l’épouse, mais que c’est en fuyant que l’héroïne se sauve et dénonce le serial-killer… La femme est donc à la fois la victime potentielle mais aussi celle qui a la force de se sauver par elle-même du danger incarné ici par Barbe bleue et de dénoncer à la police ce personnage inhumain et déshumanisé au point que le récit ne donne même pas son nom.
Il faut bien sûr dire quelques mots de l’expressivité des illustrations. Celles-ci savent jouer à la fois des dominantes de couleur (le bleu, le noir quand il le faut), des cadrages (gros plans des visages, plans plus larges), mettre en évidence les obsessions de l’héroïne (comme ces clefs qui envahissent une page), ou enfin présenter le malfaisant au milieu d’une meute d’animaux féroces. Si le ciel sans nuage est bleu, symbole de bonheur et d’été, la peur aussi peut-être bleue, et l’amour laisser des bleus au cœur… C’est dire l’ambivalence de cette couleur froide, couleur de l’eau sur laquelle avance le bateau dans lequel habite l’héroïne dans les dernières pages, comme pour dire à la fois la volonté d’échapper à ce prédateur (habitant un moulin au bord de l’eau), et l’impossibilité d’y échapper tout à fait… même en cultivant des plantes vertes.
Une riche réécriture du célèbre conte de Perrault, qui sait parler à travers une fiction sans concession des réalités que représentent aujourd’hui les féminicides et qui permettra aux jeunes lectrices et lecteurs d’ouvrir le dialogue sur les relations hommes femmes et de se questionner sur notre présent… et leur avenir.
 Marie Détrée est peintre officielle de la Marine depuis 2010, quelle découverte pour moi ! Il existe donc encore des artistes officiels, comme Racine qui était historiographe du Roi ? Eh bien, la Marine a bien choisi et on s’en réjouit : les image de Marie Détrée, tout en hachures colorées (feutres ? pastels gras ?), sont absolument merveilleuses . Elles rendent la couleur changeante des mers, les saisons, les heures et les vents, mais aussi les latitudes et longitudes, la lumière pétillante et l’obscurité dense.
Marie Détrée est peintre officielle de la Marine depuis 2010, quelle découverte pour moi ! Il existe donc encore des artistes officiels, comme Racine qui était historiographe du Roi ? Eh bien, la Marine a bien choisi et on s’en réjouit : les image de Marie Détrée, tout en hachures colorées (feutres ? pastels gras ?), sont absolument merveilleuses . Elles rendent la couleur changeante des mers, les saisons, les heures et les vents, mais aussi les latitudes et longitudes, la lumière pétillante et l’obscurité dense.