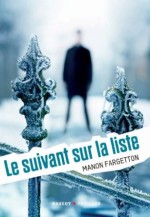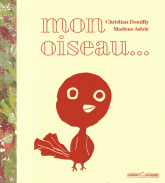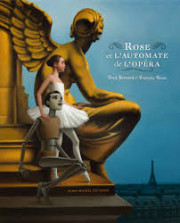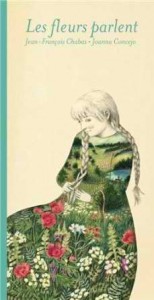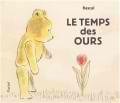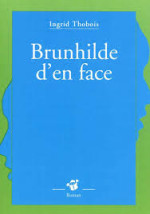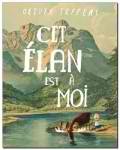L’ami paresseux
Ronan Badel
Autrement, 2013
Nouvelle aventure spatiale
Par Dominique Perrin
 Au grand chagrin de ses amis de la jungle, un paresseux endormi sur sa branche est arrimé à un convoi de troncs en partance pour les zones industrielles dévolues à la grande consommation humaine. Ce nouvel album muet de la collection « Histoire sans paroles » est placé sous le signe d’un simple et joli jeu de mots, qui en annonce la bonhomie espiègle. Qu’il soit question ici des paradoxes de l’amitié ou des moeurs étonnantes du petit animal congénitalement somnolent, le charme opère une fois de plus grâce au coup de génie d’une collection associant le long format à l’italienne à l’empire exclusif de l’image, vouée par là à occuper « toute la place » – comme chez René Char la beauté – et à assumer tous les devoirs.
Au grand chagrin de ses amis de la jungle, un paresseux endormi sur sa branche est arrimé à un convoi de troncs en partance pour les zones industrielles dévolues à la grande consommation humaine. Ce nouvel album muet de la collection « Histoire sans paroles » est placé sous le signe d’un simple et joli jeu de mots, qui en annonce la bonhomie espiègle. Qu’il soit question ici des paradoxes de l’amitié ou des moeurs étonnantes du petit animal congénitalement somnolent, le charme opère une fois de plus grâce au coup de génie d’une collection associant le long format à l’italienne à l’empire exclusif de l’image, vouée par là à occuper « toute la place » – comme chez René Char la beauté – et à assumer tous les devoirs.
Si la double-page fait ici l’objet d’un traitement moins ouvertement cinématographique que dans d’autres bijoux de la même collection, elle ménage cependant une puissante diversité de points de vue sur l’espace, et par contrecoup sur le monde et sur ce(ux) qui l’habite(nt) …sans pourtant que l’aventure se déroule hors du monde comme mystérieusement sphérique de la jungle même.