14-18. Une minute de silence pour nos arrière-grands-pères courageux
Dedieu
Seuil, 2014
Indicible – visible ?
Par Anne-Marie Mercier
 Les albums peuvent être supports de textes mais aussi de silences, c’est ce que prouve admirablement cet album de Dedieu dédié à la « grande guerre ». Une première phrase l’ouvre, d’une écriture tremblée : « Hélas ma chère Adèle, il n’y a plus de mots pour décrire ce que je vis ». Une lettre le clôt, la réponse d’Adéle à son mari, d’une écriture serrée, souple et élégante, pliée en quatre dans une petite enveloppe collée sur la troisième de couverture. Entre les deux, un album sans texte ni narration, en très grand format – on ne s’en « saisit » pas facilement, au propre comme au figuré – des images au pastel sépia, dont le contour blanc imite ceux de la photographie ancienne. On est de fait dans un entre-deux, mi documentaire mi-artistique.
Les albums peuvent être supports de textes mais aussi de silences, c’est ce que prouve admirablement cet album de Dedieu dédié à la « grande guerre ». Une première phrase l’ouvre, d’une écriture tremblée : « Hélas ma chère Adèle, il n’y a plus de mots pour décrire ce que je vis ». Une lettre le clôt, la réponse d’Adéle à son mari, d’une écriture serrée, souple et élégante, pliée en quatre dans une petite enveloppe collée sur la troisième de couverture. Entre les deux, un album sans texte ni narration, en très grand format – on ne s’en « saisit » pas facilement, au propre comme au figuré – des images au pastel sépia, dont le contour blanc imite ceux de la photographie ancienne. On est de fait dans un entre-deux, mi documentaire mi-artistique.
Ces doubles pages montrent l’horreur de la guerre, la fuite des humains et des animaux, la destruction générale, un monde sens dessus dessous. Pas de récit qui mette à distance, pas de mots qui permettent une prise. Pas d’humanité autre que fracassée, jusqu’à la lettre finale qu’on n’ouvrira peut-être pas. Des portraits crayonnés et de la photo rassurante du poilu souriant du début jusqu’aux aux portraits cauchemardesques de « gueules cassées » de la fin, en passant par le gros plan d’un pou, ou des images d’assaut et de blessures à mort, l’album réussit le pari de décrire l’indicible, un peu à la façon des encres de Goya, « les désastres de la guerre ». Autant dire que ce spectacle fait violence au regardeur.
La lettre de la fin complète ce tableau avec les difficultés des familles qui voient revenir les blessés, font face au quotidien, aux travaux des champs devenus encore plus difficile sans la présence des hommes, attendent le retour des aimés, en espérant qu’ils feront partie des chanceux. Oui, il leur a fallu du courage, aux hommes et aux femmes qui ont vécu ce long temps de guerre. Et au lecteur, il en faudra aussi un peu…
Autant le dire nettement, au risque de fâcher certains: il ne semble pas pertinent de proposer cet album (et, si on y tient, surtout pas sans précautions) à de jeunes lecteurs et même à des lecteurs pas forcément jeunes qui n’auraient pas envie d’affronter certaines images. Il est superbe, vrai. Justement. C’est une oeuvre d’artiste, qui dit bien quelle place l’album pourrait tenir aussi chez les moins jeunes : montrer ce que les mots peinent à dire, interroger sur le pouvoir des images et connaître ce que chacun peut/veut voir et savoir, faire oeuvre.

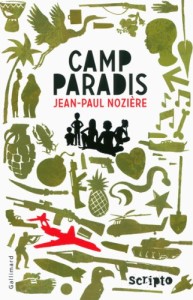
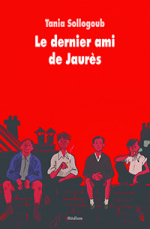

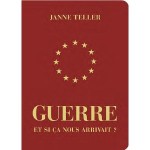
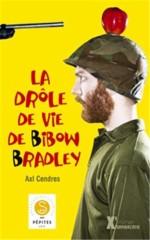
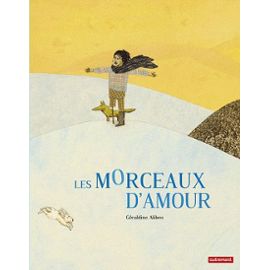
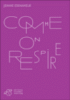
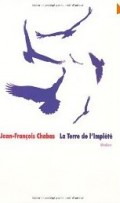
 Ce Bjorn est un héros de fantasy fort attachant : après 5 volumes, il captive toujours. Je me souviens qu’en 2007 (sur Sitartmag, voir ci-dessous) je disais grand bien de la fin de la tétralogie de Bjorn aux enfers et du volume qui avait ouvert le cycle (Bjorn le morphir), un peu moins de ce qui avait été publié entre les deux. Ainsi, il me semblait avoir fait le tour de la question et j’ai ouvert avec un certain retard le premier volume du nouveau cycle d’aventures, « Bjorn aux armées », sans grand enthousiasme, me disant que j’allais trouver du même, sans doute en moins bien.
Ce Bjorn est un héros de fantasy fort attachant : après 5 volumes, il captive toujours. Je me souviens qu’en 2007 (sur Sitartmag, voir ci-dessous) je disais grand bien de la fin de la tétralogie de Bjorn aux enfers et du volume qui avait ouvert le cycle (Bjorn le morphir), un peu moins de ce qui avait été publié entre les deux. Ainsi, il me semblait avoir fait le tour de la question et j’ai ouvert avec un certain retard le premier volume du nouveau cycle d’aventures, « Bjorn aux armées », sans grand enthousiasme, me disant que j’allais trouver du même, sans doute en moins bien.