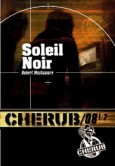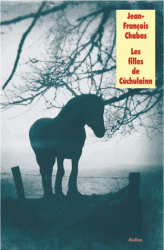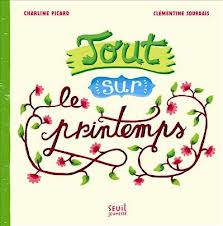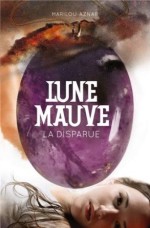Une étoile dans le cœur
Louis Atangana
Rouergue, 2013
Cumul de handicaps !
Par Maryse Vuillermet
 Ecrit à la première personne, ce roman de la douleur sociale prend aux tripes. Le narrateur, quinze ans, élève de première peu motivé, habitant d’une Zup, Les Iris, apprend par une lettre que son père Congolais les quitte, qu’il ne supporte plus le racisme français, la galère des petits boulots alors qu’il s’est tant battu pour devenir ingénieur. Damien en veut énormément à son père de les quitter mais aussi d’avoir toujours larmoyé sur ses échecs. Il nous révèle qu’il voit Souad en cachette, il désire son jeune corps mais la loi de la zone est terrible, si elle est vue avec lui, elle sera considérée à vie comme une pute : «L’armée des faux serviteurs d’Allah veillait ».
Ecrit à la première personne, ce roman de la douleur sociale prend aux tripes. Le narrateur, quinze ans, élève de première peu motivé, habitant d’une Zup, Les Iris, apprend par une lettre que son père Congolais les quitte, qu’il ne supporte plus le racisme français, la galère des petits boulots alors qu’il s’est tant battu pour devenir ingénieur. Damien en veut énormément à son père de les quitter mais aussi d’avoir toujours larmoyé sur ses échecs. Il nous révèle qu’il voit Souad en cachette, il désire son jeune corps mais la loi de la zone est terrible, si elle est vue avec lui, elle sera considérée à vie comme une pute : «L’armée des faux serviteurs d’Allah veillait ».
Mais un malheur n’arrivant jamais seul, il apprend aussi que sa mère étant juive, lui aussi l’est. Alors qu’il ne s’était jamais intéressé à ses origines, ni à celles de son père congolais ni à celles de sa mère juive, voilà que toute son Histoire lui saute à la figure. Comme il révèle sa judéité à ses camarades, il s’aperçoit vite que son double handicap est très lourd à porter, black, il subit le racisme des Blancs, des Arabes, juif, le racisme des Arabes, et des juifs qui ne comprennent pas qu’on puisse être juif et noir, amoureux de Souad, il se fait tabasser par les Islamistes au nom d’Allah…
Il ne va plus au lycée, erre, se bat, se fait agresser, quitter par Souad, mais il essaye aussi de comprendre, il interroge son grand-père juif, ancien déporté, Ahmed, le bouquiniste algérien gauchiste, il rencontre Juliette, une blanche, élevée au Cameroun, qui se sent noire… Bref, peu à peu, comme le lui disent son grand-père et Ahmed, il comprend que les déterminations raciales et religieuses sont simplificatrices, dangereuses, à combattre, les racismes et les préjugés aussi.
Dans une langue de jeune de banlieue, violente et imagée, Damien se débat avec ses contradictions, sa propre violence, ses désirs, ses affections, ses propres préjugés…
C’est un bon roman, même si certaines situations ne sont pas très crédibles, en particulier, le remariage de sa mère ouvrière avec un directeur financier, riche, sympa, mais noir, heureusement, sinon, il aurait été trop parfait !
 Eloge de la solidarité, jeu avec l’absurde, cette mise en image d’une variante d’un conte russe évoque les beaux jours des illustrations des premiers Père Castor (l’esthétique russe, justement) avec des animaux aux formes stylisées, aux couleurs bien tranchées. Du plus petit (la souris) au plus gros (l’ours), en passant par la grenouille, le lapin, le renard et le loup, tous trouvent un abri provisoire au chaud dans la moufle rouge oubliée dans la neige… jusqu’à ce qu’une fourmi vienne tout déranger.
Eloge de la solidarité, jeu avec l’absurde, cette mise en image d’une variante d’un conte russe évoque les beaux jours des illustrations des premiers Père Castor (l’esthétique russe, justement) avec des animaux aux formes stylisées, aux couleurs bien tranchées. Du plus petit (la souris) au plus gros (l’ours), en passant par la grenouille, le lapin, le renard et le loup, tous trouvent un abri provisoire au chaud dans la moufle rouge oubliée dans la neige… jusqu’à ce qu’une fourmi vienne tout déranger.