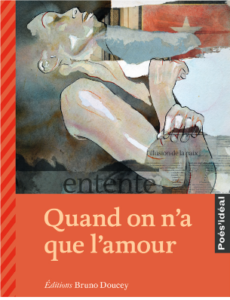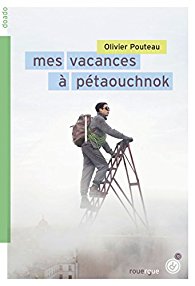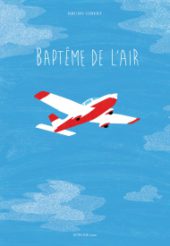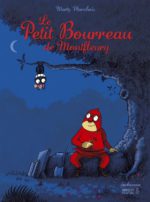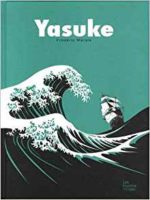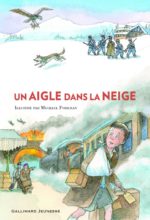Pour l’honneur de la tribu
Wendy Constance (traduit de l’anglais par Marie Leymarie)
Gallimard jeunesse, 2015
Jusqu’au bout du monde
Par François Quet
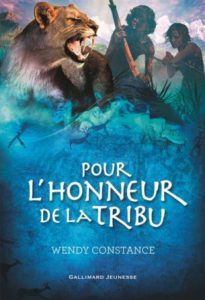 Un gros roman (328 pages), une histoire indienne d’avant l’histoire, deux points de vue (celui de Cheval Sauvage, un jeune garçon, et celui de Mésange bleue, une jeune fille), deux aventures qui n’en font bientôt plus qu’une, une trajectoire épique qui conduit les héros à travers forêts, montagnes et rivières jusqu’au bout du monde. Il ne fait aucun doute que l’histoire plaira : l’auteur a fait ce qu’il faut pour cela. Les héros ont tous deux rompu avec leurs tribus et leurs poursuivants ne sont jamais loin. Un bébé tigre est leur compagnon de route, mascotte assez peu commune pour éveiller l’intérêt et dotée d’une toison assez douce pour inspirer l’affection. Le froid, la neige, la faim, les loups, les rivières ou la tempête sont des obstacles saisissants dont les jeunes héros finissent par triompher.
Un gros roman (328 pages), une histoire indienne d’avant l’histoire, deux points de vue (celui de Cheval Sauvage, un jeune garçon, et celui de Mésange bleue, une jeune fille), deux aventures qui n’en font bientôt plus qu’une, une trajectoire épique qui conduit les héros à travers forêts, montagnes et rivières jusqu’au bout du monde. Il ne fait aucun doute que l’histoire plaira : l’auteur a fait ce qu’il faut pour cela. Les héros ont tous deux rompu avec leurs tribus et leurs poursuivants ne sont jamais loin. Un bébé tigre est leur compagnon de route, mascotte assez peu commune pour éveiller l’intérêt et dotée d’une toison assez douce pour inspirer l’affection. Le froid, la neige, la faim, les loups, les rivières ou la tempête sont des obstacles saisissants dont les jeunes héros finissent par triompher.
L’auteur s’est appliquée à rendre la violence tolérable et les héros ne se rendent directement coupables d’aucun crime, même pour se défendre. On imagine qu’aucun animal n’a eu à souffrir de mauvais traitement pendant l’écriture du roman. Et l’auteur a bien pris garde à ce que l’héroïne soit aussi vaillante que son compagnon : les efforts de Cheval Sauvage pour laisser Mésange Bleue s’activer près du feu quand il va chasser s’arrêtent vite lorsqu’il découvre que la jeune fille peut chasser aussi bien que lui, et qu’à deux on obtient de meilleurs résultats.
On l’aura compris, il s’agit d’un bon livre, bien fait et très « politiquement correct ». Trop peut-être. On aimerait parfois que sa sagesse laisse davantage parler l’humour ou la fantaisie et qu’une part d’imprévu vienne dérégler le déroulement parfait d’une aventure un peu trop irréprochable.