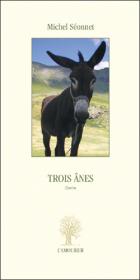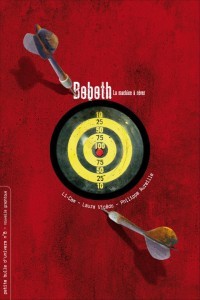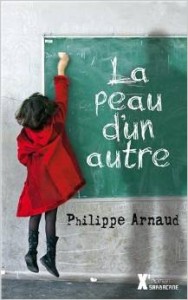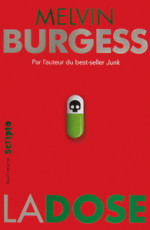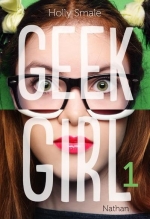La Rue des étoiles
Bart Moyeaert,
Traduit (néerlandais) par Daniel Cunin
Éditions du Rouergue, 2013
Embrouillamini
par François Quet
Trois enfants assis sur un mur regardent passer la vie. Les choses ne sont pas simples et la vie, parfois, c’est un embrouillamini. On se dispute. On se fâche. On fait des paris idiots. On se raconte des histoires. On est des garçons et on est des filles. On se défie. Il y a des personnes âgées qui finissent par mourir, des ferrailleurs bougons, un père tendre et lointain. Une maman qui ne reviendra pas. Peut-être pas. Peut-être que si. Bref, cette maman n’est pas pour rien dans l’embroullamini.
sur un mur regardent passer la vie. Les choses ne sont pas simples et la vie, parfois, c’est un embrouillamini. On se dispute. On se fâche. On fait des paris idiots. On se raconte des histoires. On est des garçons et on est des filles. On se défie. Il y a des personnes âgées qui finissent par mourir, des ferrailleurs bougons, un père tendre et lointain. Une maman qui ne reviendra pas. Peut-être pas. Peut-être que si. Bref, cette maman n’est pas pour rien dans l’embroullamini.
Bart Moyeaert raconte dans des chapitres courts comme des planches de BD le quotidien ordinaire de deux petits garçons, Oskar et Bossie, et de leur amie Camille (qui ne pense qu’à lire). On pense à Charlie Brown ou à Mafalda. Il ne se passe rien d’important, en tous cas rien de plus important que ce qui se passerait dans la vie réelle. Une vieille femme promène son chien, puis un jour disparait. Les héros se demandent si elle est morte ou à l’hôpital. Bossie adore raconter à son frère des histoires ahurissantes : l’histoire d’une vache tombée du ciel au Japon ou d’un chien naufragé sur un glaçon, qu’on finira par récupérer. Bossie taquine Camille, mais jusqu’où peut-on se montrer moqueur ? Une petite voisine joue les trouble-fêtes. Les ferrailleurs du quartier conduisent Oscar dans leur pick-up. Il découvre la saveur de la granita et la gentillesse de Phyllis. Bossie se demande si son père ne préfère pas le petit Oskar.
Ce sont à chaque fois de tout petits sketchs, des croquis ou des saynètes qui suscitent (ou rappellent au lecteur adulte) des émotions d’enfance, des peurs, des questions. La narration très elliptique, à la première personne — c’est Oskar qui raconte au passé composé —, laisse une large place au lecteur qui doit interpréter le comportement ou les sentiments des personnages.
Voici un petit livre délicieux, pas tout à fait un roman, pas tout à fait une chronique mais un beau texte, porté par un ton malicieux et tendre qui restitue l’imaginaire de l’enfance avec beaucoup de justesse.