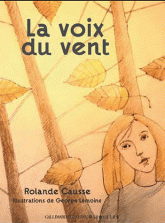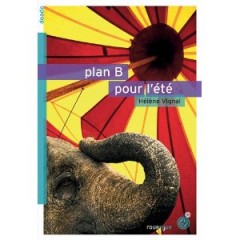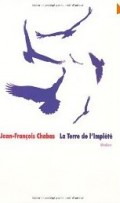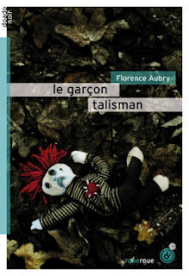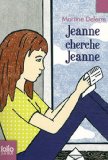La voix du vent
Rolande Causse
Gallimard Jeunesse, 2011
L’inflexion des voix chères qui se sont tues
par Christine Moulin
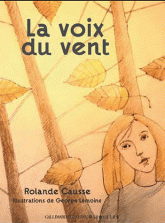 Tout, dans ce roman, est délicatesse : à commencer par la couverture et les illustrations dues au poétique pastel de Georges Lemoine. L’exergue est à l’unisson: « Les douleurs ont une clef de sol pour qui est musicien de l’intérieur » (Eric de Lucca, Le commentaire du un).
Tout, dans ce roman, est délicatesse : à commencer par la couverture et les illustrations dues au poétique pastel de Georges Lemoine. L’exergue est à l’unisson: « Les douleurs ont une clef de sol pour qui est musicien de l’intérieur » (Eric de Lucca, Le commentaire du un).
Le ton est donné car c’est bien de musique qu’il s’agit, tout au long du livre. L’héroïne, Sonia, est particulièrement sensible aux sons, comme le révèlent les premières lignes: « J’écoute le bruissement des arbres. Je n’ai pas besoin de les regarder, je les connais par cœur. Seul leur chuchotement m’importe ». Elle a perdu sa mère, Anna, et à l’ouverture du livre, elle ne parvient pas à s’ « éloigner de sa peine », comme dit son père. C’est de sa mère qu’elle tient son amour pour la musique, même si elle ne veut plus entendre parler de son piano depuis…
Peu à peu, malgré tout, elle va parvenir, à petites touches, à surmonter sa douleur. Grâce à la psy qu’elle affuble de sobriquets (« La Mère Michel », « Déteste déteste ») mais qui va vaincre son silence et ses résistances, en accueillant ses rêves. Grâce à son père, qui, bien qu’il soit très occupé par son métier d’architecte, ne sait que faire pour la distraire. Grâce à Gravie, sa grand-mère, pour qui elle nourrit pourtant une grande hostilité au départ. Grâce à Ludovic, son presque frère (« Si j’avais eu un frère, j’aurais aimé qu’il lui ressemblât, trait pour trait ») Grâce à Berthe, une jeune Ivoirienne : « Nous sommes devenues amies, très amies, une amitié partagée au cœur de nos peines inavouées ».
Le roman s’écoule doucement. Les évènements sont souvent infimes même s’ils ont un grand retentissement sur les émotions de Sonia. On assiste ainsi à une bagarre à l’école (Emilie a lancé à Sonia: « Si ta mère était à la maison, tu serais plus aimable! »); à l’entrevue avec une prof qui accuse Sonia d’avoir copié sa dissertation sur Phèdre, oeuvre qu’elle a particulièrement aimée et bien comprise; à un voyage en Jordanie; à la visite d’une cousine importune; à un pèlerinage vers l’endroit où son père a dispersé les cendres de sa mère, etc. Jusqu’au jour où arrive Olivier… Ce courant narratif nous mène jusqu’à l’épilogue qui, comme on le sent depuis le début, célèbre les droits de la vie, portée par le vent: « Toujours j’écoute la voix du vent, il m’a ouvert une voie. La voie d’Anna ». Tout l’enjeu de ce récit de deuil est là: faire d’une voix une voie.
Même si le parcours que suit l’histoire n’est pas toujours très lisible, même si la musique, à force d’être discrète, peut sembler atonale, on se rend compte, finalement, que ce roman a su épouser le rythme du deuil: rien de fracassant, de spectaculaire, mais l’impression, au bout du chemin, que l’on a surmonté l’insurmontable. Le tout est orchestré par la langue pure et classique de Rolande Causse, comme racinienne.
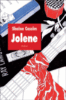 C’est dans un univers empreint de blues, que l’auteur nous présente l’histoire d’Aurélien, jeune lycéen plutôt marginal. C’est à travers son regard que nous sommes plongés dans son quotidien plein de conflits intérieurs et d’incertitudes. En effet, il semble reproduire le schéma paternel en se comportant comme un goujat envers les jeunes filles de son âge, les « toutes pareilles ». Il enchaîne les conquêtes, jusqu’à que ce que sa vie soit chamboulée par une rencontre… Jolene.
C’est dans un univers empreint de blues, que l’auteur nous présente l’histoire d’Aurélien, jeune lycéen plutôt marginal. C’est à travers son regard que nous sommes plongés dans son quotidien plein de conflits intérieurs et d’incertitudes. En effet, il semble reproduire le schéma paternel en se comportant comme un goujat envers les jeunes filles de son âge, les « toutes pareilles ». Il enchaîne les conquêtes, jusqu’à que ce que sa vie soit chamboulée par une rencontre… Jolene. . L’omniprésence de références, tant musicales que littéraires, permet la création d’un cocon amoureux, à la fois surprenant et insolite, en marge de la société. Ce roman s’adresse en priorité aux adolescents en montrant que les épreuves de la vie peuvent être surmontées, tant par soi-même que grâce aux autres, pour terminer sur un message d’espoir : il faut croire en la vie et en l’avenir.
. L’omniprésence de références, tant musicales que littéraires, permet la création d’un cocon amoureux, à la fois surprenant et insolite, en marge de la société. Ce roman s’adresse en priorité aux adolescents en montrant que les épreuves de la vie peuvent être surmontées, tant par soi-même que grâce aux autres, pour terminer sur un message d’espoir : il faut croire en la vie et en l’avenir.