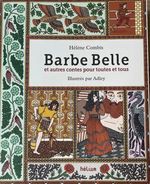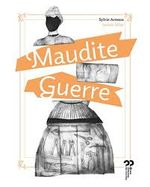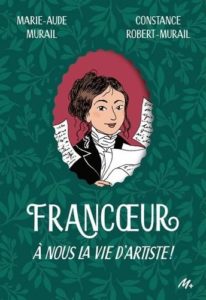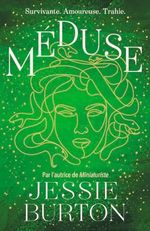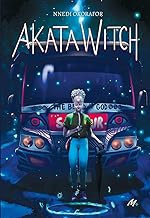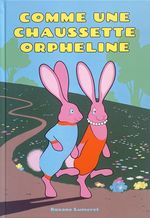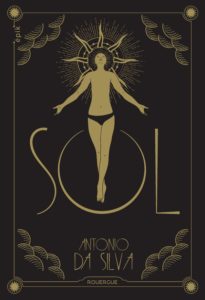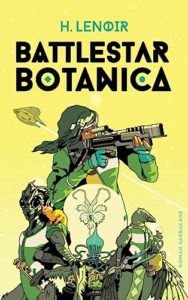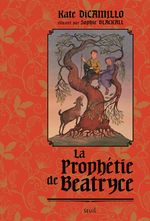Etre garçon – la Masculinité à contre-courant
Karim Ouaffi – Mikankey
Editions du Ricochet 2024
On ne nait pas garçon : on le devient
Par Michel Driol
 Cinq chapitres, conçus sur le même modèle, pour découvrir les stéréotypes qui enferment les garçons dans un rôle qu’ils n’ont pas forcément envie de jouer, mais qu’ils n’ont pas forcément la force ou les ressources de refuser. D’abord une bande dessinée dont les héros sont cinq adolescents d’une classe de troisième dont l’un des élèves est décédé, puis plusieurs pages plus documentaires, liées à la déconstruction des stéréotypes, mais donnant aussi des conseils ou des adresses pour aller plus loin.
Cinq chapitres, conçus sur le même modèle, pour découvrir les stéréotypes qui enferment les garçons dans un rôle qu’ils n’ont pas forcément envie de jouer, mais qu’ils n’ont pas forcément la force ou les ressources de refuser. D’abord une bande dessinée dont les héros sont cinq adolescents d’une classe de troisième dont l’un des élèves est décédé, puis plusieurs pages plus documentaires, liées à la déconstruction des stéréotypes, mais donnant aussi des conseils ou des adresses pour aller plus loin.
Masato pense que les garçons n’ont pas le droit de pleurer. Youri s’interroge sur le fait d’aimer les garçons. Feti voudrait bien ne plus être harcelé, mais la violence est-elle une bonne solution ? Antoine ne sait comment dire à Lily qu’il l’aime. Et enfin Rose se sent bien plus garçon que fille. Les bandes dessinées montrent ces adolescents et adolescentes dans des situations de la vie quotidienne, au collège, dans la rue, à la maison, confrontés à leurs questions, à leur mal être, et souvent en butte à une incompréhension familiale, ou à des propos qu’ils entendent et qui les marquent, leur indiquent un comportement comme étant « la norme », les comportements « différents » étant stigmatisés ou condamnés. Ainsi, tous sont confrontés à une idéologie dominante, au patriarcat ambiant et à ses codes toxiques. Cette bande dessinée, très concrète, illustre bien la question du rapport aux autres et à soi-même, sans volonté de choquer, mais avec une grande empathie pour les personnages évoqués, victimes de préjugés, d’un manque d’écoute venant des adultes souvent, des pairs parfois aussi.
Les parties documentaires explicitent d’abord les problématiques illustrées par les BD, à la façon d’une encyclopédie, en les enrichissant de faits historiques ou sociaux, en s’appuyant sur des nombreuses statistiques pour montrer l’ampleur des phénomènes décrits. Il s’agit de conduire chacun à réfléchir sur lui-même, à promouvoir un autre type de masculinité, moins toxique, plus à l’écoute, plus apte à exprimer ses émotions et à construire des relations positives et apaisées avec les autres. L’ouvrage jette ainsi un regard neuf sur les diverses identités masculines. Il ne cherche pas à imposer des normes, à dire ce qui serait normal ou pas, mais milite pour que chacun trouve sa propre masculinité. Pour ce faire, l’ouvrage brasse quantité de concepts : le genre, le patriarcat, la virilité, le féminisme, la transidentité… Il évoque quantité de pratiques ou de réalités telles que le harcèlement, le consentement, la pornographie… avec la volonté d’aider à comprendre ce qui s’y joue, dans l’ordre du symbolisme et du réel. Tout cela est écrit dans une langue accessible à toutes et tous, abondamment illustré de façon à rendre les propos encore plus explicites.
C’est sans doute le livre qu’il fallait aujourd’hui, un livre adroit, un livre qui ne cherche pas à être moralisateur ou donneur de leçons, mais un livre qui fait appel à la sensibilité, à la réflexion, à l’intelligence pour mettre en avant une déconstruction des stéréotypes liées au patriarcat, et la construction d’autres relations permettant de vivre ensemble dans une société plus équilibrée, plus apaisée, moins violente. A conseiller vivement dans tous les CDI à l’heure où certains voudraient que ces questions soient bannies de l’école