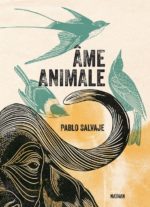D’ici là. Un genre d’utopie
Christian Bruel, Katy Couprie
Thierry Magnier, 2016
O. L. N. I. (objet livresque non identifié)
Par Anne-Marie Mercier
Album ? récit ill ustré ? et si oui, de quel genre : science-fiction ? essai ? manifeste ? aventures… La réponse est : rien de tout ça ! Utopie !
ustré ? et si oui, de quel genre : science-fiction ? essai ? manifeste ? aventures… La réponse est : rien de tout ça ! Utopie !
Une utopie à laquelle on assiste comme des spectateurs au théâtre, plongés dans une action en cours, avec un décor juste esquissé, des images floues gagnées par la neige d’un écran futur qui nous rappelle d’abord les vieux écrans du passé, au temps où les télés dormaient la nuit, avant de se rapprocher, de manière plus juste, des films de caméra de vidéo-surveillance : cette aventure (car c’en est une) futuriste nous parle aussi de notre monde :
« Une ville tentaculaire du Vieux Monde, un peu avant midi.
Les quinze tonnes d’un fourgon aéroglisseur ordinaire stationnent discrètement aux abords de ce quartier classé sensible par la gouvernance. Resté seul dans la cabine de pilotage, un androïde semble désactivé. Pourtant son scanner balaye continûment le secteur pour détecter la possible approche d’une patrouille.I »
La petite barre après le point et avant mes guillemets n’est pas une faute de frappe, mais l’indication de la place de la souris en fin de double page : ce récit est en train de s’écrire sous nos yeux. Certains mots sont surlignés de vert fluo, comme pour suggérer des liens hypertextuels. Tandis que ce texte défile, inscrit dans des « pavés » de texte gris-bleu  insérés dans les images, surgissent des notifications en carrés du même vert fluo, comme des bulles émergeant ça-et-là : définitions de mots (termes techniques, néologismes, mini bios de personnages, lois et traditions de ce monde). Tout cela s’inscrit sur les images de Katie Couprie, images originales pour un réel original, accompagnées d’autres images, images jamais vues et pourtant familières : icônes, tableaux ou photos célèbres. Toutes sont traitées par ordinateurs avec des effets de pixellisation forte qui nous dit bien que ces images viennent de loin, ont été prises en cachette, nous montrent ce que l’on n’aurait pas dû voir. Allez sur le site de l’éditeur pour voir en belle résolution ces images superbes et étonnantes
insérés dans les images, surgissent des notifications en carrés du même vert fluo, comme des bulles émergeant ça-et-là : définitions de mots (termes techniques, néologismes, mini bios de personnages, lois et traditions de ce monde). Tout cela s’inscrit sur les images de Katie Couprie, images originales pour un réel original, accompagnées d’autres images, images jamais vues et pourtant familières : icônes, tableaux ou photos célèbres. Toutes sont traitées par ordinateurs avec des effets de pixellisation forte qui nous dit bien que ces images viennent de loin, ont été prises en cachette, nous montrent ce que l’on n’aurait pas dû voir. Allez sur le site de l’éditeur pour voir en belle résolution ces images superbes et étonnantes
L’histoire, portée par de nombreux dialogues qui, comme au théâtre, nous font voir le monde par ce qu’en disent les acteurs, débute par une scène tournée en caméra cachée : une belle fille sert d’appât pour nourrir les « archives comportementales » qui montreront les manifestations de sexisme des derniers spécimens de machos avant leur extinction définitive – du moins c’est l’idée. L’héroïne, Sacha, est une jeune fille de 16 ans. Elle est indépendante mais proche de sa mère, une activiste comédienne qui la conseille parfois, ce qui donne une touche morale à l’apologie de toutes les libertés que propose le récit (seule règle : ne pas faire de mal à l’autre). Elle a beaucoup d’amis, les principaux étant un loup-cyborg, une femme-cyborg, un ex geek et une fille de son âge, Adriana, avec qui elle souhaite vivre,
La rencontre entre Sacha et Devil, un motard du groupe ennemi, les machos de « la Horde », est l’un des épisodes principaux de ce récit qui en propose plusieurs, chacun révélant un aspect de ce monde (hommes et femmes, amour, société…) : Devil, humain augmenté, devenu androgyne à son grand dam de motard appartenant à un groupe cultivant la virilité, est la pièce maitresse d’un complot contre la mémoire et l’imagination de l’humanité : en les inhibant, on consoliderait « le besoin de croyance, au détriment de la pensée créative. Ainsi se perpétueront la domination masculine, les religions, l’exploitation et le profit. » Si cet épisode manque un peu de vraisemblance (on ne voit pas bien comment un humain aussi « augmenté », retors et savant que Devil peut être berné si facilement par une toute jeune fille – certes, aidée de ses amis), la tension entre les deux personnages, l’attirance et la répulsion qui se mêlent et le pacte qui les lie en font un moment fort.
Mais plus forte encore est la peinture du monde en train de naître, c’est-à-dire la partie proprement utopique de l’ouvrage, qui est parfaitement cohérente, détaillée, séduisante : rapports entre hommes et femmes, ressources, communications, place des animaux, transports, architecture, tout est installé par petits détails. La « Compagnie », la société dans laquelle vit Sacha, est une communauté de 78 personnes, âgées « de deux à cent quatre ans » – chacun y a sa place –, qui vit en quasi autarcie, se préoccupe de droit animal et est membre de l’une des fédérations qui composent un « réseau coopératif horizontal ». Sacha est belle son monde est beau : on a hâte, « d’ici-là », de voir se combler tous les fossés, tomber toutes les barrières, et en attendant on se délectera des belles images et des belles idées portées par ce livre « gonflé », exigeant, dont on aura compris qu’il n’est pas pour les enfants, ni pour les lecteurs paresseux, mais bien pour ceux qui veulent explorer de nouvelles manières de penser, de conduire un récit, de construire des mondes et des images.
S’il fallait rapprocher ce livre d’un autre de Christian Bruel, on choisirait Venise n’est pas trop loin, pour l’aspect puzzle, la complicité entre les personnages, le trouble des situations, la tension, et l’âge du lecteur ou de la lectrice. Et pourtant, cela n’a rien à voir, on est en dehors de tous les cadres. Les auteurs, qui ont travaillé longtemps sur ce projet ont créé un livre venu du futur, qui nous promet des lendemains heureux, quand le Vieux Monde sera définitivement entravé et nous donne une lecture présente heureuse, « d’ici là »…
 Tout commence avec la question de l’éléphant : comment sait-on qu’on est amoureux ? Pour y répondre, l’assemblée très démocratique de tous les animaux se réunit autour de la fourmi, ravie de suppléer à Monsieur Tortue (dont la femme est malade) dans le rôle de président et de greffier. Chacun des animaux, à tour de rôle, propose une réponse, que la fourmi note scrupuleusement sur son cahier. Les illustrations, en léger décalage avec le texte, lui donnent une profondeur poétique.
Tout commence avec la question de l’éléphant : comment sait-on qu’on est amoureux ? Pour y répondre, l’assemblée très démocratique de tous les animaux se réunit autour de la fourmi, ravie de suppléer à Monsieur Tortue (dont la femme est malade) dans le rôle de président et de greffier. Chacun des animaux, à tour de rôle, propose une réponse, que la fourmi note scrupuleusement sur son cahier. Les illustrations, en léger décalage avec le texte, lui donnent une profondeur poétique.