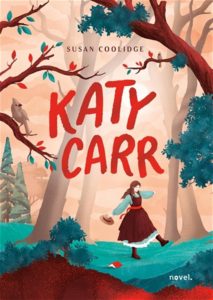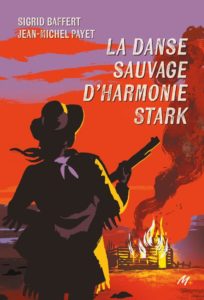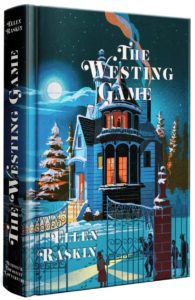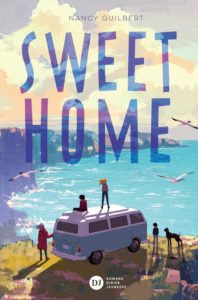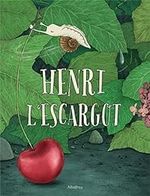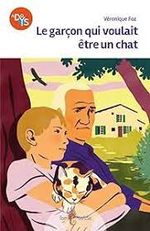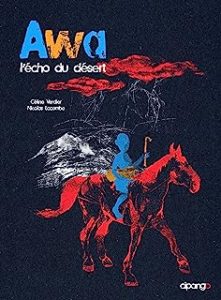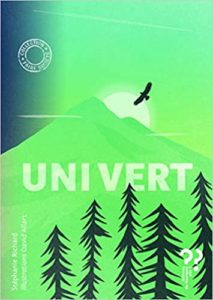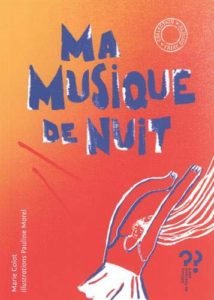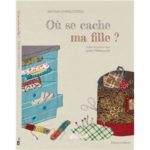Le Chant de la baleine
Sang-han Kim & Jung-in Choi – traduction Véronique Massenot
L’élan vert 2025
La fillette qui marchait avec des béquilles…
Par Michel Driol
 Une fillette aux cheveux roses marche difficilement avec deux cannes orthopédiques, descendant le long escalier qui conduit, à travers les maisons du village, jusqu’à la mer, tout en s’adressant à un tu dont on découvre qu’il s’agit de la baleine peinte sur le mur. Grâce à elle, le chemin semble plus facile. En bas, assise sur un banc, elle regarde les autres enfants qui l’ignorent jouer au ballon, mais elle rêve que la baleine lui apprendra à nager, à chanter… C’est alors qu’arrive un garçon qui sans doute vient emménager dans le quartier, et qui l’accompagne jusqu’à la plage.
Une fillette aux cheveux roses marche difficilement avec deux cannes orthopédiques, descendant le long escalier qui conduit, à travers les maisons du village, jusqu’à la mer, tout en s’adressant à un tu dont on découvre qu’il s’agit de la baleine peinte sur le mur. Grâce à elle, le chemin semble plus facile. En bas, assise sur un banc, elle regarde les autres enfants qui l’ignorent jouer au ballon, mais elle rêve que la baleine lui apprendra à nager, à chanter… C’est alors qu’arrive un garçon qui sans doute vient emménager dans le quartier, et qui l’accompagne jusqu’à la plage.
Peu de texte pour cet album qui fait la part belle aux illustrations pour raconter l’histoire, mais un texte dont la concision fait mouche. Un texte qui place d’emblée le lecteur dans la tête et dans l’imaginaire de la fillette, un texte court que la mise en page fragmente encore, comme pour dire la lenteur, les efforts à faire, le souffle court, et l’attente du but. Plus le texte est bref, plus les mots ont de la force pour dire, au travers des verbes en particulier, les souhaits de l’enfant : voyager, nager, plonger, sauter… tout ce qu’elle ne peut pas faire, tout cet apprentissage qu’elle attend d’une amie imaginaire. Il y a là quelque chose de poignant dans une grande simplicité syntaxique et lexicale. Reconnaissons là la valeur de la traduction signée Véronique Massenot dans le choix des mots et des rythmes.
Autant le texte se fait discret, autant les illustrations, réalisées à la gouache, en double page, imposent une vision, un univers qui fait alterner le réel dans sa brutalité et le rêve marin dans sa douceur. Réalisme de ce décor d’un village perché, avec ses maisons colorées, et surtout ses escaliers interminables. Violence silencieuse de cette image qui oppose la fillette, isolée, seule sur son banc, tête baissée, et les enfants qui jouent au ballon, sans se soucier d’elle. Cruauté de l’indifférence ainsi montrée. Pas besoin de texte. Mais c’est aussi les pages où se mêlent les flots bleus et les cheveux roses de la fillette, dans un univers onirique où tout devient possible, expression des rêves, des désirs de ne plus être différente, handicapée, mais semblable aux autres. Le séquençage des images est très cinématographique, faisant alterner plans d’ensemble (plongées, contre-plongées) et gros plans (sur le visage, sur les yeux, sur les pieds…). On suit ainsi au plus près la fillette dans ce chemin de croix descendant, semé d’embûches, cette fillette qu’accompagnent discrètement deux chats qu’on cherchera sur toutes les pages, comme ses seuls compagnons dans le monde réel…
La page finale laisse au lecteur la liberté de son interprétation. Après une séquence maritime, où le texte dit que l’amitié ça se partage à l’infini, la dernière image montre tous les enfants réunis face à un coucher de soleil. Deux groupes bien distincts. La fillette et son nouvel ami, page de droite, les enfants et leur ballon page de gauche. Certes ces derniers regardent vers les premiers, mais est-ce pour aller jouer ensemble ?
Un bel album qui évoque le handicap, l’indifférence, avec beaucoup de pudeur et de sensibilité, qui conjugue avec beaucoup de poésie le rêve et la réalité, autour des figures bien contrastées d’une fillette touchante et d’une baleine majestueuse.